- Accueil
- Mot de tête
- «Paix»: un mot de guerre?

©Ici Beyrouth
Promesse électorale, idéal universel ou instrument de domination? Derrière l’apparente simplicité du mot «paix», se cache une histoire longue et ambivalente, façonnée par les conflits, le pouvoir et les récits collectifs. À l’heure où Donald Trump en fait un slogan politique, retour sur un mot aussi ancien que disputé.
Depuis son retour au pouvoir en janvier 2025, Donald Trump multiplie les promesses de paix: fin de la guerre en Ukraine «en 24 heures», accord global au Moyen-Orient, y compris sur Gaza. Mais quand Trump parle de paix, il s’inscrit dans une longue tradition rhétorique où le mot rime souvent avec ordre, voire soumission. Derrière sa façade rassurante, que nous dit ce mot de notre histoire, de nos conflits, de nos illusions?
Un mot ancien, un idéal mouvant
Issu du latin pax, pacis, «paix» ne désigne pas d’abord un état durable de tranquillité, mais plutôt l’acte de faire la paix, c’est-à-dire l’établissement d’un accord entre deux parties opposées, souvent après un conflit. Il est d’ailleurs parent de pactum, mot latin qui signifie «convention, arrangement» et qui a donné en français «pacte».
Dans la Rome antique, pax désigne un état de non-guerre, souvent imposé par la force. On parle de Pax Romana pour évoquer cette longue période de stabilité assurée par l’empire, reposant sur la soumission des peuples conquis.
L’idée de paix, à ses racines, n’est donc pas tant celle d’une harmonie naturelle que celle d’un équilibre négocié, parfois précaire, toujours réversible.
C’est au Xe siècle que le mot entre en français sous les formes pais ou pes, avant que la graphie paix ne s’impose. Dans les textes médiévaux, on parle alors de «paix de Dieu» pour désigner les périodes où l’Église interdisait les violences féodales, ou encore de «paix intérieure», paix de l’âme, ou de «paix du roi», forme de trêve politique durant certaines fêtes. La paix est tour à tour juridique, sociale ou spirituelle.
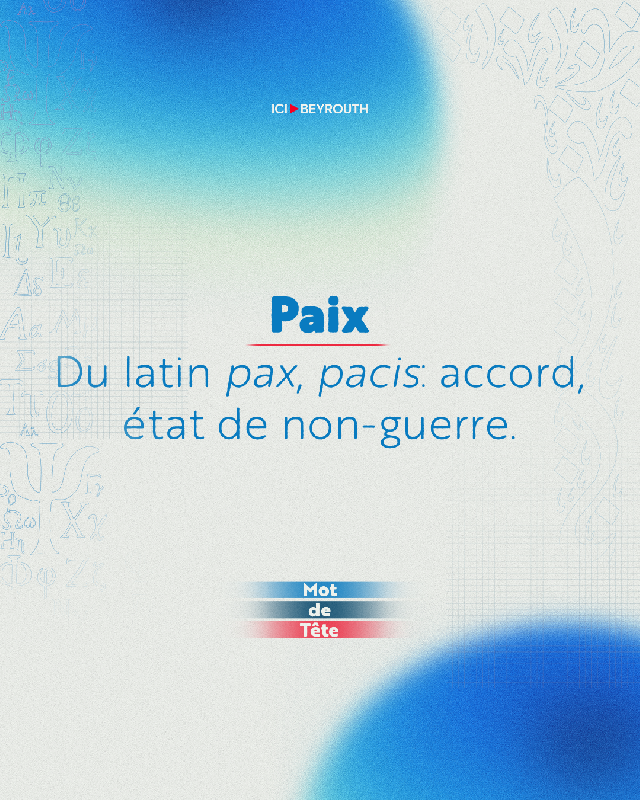
Des promesses fragiles
Ce n’est qu’à partir du XVe siècle, dans l’Europe des premières puissances coloniales, que se développent les premiers traités multilatéraux, jetant les fondements du droit international.
Celui-ci ne cessera d’évoluer, notamment après les grandes guerres européennes, pour tenter d’encadrer la guerre et d’instaurer une paix durable. Les traités de Westphalie (1648), en sont un jalon majeur, tout comme la création de la Société des Nations en 1919, puis de l’ONU en 1945.
La paix devient alors un objectif politique universel, parfois utopique, souvent conflictuel dans sa mise en œuvre.
La paix dans le discours contemporain
Aujourd’hui, le mot «paix» oscille entre deux acceptions: paix négative, synonyme d’absence de guerre, et paix positive, comme un idéal de coopération et de coexistence harmonieuse.
Dans le contexte du Moyen-Orient, il est au cœur des négociations, mais son emploi varie selon les acteurs. Pour certains, elle commence quand les armes se taisent. Pour d’autres, tant que règnent l’injustice, l’occupation ou la misère, il n’y a pas de paix.
Symbole d’idéal pour les uns, masque du rapport de force pour les autres, la paix est toujours le résultat d’un acte – politique, moral, religieux – plus que d’un état naturel. Elle suppose un accord, donc un effort. En cela, elle serait moins l’inverse de la guerre que son prolongement par d’autres moyens. Elle reste précaire, toujours à reconstruire.


Commentaires