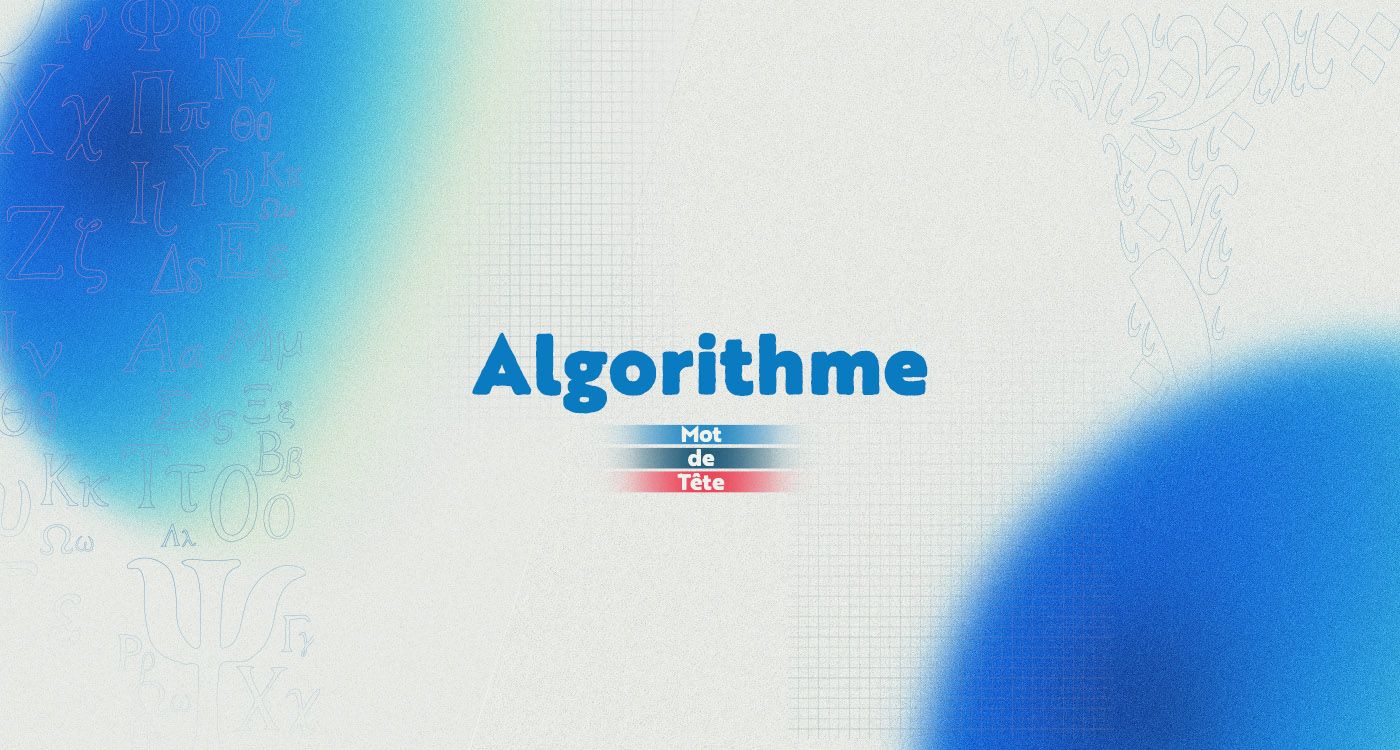
De l’héritage d’Al-Khwarizmi à l’intuition visionnaire d’Ada Lovelace, l’algorithme a parcouru un long chemin. D’abord méthode de calcul, il est devenu moteur de l’informatique et arbitre invisible de nos vies numériques.
Des recettes mathématiques aux systèmes qui gouvernent nos vies numériques, l’algorithme a traversé les siècles et les disciplines. Derrière ce mot devenu omniprésent se cache une histoire humaine, faite de savants persans, de philosophes, de pionnières de l’informatique et de géants de la Silicon Valley.
Ancré dans l’ancienne Perse
Au IXe siècle, à Bagdad, le savant persan Al-Khwarizmi rédige un traité de calcul qui, traduit en latin, donnera Algorismus. De son nom découlera «algorithme», mais aussi «algèbre», issu de son autre ouvrage majeur, Al-Jabr. Son héritage illustre le rôle du monde arabe comme passeur de savoirs mathématiques vers l’Occident médiéval.
Dans son sens ancien, il renvoyait donc à la manipulation pratique des chiffres arabes dans le système décimal. «Algorithme» désignait un système de numération et un ensemble de règles opératoires: l’algorithme de la division, l’algorithme de la multiplication…
La pensée algorithmique dans l’Antiquité
Bien avant les ordinateurs, les civilisations antiques concevaient déjà des procédures systématiques pour résoudre des problèmes. L’algorithme d’Euclide (IIIe siècle av. J.-C.), qui permet de calculer le plus grand commun diviseur (PGCD), reste encore enseigné aujourd’hui. Quant au «crible» d’Ératosthène, il permettait d’identifier les nombres premiers.
Ces méthodes étaient déjà perçues comme des recettes: un enchaînement fini d’opérations menant à un résultat.
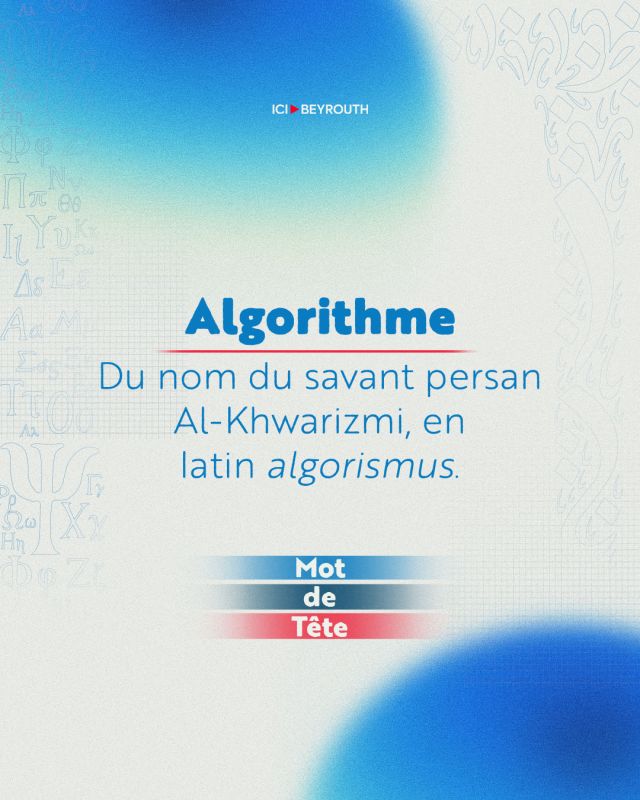
Du Moyen Âge à la modernité: l’algorisme
C’est vers le XIIIe siècle que le terme circule en Europe sous la forme «algorisme» ou «augorisme», désignant le calcul avec les chiffres arabes et l’usage du zéro. On le retrouve dans des textes comme ceux de G. de Coinci ou encore chez Rabelais, qui parle en 1534 d’«algorisme» comme de l’«art du calcul en général».
Au fil du temps, la notion s’élargit pour désigner, au XIXe siècle, des procédés symboliques et formels, allant jusqu’au calcul infinitésimal de Leibniz. Peu à peu, le terme quitte le domaine strictement mathématique pour désigner un mécanisme du raisonnement. Ainsi, pour des philosophes comme Merleau-Ponty ou Ruyer, l’algorithme devient une métaphore de la pensée structurée, réglée par des signes conventionnels.
Ada Lovelace et le premier algorithme informatique
Au XIXe siècle, le mathématicien Charles Babbage imagine une machine analytique, précurseur de l’ordinateur moderne. À ses côtés, Ada Lovelace, fille du poète Lord Byron, élabore en 1843 ce qui est considéré comme le premier véritable programme informatique. Visionnaire, elle pressent que les machines pourraient un jour aller au-delà du calcul numérique pour manipuler des symboles, de la musique ou des images.
Or, Charles Babbage s’est approprié l’invention de la machine analytique, qu’il n’a pourtant jamais construite. Ada Lovelace n’avait pas signé ses notes de son nom, mais seulement de ses initiales A.A.L. Lors de la publication, celles-ci ont été mal recopiées en A.L.L., ce qui empêcha de l’identifier clairement comme l’autrice des idées. Ce n’est que plus tard que les historiens ont rétabli la place véritable de Lovelace.
De Turing à Google
Le XXe siècle consacre l’essor de la pensée algorithmique avec Alan Turing. Sa «machine universelle» démontre qu’une suite d’instructions codées peut, en théorie, résoudre tout problème calculable. Cette formalisation pose les bases de l’informatique moderne.
Depuis, l’algorithme est devenu l’épine dorsale du numérique: il trie les bases de données, compresse les images, optimise les trajets. Mais au XXIe siècle, il change d’échelle et s’invite dans nos vies quotidiennes. Désormais, les algorithmes recommandent une vidéo sur YouTube, hiérarchisent nos flux sur TikTok ou Instagram, gèrent la publicité ciblée et alimentent les intelligences artificielles.
Un futur écrit en code
Longtemps perçu comme un outil neutre, l’algorithme est à présent critiqué pour ses biais et son influence. En hiérarchisant nos flux, en amplifiant certaines informations et en occultant d’autres, il devient un filtre puissant, qui façonne non seulement ce que nous voyons mais aussi ce que nous pensons.
Transparence, responsabilité et éthique: voici les enjeux qui s’invitent aujourd’hui dans les débats publics.





Commentaires