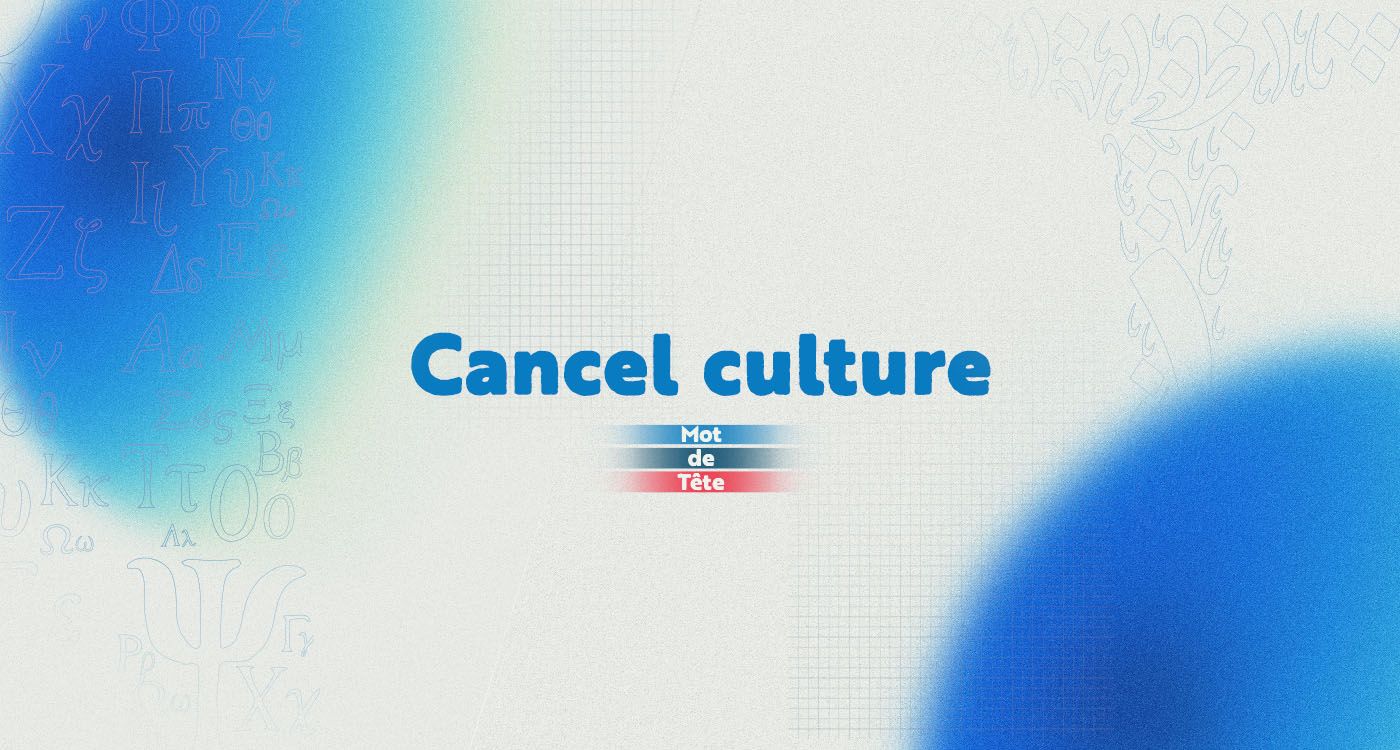
Née en ligne et popularisée par les scandales mondiaux, la cancel culture – ou culture de l’effacement – divise toujours en 2025. Entre outil d’émancipation et logique d’exclusion, elle soulève une question essentielle: qui est vraiment visé par ce bannissement collectif?
En 2025, le débat reste brûlant. Est-ce un outil de responsabilisation des puissants ou un tribunal populaire incontrôlable? L’expression cancel culture, que la Commission d’enrichissement de la langue française invite à traduire par culture de l’effacement, continue de diviser. Dans une époque marquée par la viralité des réseaux sociaux et la montée des polarisations, cette expression incarne l’une des controverses centrales de nos sociétés modernes.
Naissance et ascension d’un phénomène mondial
Selon le Cambridge Dictionary, le terme cancel culture se réfère à la «manière de se comporter dans une société ou dans un groupe – en particulier sur les réseaux sociaux – où il est courant de rejeter complètement et de cesser de soutenir une personne parce qu’elle a tenu des propos ou accompli des actes jugés offensants».
L’expression apparaît dans le monde anglophone autour de 2016, avant de gagner en visibilité à partir de 2018 dans les grands médias. Sa notoriété explose en 2019, lorsque le dictionnaire australien Macquarie Dictionary la consacre Word of the Year (mot de l’année). En 2021, elle figure également dans sa liste de sélections pour le Word of the Decade (mot de la décennie).
En français, le terme circule dès 2016, mais son usage se popularise réellement à partir de 2018, dans le sillage du mouvement #MeToo et de polémiques relayées sur Twitter et Instagram. Ce sont alors les médias francophones qui lui donnent une visibilité accrue.
La Commission d’enrichissement de la langue française propose en 2021 un équivalent officiel: culture de l’effacement. Cette traduction évoque une volonté collective d’«d’effacer de l’espace public ou de la mémoire collective des personnalités ou des œuvres, comme si elles n’avaient jamais existé».
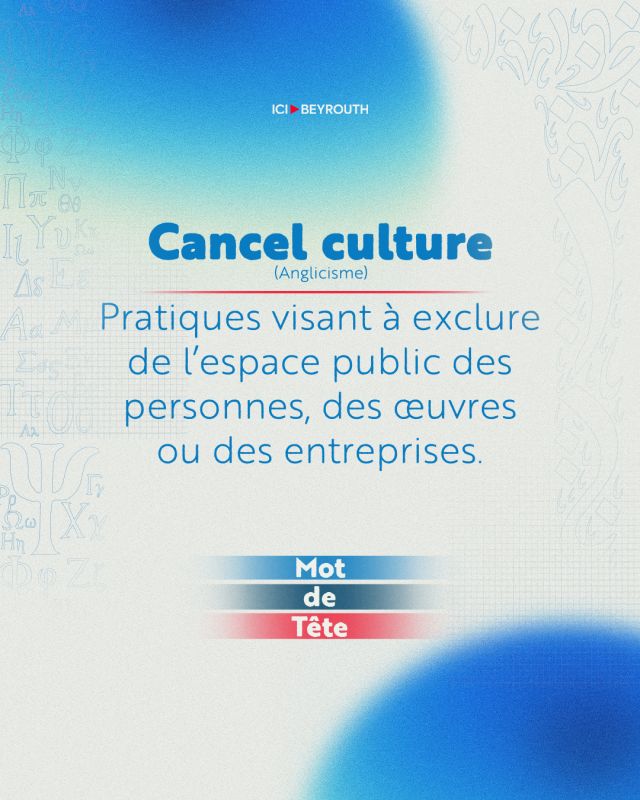
Cette pratique n’est pas neuve. De l’ostracisme athénien aux chasses aux sorcières, l’histoire abonde d’exemples d’exclusions collectives. Toutefois, son ampleur a changé. Les réseaux sociaux fonctionnent comme des caisses de résonance: hashtags, vidéos virales et campagnes coordonnées transforment en quelques heures une controverse locale en scandale mondial. Les algorithmes, en valorisant les messages les plus spectaculaires, amplifient encore ce phénomène.
Les grands procès médiatiques
Les exemples abondent. Le mouvement #MeToo a propulsé la carrière de l’ex-producteur Harvey Weinstein au cœur d’un procès planétaire qui a précédé les condamnations judiciaires. Bill Cosby, figure emblématique de la télévision américaine, a vu son image s’effondrer sous le poids des accusations relayées en ligne. Plus récemment, les prises de position de l’écrivaine britannique J.K. Rowling sur les questions de genre ont déclenché une vague de boycotts et de critiques qui se poursuit encore aujourd’hui.
Ces affaires illustrent la double nature de la cancel culture: un levier pour briser le silence autour de comportements abusifs mais aussi une arme redoutable qui peut condamner sans nuance.
Outil d’émancipation ou instrument de domination?
La cancel culture est traversée par un paradoxe. D’un côté, elle agit comme un outil d’émancipation: elle donne la parole aux minorités, corrige les déséquilibres de pouvoir, met en lumière des injustices longtemps tues. En permettant à des victimes ou à des groupes marginalisés de dénoncer publiquement des comportements, elle renforce leur capacité d’agir dans l’espace public.
Mais d’un autre côté, elle peut devenir un instrument de domination. Elle risque de reproduire les logiques qu’elle prétend combattre: exclusion, violence symbolique, peur de s’exprimer. Dans certains cas, ce sont des voix fragiles – professeurs, artistes, anonymes – qui subissent le poids des campagnes de bannissement. Le phénomène peut ainsi décourager le débat et installer une culture de la peur plutôt qu’une culture de la responsabilité.
Qui efface qui?
La question centrale, en 2025, reste donc de savoir qui est réellement visé par la cancel culture. Les puissants et les célébrités qui voient leur pouvoir contesté, ou les individus plus vulnérables, qui n’ont ni les ressources ni les appuis pour se défendre face à la violence numérique?
C’est peut-être là que réside le cœur du débat. Car selon la réponse, la culture de l’effacement peut apparaître soit comme un progrès, soit comme un symptôme inquiétant de nos sociétés hyperconnectées.
La Commission d’enrichissement de la langue française (Celf) a été créée en 1996 et placée auprès du Premier ministre français. Elle a pour mission de développer l'utilisation du français dans les domaines économique, scientifique, techniques et juridiques. Elle œuvre pour améliorer la diffusion du français en proposant des termes nouveaux, contribue au rayonnement de la francophonie et à la promotion du plurilinguisme.
Les termes repérés puis proposés doivent être validés par l'Académie française, puis par les ministres concernés.
Les nouveaux termes sont publiés au Journal officiel, dans la rubrique Avis et communications et sur la base de données FranceTerme.


Commentaires