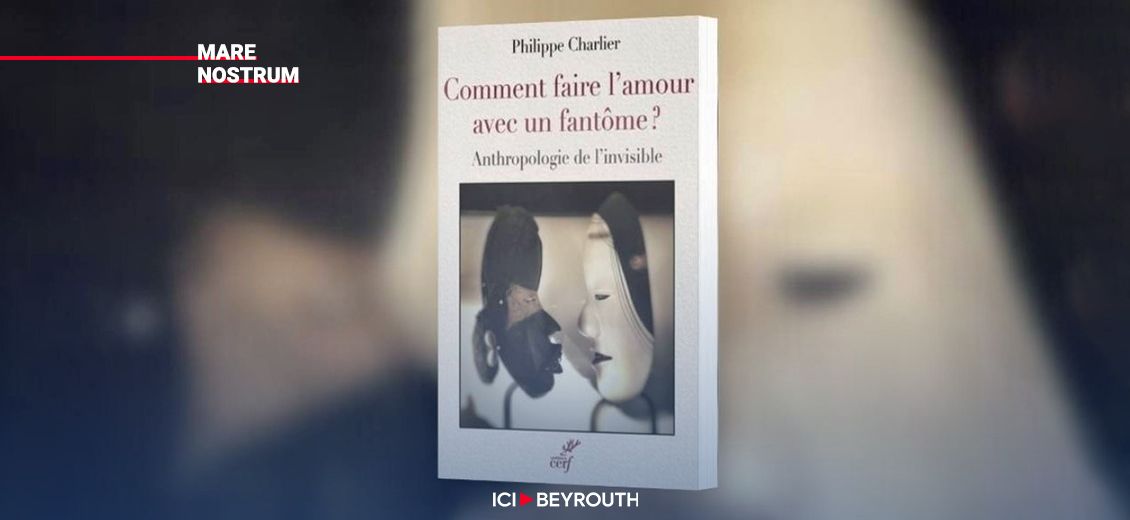
Directeur du département de la recherche et de l’enseignement au musée du quai Branly – Jacques-Chirac, Philippe Charlier est docteur en médecine (anatomopathologie & médecine légale), docteur ès lettres (archéoanthropologie) et docteur ès sciences (bioéthique). Membre de la Société de Géographie, de la Société des Explorateurs français, et de la Société des Africanistes, il dirige la collection « Terre Humaine » (Plon).
Comment faire l’amour avec un fantôme ? S’agit-il d’un clin d’œil à Dany Laferrière, Comment faire l’amour avec un nègre sans se fatiguer, qui déconstruisait bon nombre de clichés. Le titre énigmatique de ce beau livre de Philippe Charlier, à visée anthropologique, étudie les rapports de l’homme avec l’invisible dans le monde non occidental, en créant des allers-retours et des passerelles entre le Japon, les pays africains ou Haïti. Médecin et anthropologue, l’auteur dirige le département d’enseignement et de recherche du musée du quai Branly. Écrit dans une langue claire, précise, voire poétique, ce texte vole d’une culture à l’autre avec maestria. La structure très libre de l’ouvrage, superbement illustré, à la mise en page esthétique et d’un plaisant format carré, le permet.
C’est sur les yurei, ces fantômes japonais au caractère flottant et privés de jambes (pour manifester l’action maléfique de démons à leur égard ou la perte de tout lien physique avec la terre), que s’ouvre le livre. Leur représentation obéit à des codes symboliques, imaginés par Maruyama Okyo, un peintre de Kyoto né au XVIIIe siècle, qui avait voulu ainsi représenter le spectre de sa maîtresse morte prématurément. Les spectres qui figurent sur des estampes sont investis d’un pouvoir magique plus puissant que les images montrant des acteurs grimés en yurei. Ces figurations pouvaient, en raison de leur sensualité, être installées dans des lieux de plaisir, ou être animées grâce à divers artifices au temple de Kudoji. Toutefois, de semblables pratiques d’animation se retrouvent dans la Chine ancienne à l’époque de l’empereur Wudi, et dans le Dit de Genji, classique japonais de l’époque Edo. L’auteur énumère quelques façons de susciter la venue de fantômes avant de montrer comment en Occident l’occultiste américain Paschal Beverly Randolph avait développé un principe d’animation de peintures donnant l’illusion du vivant. Toutefois, la fréquentation des spectres présente certains dangers. La mort et les mauvais sorts s’avérant contagieux, mieux vaut éviter tout commerce avec des figures surnaturelles, comme le montrent de nombreux contes chinois. Les unions avec un non-humain se révèlent toujours néfastes.
Puis, après avoir dressé l’historique d’un masque africain aux fonctions prophylactiques, Philippe Charlier s’attache à analyser la fonction de trois statues, qui, dans le contexte du vaudou béninois, constituent « les émanations spirituelles du pouvoir et de la présence du roi », caractérisé lui-même par un double pouvoir, religieux et politique. La duplicité touche aussi les statues, que l’on a évidées pour créer des cachettes magiques, et recouvertes de la matière usitée pour les sacrifices. Lorsqu’elles accompagnaient les troupes du roi, elles étaient censées prendre vie, et assumer la fonction guerrière du souverain dont elles devenaient le double. L’examen de ces statues, ainsi que d’une 4e, a confirmé ces usages, tout en laissant un certain nombre de questions sans réponses. C’est ensuite au sujet des animaux devins que s’attache le livre, en dévoilant un autre visage de la magie africaine. Renards, souris, araignées sont invités à laisser des traces suivant un protocole initié par le sorcier, qui les interprète ensuite, car lui seul est capable de comprendre le message que le chaos animal introduit au cœur de l’ordre humain. Enfin, l’étude d’un talisman « cheval folie », caché à l’intérieur d’une gourde, semble clore cette première série de chapitres consacrés à la sorcellerie africaine. L’auteur revient ensuite sur le continent asiatique pour évoquer le rôle joué par le qi, ou souffle vital, dans les arts martiaux. Après avoir analysé un masque africain qui aurait pu inspirer les cubistes, il se consacre aux doudous, fétiche, masques, évoquant même des idoles jouets destinés à calmer les enfants du peuple Nivkh, en Sibérie extrême-orientale, puis d’autres supports d’esprits dans l’Extrême Orient russe et la Mandchourie chinoise. Ces objets, loin de s’avérer inertes, sont perçus comme incarnés et capables d’une vie autonome, une croyance qui repose sur le concept d’âmes multiples et l’idée d’une mobilité de l’âme dont le siège se déplace au fil du temps.
Le livre consacre ensuite un chapitre aux grands masques Dogon, utilisés pour la fête de Sigui, tous les 60 ans. Les mascarades faisaient partie d’un culte des ancêtres dans leur ensemble. Les Dogons devaient leur existence au dieu démiurge Amma, qui leur avait conféré l’immortalité. Devenus vieux, ils se transformaient en serpents ou en génies et accédaient au Sigui, un autre monde possédant une langue différente, le siguiso. Mais à la suite d’une transgression, la mort a touché ce peuple, qui depuis organise le Sigui pour obtenir le pardon de cette infraction du 1er interdit. Le livre décrit en détail le rituel et la légende qui lui a donné naissance, et se réfère au film tourné en 1969 par Jean Rouch au moment du passage de Sigui dans le village de Bongo. Les participants au rituel, même s’ils conservent un visage nu, sont appelés masques par les anciens. Les masques Dogon servent au maintien de la cohésion sociale, et plus particulièrement au lien intergénérationnel, qui peut revêtir la forme de celui qui unit les vivants et les morts. Le prochain Sigui, qui aura lieu en 2027, suscitera-t-il des avancées dans l’interprétation ?
Le rituel ayant pour rôle « d’organiser le chaos », selon Philippe Charlier, et d’accompagner la mort, pose problème quand il s’agit d’une épidémie. L’anthropologue se demande alors ce qui se produit dans ce cas, et si ceux-ci font l’objet d’une évolution ou d’une adaptation. Il évoque les circonstances où l’on s’abstient de marquer le deuil, ou bien on le fait en le décalant de la mort biologique, comme c’était le cas pour les lépreux au Moyen-Âge ou les sadhus en Inde. Le risque de contagion induit par les épidémies peut influencer celui-ci et le retarder. L’auteur du livre s’interroge sur la possibilité d’un moyen métaphysique pour contourner la suspension du rituel. La première option consisterait à considérer l’absence de rituel comme une forme exceptionnelle de ce dernier. Philippe Charlier se fonde sur l’existence d’anti-rituels spécifiques, comme la damnatio memoriae, dans l’Antiquité romaine, destinée à effacer toute trace d’un défunt, ou l’exhumation judiciaire, comme celle du pape Formose en 897, deux cas extrêmes. Il s’interroge alors sur la place assignée au médecin et à l’anthropologue dans le contexte des pandémies, et la conduite à adopter.
À la suite de ce long détour par l’Afrique, nous sommes ramenés au Japon par le biais du théâtre No, dont les spectacles relèvent de la sphère du sacré. L’espace de la représentation, que l’auteur décrit longuement, apparaît ritualisé. L’acteur de No observe un long moment de méditation avant de revêtir son masque. La durée de ce processus s’apparente à un « lent mûrissement ». La dimension cérémonielle de cette préparation précède l’entrée sur scène, qui rappelle une apparition fantomatique. Lorsque la voix de l’acteur se fait enfin entendre, elle est déformée par le masque, qui la fait ressembler à une voix d’outre-tombe. L’acteur, dit-on, est « monté » ou « chevauché » par son personnage, sans pour autant disparaître. Le vêtement et le masque rapprochent l’interprète de l’inhumain, du surnaturel. Le No s’enracine dans de lointaines saynètes magico-religieuses en lien avec les rituels agricoles et les mascarades liées aux kamis, ces divinités propres au shintoïsme.
Retour à l’Afrique avec la statuaire Baoulé, et notamment les figurations de blolo bla, « ces doubles mystiques auquel chaque être est marié dès sa naissance dans un univers parallèle », la vraie famille étant, pour ce peuple, « celle de l’au-delà » Les épouses mystiques sont représentées par des statuettes, qui donnent lieu à des codes de figuration et des rituels précis. Ce culte s’éteint avec la mort du possesseur de la statue. Ailleurs, la population Lobi, sise entre Ghana, Burkina Faso et Côte d’Ivoire, considère que le monde visible est habité par des entités invisibles et entretient une relation très spéciale avec le monde des morts. Les Lobis construisent des autels destinés aux sacrifices pour s’attirer les bonnes grâces des êtres surnaturels, et conçoivent la personne comme constituée d’un corps, de sang, d’une ombre, d’un double, d’un souffle et d’un principe nommé khele. L’âme peut sortir du corps quand on rêve, qu’on est victime d’un sort ou au moment de la mort, c’est pourquoi un rituel spécifique accompagne cette dernière, en opérant la séparation entre le mort et les vivants. En cas d’échec, le mort peut se transformer en entité maléfique, âme errante aspirant à se réincarner, qui persécute les vivants, et nécessite l’intervention d’un sorcier. Pour lutter contre celles-ci, il faut parfois recourir à la ruse ou au mensonge. Le vaudou haïtien et la croyance aux dorlis confrontent aussi les morts et les vivants. Les dorlis, ou « maris de la nuit », sont des esprits qui abusent les femmes endormies en se métamorphosant en crapaud ou en chien. Au Japon, d’autres créatures mystérieuses rendent visite aux jeunes filles. Yokaï, renards, buruburu (tremblote tremblote) hantent l’imaginaire japonais. Dans tous les cas, des sortilèges s’avèrent nécessaires pour les tenir à l’écart. Au Pays du Soleil Levant, les vieux outils s’animent aussi la nuit, prêts à commettre de nombreuses facéties.
Le livre se termine sur l’évocation des boliw africains et des estampes japonaises. Avec virtuosité, Philippe Charlier fait voyager le lecteur dans un monde invisible, dont il explore tour à tour les rituels et les coutumes. Des fétiches au théâtre No, on trouve la même fascination pour l’au-delà, dont la frontière avec le monde des vivants semble particulièrement poreuse. Extrêmement érudit, Comment faire l’amour avec un fantôme éclaire d’étranges pratiques amoureuses, en lien avec des croyances ou des superstitions. Si certaines coutumes pourraient faire penser aux récits d’incubes et de succubes, qui se retrouvent dans la littérature fantastique occidentale, il faut recourir à l’anthropologie et à la métaphysique pour en comprendre les différences culturelles. Par sa vaste érudition et son interdisciplinarité, le texte de Philippe Charlier tente de répondre aux questions qui se posent à nous, tout en laissant certaines d’entre elles ouvertes, en attente d’autres réponses.
Chroniqueuse: Marion Poirson-Dechonne
https://marenostrum.pm/comment-faire-lamour-avec-un-fantome/
Charlier, Philippe, « Comment faire l’amour avec un fantôme ? : anthropologie de l’invisible », Le Cerf, 14/10/2021, 1 vol. (241 p.), 20 €.
Comment faire l’amour avec un fantôme ? S’agit-il d’un clin d’œil à Dany Laferrière, Comment faire l’amour avec un nègre sans se fatiguer, qui déconstruisait bon nombre de clichés. Le titre énigmatique de ce beau livre de Philippe Charlier, à visée anthropologique, étudie les rapports de l’homme avec l’invisible dans le monde non occidental, en créant des allers-retours et des passerelles entre le Japon, les pays africains ou Haïti. Médecin et anthropologue, l’auteur dirige le département d’enseignement et de recherche du musée du quai Branly. Écrit dans une langue claire, précise, voire poétique, ce texte vole d’une culture à l’autre avec maestria. La structure très libre de l’ouvrage, superbement illustré, à la mise en page esthétique et d’un plaisant format carré, le permet.
C’est sur les yurei, ces fantômes japonais au caractère flottant et privés de jambes (pour manifester l’action maléfique de démons à leur égard ou la perte de tout lien physique avec la terre), que s’ouvre le livre. Leur représentation obéit à des codes symboliques, imaginés par Maruyama Okyo, un peintre de Kyoto né au XVIIIe siècle, qui avait voulu ainsi représenter le spectre de sa maîtresse morte prématurément. Les spectres qui figurent sur des estampes sont investis d’un pouvoir magique plus puissant que les images montrant des acteurs grimés en yurei. Ces figurations pouvaient, en raison de leur sensualité, être installées dans des lieux de plaisir, ou être animées grâce à divers artifices au temple de Kudoji. Toutefois, de semblables pratiques d’animation se retrouvent dans la Chine ancienne à l’époque de l’empereur Wudi, et dans le Dit de Genji, classique japonais de l’époque Edo. L’auteur énumère quelques façons de susciter la venue de fantômes avant de montrer comment en Occident l’occultiste américain Paschal Beverly Randolph avait développé un principe d’animation de peintures donnant l’illusion du vivant. Toutefois, la fréquentation des spectres présente certains dangers. La mort et les mauvais sorts s’avérant contagieux, mieux vaut éviter tout commerce avec des figures surnaturelles, comme le montrent de nombreux contes chinois. Les unions avec un non-humain se révèlent toujours néfastes.
Puis, après avoir dressé l’historique d’un masque africain aux fonctions prophylactiques, Philippe Charlier s’attache à analyser la fonction de trois statues, qui, dans le contexte du vaudou béninois, constituent « les émanations spirituelles du pouvoir et de la présence du roi », caractérisé lui-même par un double pouvoir, religieux et politique. La duplicité touche aussi les statues, que l’on a évidées pour créer des cachettes magiques, et recouvertes de la matière usitée pour les sacrifices. Lorsqu’elles accompagnaient les troupes du roi, elles étaient censées prendre vie, et assumer la fonction guerrière du souverain dont elles devenaient le double. L’examen de ces statues, ainsi que d’une 4e, a confirmé ces usages, tout en laissant un certain nombre de questions sans réponses. C’est ensuite au sujet des animaux devins que s’attache le livre, en dévoilant un autre visage de la magie africaine. Renards, souris, araignées sont invités à laisser des traces suivant un protocole initié par le sorcier, qui les interprète ensuite, car lui seul est capable de comprendre le message que le chaos animal introduit au cœur de l’ordre humain. Enfin, l’étude d’un talisman « cheval folie », caché à l’intérieur d’une gourde, semble clore cette première série de chapitres consacrés à la sorcellerie africaine. L’auteur revient ensuite sur le continent asiatique pour évoquer le rôle joué par le qi, ou souffle vital, dans les arts martiaux. Après avoir analysé un masque africain qui aurait pu inspirer les cubistes, il se consacre aux doudous, fétiche, masques, évoquant même des idoles jouets destinés à calmer les enfants du peuple Nivkh, en Sibérie extrême-orientale, puis d’autres supports d’esprits dans l’Extrême Orient russe et la Mandchourie chinoise. Ces objets, loin de s’avérer inertes, sont perçus comme incarnés et capables d’une vie autonome, une croyance qui repose sur le concept d’âmes multiples et l’idée d’une mobilité de l’âme dont le siège se déplace au fil du temps.
Le livre consacre ensuite un chapitre aux grands masques Dogon, utilisés pour la fête de Sigui, tous les 60 ans. Les mascarades faisaient partie d’un culte des ancêtres dans leur ensemble. Les Dogons devaient leur existence au dieu démiurge Amma, qui leur avait conféré l’immortalité. Devenus vieux, ils se transformaient en serpents ou en génies et accédaient au Sigui, un autre monde possédant une langue différente, le siguiso. Mais à la suite d’une transgression, la mort a touché ce peuple, qui depuis organise le Sigui pour obtenir le pardon de cette infraction du 1er interdit. Le livre décrit en détail le rituel et la légende qui lui a donné naissance, et se réfère au film tourné en 1969 par Jean Rouch au moment du passage de Sigui dans le village de Bongo. Les participants au rituel, même s’ils conservent un visage nu, sont appelés masques par les anciens. Les masques Dogon servent au maintien de la cohésion sociale, et plus particulièrement au lien intergénérationnel, qui peut revêtir la forme de celui qui unit les vivants et les morts. Le prochain Sigui, qui aura lieu en 2027, suscitera-t-il des avancées dans l’interprétation ?
Le rituel ayant pour rôle « d’organiser le chaos », selon Philippe Charlier, et d’accompagner la mort, pose problème quand il s’agit d’une épidémie. L’anthropologue se demande alors ce qui se produit dans ce cas, et si ceux-ci font l’objet d’une évolution ou d’une adaptation. Il évoque les circonstances où l’on s’abstient de marquer le deuil, ou bien on le fait en le décalant de la mort biologique, comme c’était le cas pour les lépreux au Moyen-Âge ou les sadhus en Inde. Le risque de contagion induit par les épidémies peut influencer celui-ci et le retarder. L’auteur du livre s’interroge sur la possibilité d’un moyen métaphysique pour contourner la suspension du rituel. La première option consisterait à considérer l’absence de rituel comme une forme exceptionnelle de ce dernier. Philippe Charlier se fonde sur l’existence d’anti-rituels spécifiques, comme la damnatio memoriae, dans l’Antiquité romaine, destinée à effacer toute trace d’un défunt, ou l’exhumation judiciaire, comme celle du pape Formose en 897, deux cas extrêmes. Il s’interroge alors sur la place assignée au médecin et à l’anthropologue dans le contexte des pandémies, et la conduite à adopter.
À la suite de ce long détour par l’Afrique, nous sommes ramenés au Japon par le biais du théâtre No, dont les spectacles relèvent de la sphère du sacré. L’espace de la représentation, que l’auteur décrit longuement, apparaît ritualisé. L’acteur de No observe un long moment de méditation avant de revêtir son masque. La durée de ce processus s’apparente à un « lent mûrissement ». La dimension cérémonielle de cette préparation précède l’entrée sur scène, qui rappelle une apparition fantomatique. Lorsque la voix de l’acteur se fait enfin entendre, elle est déformée par le masque, qui la fait ressembler à une voix d’outre-tombe. L’acteur, dit-on, est « monté » ou « chevauché » par son personnage, sans pour autant disparaître. Le vêtement et le masque rapprochent l’interprète de l’inhumain, du surnaturel. Le No s’enracine dans de lointaines saynètes magico-religieuses en lien avec les rituels agricoles et les mascarades liées aux kamis, ces divinités propres au shintoïsme.
Retour à l’Afrique avec la statuaire Baoulé, et notamment les figurations de blolo bla, « ces doubles mystiques auquel chaque être est marié dès sa naissance dans un univers parallèle », la vraie famille étant, pour ce peuple, « celle de l’au-delà » Les épouses mystiques sont représentées par des statuettes, qui donnent lieu à des codes de figuration et des rituels précis. Ce culte s’éteint avec la mort du possesseur de la statue. Ailleurs, la population Lobi, sise entre Ghana, Burkina Faso et Côte d’Ivoire, considère que le monde visible est habité par des entités invisibles et entretient une relation très spéciale avec le monde des morts. Les Lobis construisent des autels destinés aux sacrifices pour s’attirer les bonnes grâces des êtres surnaturels, et conçoivent la personne comme constituée d’un corps, de sang, d’une ombre, d’un double, d’un souffle et d’un principe nommé khele. L’âme peut sortir du corps quand on rêve, qu’on est victime d’un sort ou au moment de la mort, c’est pourquoi un rituel spécifique accompagne cette dernière, en opérant la séparation entre le mort et les vivants. En cas d’échec, le mort peut se transformer en entité maléfique, âme errante aspirant à se réincarner, qui persécute les vivants, et nécessite l’intervention d’un sorcier. Pour lutter contre celles-ci, il faut parfois recourir à la ruse ou au mensonge. Le vaudou haïtien et la croyance aux dorlis confrontent aussi les morts et les vivants. Les dorlis, ou « maris de la nuit », sont des esprits qui abusent les femmes endormies en se métamorphosant en crapaud ou en chien. Au Japon, d’autres créatures mystérieuses rendent visite aux jeunes filles. Yokaï, renards, buruburu (tremblote tremblote) hantent l’imaginaire japonais. Dans tous les cas, des sortilèges s’avèrent nécessaires pour les tenir à l’écart. Au Pays du Soleil Levant, les vieux outils s’animent aussi la nuit, prêts à commettre de nombreuses facéties.
Le livre se termine sur l’évocation des boliw africains et des estampes japonaises. Avec virtuosité, Philippe Charlier fait voyager le lecteur dans un monde invisible, dont il explore tour à tour les rituels et les coutumes. Des fétiches au théâtre No, on trouve la même fascination pour l’au-delà, dont la frontière avec le monde des vivants semble particulièrement poreuse. Extrêmement érudit, Comment faire l’amour avec un fantôme éclaire d’étranges pratiques amoureuses, en lien avec des croyances ou des superstitions. Si certaines coutumes pourraient faire penser aux récits d’incubes et de succubes, qui se retrouvent dans la littérature fantastique occidentale, il faut recourir à l’anthropologie et à la métaphysique pour en comprendre les différences culturelles. Par sa vaste érudition et son interdisciplinarité, le texte de Philippe Charlier tente de répondre aux questions qui se posent à nous, tout en laissant certaines d’entre elles ouvertes, en attente d’autres réponses.
Chroniqueuse: Marion Poirson-Dechonne
https://marenostrum.pm/comment-faire-lamour-avec-un-fantome/
Charlier, Philippe, « Comment faire l’amour avec un fantôme ? : anthropologie de l’invisible », Le Cerf, 14/10/2021, 1 vol. (241 p.), 20 €.
Lire aussi



Commentaires