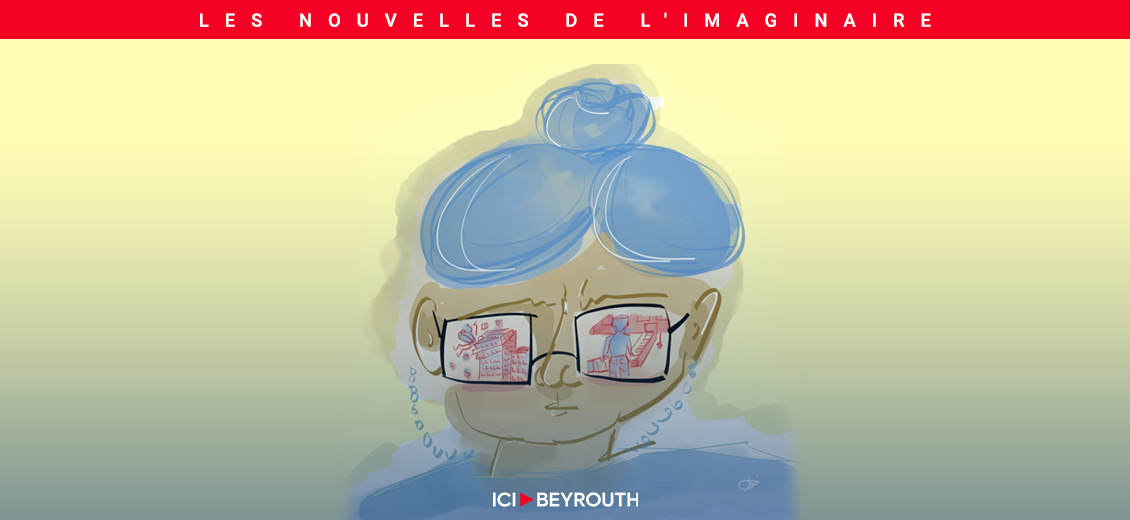
Ziad a posé sa bière fraîche déjà bien entamée sur son dessous de verre. Il a attrapé ma main dans la sienne et m’a souri. Après deux ans, ce sourire n’avait pas fini de me charmer et de faire s’agiter les petits papillons dans mon ventre. Alors il m’a calmement expliqué qu’il n’avait d’autre choix que de retourner au Liban pour faire le point avec ses parents. Il se sentait redevable envers eux, il y avait longtemps qu’il était parti de la maison et se sentait comme revenu à la case départ. Ici, ça ne fonctionnait pas pour lui et l’échec au concours pour la deuxième fois consécutive remettait tout en perspective. Que faire désormais? Peut-être simplement rentrer, retrouver ses parents et sa fratrie, se ressourcer malgré le chaos d’un Liban en pleine guerre civile. Les racines sont les racines. Il y passerait l’été et réfléchirait au sein de sa famille. Et il reviendrait peut-être pour une troisième première année.
Oh, comme je voulais y croire… Mais je n’y arrivais pas.
Les années du concours étaient éprouvantes et nos efforts finalement bien peu récompensés. Ma réussite était très largement assombrie par son échec. Nous étions un duo, une équipe soudée et si cela nous avait déjà traversé l’esprit, bien sûr, nous n’avions jamais véritablement évoqué la défaite de l’un de nous.
Je doutais que Ziad trouve une nouvelle fois la force de s’arracher aux siens pour revivre une année pareille à ces deux dernières. Moi regardant vers l’avant, lui à l’arrêt. Les Libanais émigrés en France étaient nombreux et la faculté se montrait indulgente avec eux. S’ils le souhaitaient, et selon leurs résultats aux examens et leur classement final, ils bénéficiaient d’un passe-droit pour tripler. Le doyen avait été clair, Ziad pourrait se réinscrire. Et je me tiendrais fidèle à ses côtés pour l’épauler jusqu’au bout.
Les journées qui ont suivi le départ de Ziad m’ont été très pénibles à vivre. J’avais gardé le rythme décalé que nous avions adopté toute l’année pour travailler. Je veillais tard dans la nuit, jusqu’à une ou deux heures du matin, me levais à la mi-journée et, faute d’occupation plus stimulante, je regardais beaucoup de vieux films sur la petite télévision en noir et blanc.
Je me nourrissais de concombres, tomates, laban et pain libanais, comme avec Ziad. J’écoutais «mesh mohem lala» et «nana» d’Azar Habib, au charme duquel j'avais succombé, tant pour sa voix que pour ses notes orientales.
Au début, je n’attendais pas tellement le retour de Ziad, mais après un mois et demi, j’ai commencé à songer que s’il devait revenir en France, ce serait dans ces eaux-là, mi-juillet ou début août peut-être. Et l’attente était bien longue… Je n’avais strictement aucune nouvelle de lui, ni aucun numéro de téléphone où le joindre et lui ne me contactait pas non plus, c’était bien trop compliqué, nous le savions, je n’étais pas surprise. Sa voix et son accent chantant me manquaient. Je riais seule en repensant à ses blagues.
La guerre et les menaces de mort qui l’accompagnaient me terrifiaient, tout en me paraissant lointaines et surréalistes. Pourtant, les informations à la télévision et dans les journaux l’évoquaient largement. Je les évitais.
Le soir, quand j’entendais des crissements de pneus sur le parking de la cité universitaire, je m’imaginais que c’était Ziad qui me revenait. Je me redressais sur le canapé, aux aguets, patientais quelques minutes, le temps que le taxi le dépose, qu’il règle, qu’il soulève sa valise sur trois étages sans ascenseur et la porte jusqu’au bout du palier… mais personne ne frappait jamais à la porte.
Je rendais visite à mes sœurs, je voyais nos amis et nous mentionnions Ziad au présent, comme s’il s’était absenté pour les vacances seulement. Alors que je songeais de plus en plus que je ne le reverrais peut-être plus jamais de ma vie. C’était une torture et en même temps essentiel que Ziad anime notre mémoire collective. Car toute seule dans mon studio, de plus en plus résignée à l’idée qu’il ne reviendrait pas de là-bas, dans mes pensées les plus noires il m’arrivait de croire qu’il n’avait même jamais existé. J’étais même parfois allée ouvrir le placard du buffet orange – couleur seventies – pour vérifier la présence de son pot de zaatar entamé, mélange de thym avec lequel il nous cuisinait les pizzas libanaises de son enfance. C’était idiot. C’était une preuve.
Pour la seconde fois, je repense à ce jour des résultats, ce souvenir finalement fugace dans la belle et longue vie que j’ai vécue.
La première fois fut quand la sage-femme a déposé notre petite Joséphine sur ma poitrine, que tu l’as regardée et que tu as pleuré. Nous lui avons donné le prénom de ta mère comme second prénom. Et nous lui avons offert son jonc doré un peu cabossé pour ses dix-huit ans. Ta mère… nous l’avons perdue trois mois avant la naissance de notre fille, elle était heureuse de nous savoir futurs parents. Ton père était parti quelques années auparavant… Il te téléphonait souvent, pour la forme, mais c’est à moi qu’il parlait des heures. Ziad, tu les as rendus tellement fiers de toi! Tu es devenu médecin et je n’oublierai jamais ton visage plein de joie quand, après une troisième première année, tu as enfin vu ton nom sur cette liste! On a fêté ta la victoire avec les copains et mes sœurs, arrosé ta belle réussite au champagne toute la soirée, la cuite de ma vie!
La seconde fois, c’était en rêve, je crois, le dernier avant que je ne m’endorme et ne ferme à tout jamais les yeux sur cette vie merveilleuse passée à tes côtés. Dans notre grand lit, ta main serrait fort la mienne, comme au restaurant où tu m’as annoncé ton départ, il y a de cela des années. J’ai entendu le crissement des pneus sur le parking, tes pas sur le palier, les trois coups secs frappés à la porte. J’ai ouvert, je t’ai reconnu. Tu m’as souri et nous ne nous sommes plus jamais séparés.
Juliette Elamine
Illustration: Nora Moubarak
Lire aussi




Commentaires