
Dans un long entretien accordé à Ici Beyrouth, Paule Constant, prix Goncourt 1998 et membre de l’Académie Goncourt depuis 2013, dévoile son enfance auprès d’un père violent.
L’écrivaine Paule Constant a soutenu deux thèses de doctorat à l’université de la Sorbonne et a enseigné la littérature à l’université d’Aix-Marseille, avant de se lancer corps et âme dans l’écriture. Parmi les prestigieux prix qu’elle a obtenus: le Grand prix de l’essai de l’Académie française pour son ouvrage Un monde à l’usage des demoiselles en 1987 et le prix Goncourt 1998 pour son roman Confidence pour confidence, édités chez Gallimard, comme tous ses livres. En 2019, la maison Gallimard réunit ses livres qui ont pour dénominateur commun l’Afrique, en un seul volume dans la collection Quarto, intitulé Mes Afriques. L’académicienne du jury Goncourt, élue à l’unanimité au couvert de Robert Sabatier, raconte à Ici Beyrouth sa carrière littéraire et sa vie.
Tout se joue avant six ans. Qu’est-ce qui a marqué votre enfance, puis votre adolescence?
De dix à seize ans, je suis restée chez les Dames de Saint-Maur. Je passais les vacances chez mes grands-parents qui avaient une merveilleuse propriété à sept kilomètres du couvent. Six ans, sans que je ne voie mes parents, au point que ma mère avec qui je correspondais régulièrement m’écrit un jour: comme tu me manques et comme je voudrais te rencontrer dans la rue! À l’opposé, mon père était violent et je lui tenais tête, dès l’enfance. Attention, je ne parle pas d’abus, mais de violence. J’ai vécu au sein d’une famille très religieuse, toujours entourée de moines, de prêtres. Mon frère était et demeure très traditionaliste, voire intégriste. Ma sœur consacre son temps aux activités religieuses. Enfant, mon père voulait m’obliger à lui dire «je t’aime», alors que je refusais obstinément «son éducation». À cinq ans, je me promenais dans la cour de l’hôpital et je disais à qui veut l’entendre: je n’aime pas papa. De retour, il me grondait et je récoltais une fessée d’enfer. Il m’administrait des punitions corporelles, inspirées du catholicisme peut-être. (Se mettre à genoux sur une règle, les bras en forme de croix). Mais la grande douleur de mon père a été que j’écrive.
Quel effet cela lui a fait de vous voir au faîte de la gloire ?
Chez Gallimard, Le Clézio fut mon premier lecteur, Michel Tournier mon second lecteur et Pascal Quignard, mon troisième lecteur. À mon arrivée, Pascal Quignard me demande mon nom. Mon beau-frère était l’écrivain Pierre Bourgeade. Il valait mieux choisir un autre nom. Pour Quignard, mon nom de naissance Paule Constant faisait bien l’affaire. Je fus invitée sur le plateau d’Apostrophe. Je ne connaissais pas Bernard Pivot, à l’époque. Il y avait parmi les invités, un académicien.. Pendant l’émission, ce dernier me dit: «Ah, on veut se venger de son papa», avec mépris. J’ai su par la suite que mon père l’avait appelé pour le remercier de m’avoir maltraitée et lui avait exprimé l’étendue de son estime.
Avez-vous raconté cette violence du père dans vos livres?
Oui, surtout dans La Cécité des rivières. J’ai mis treize livres pour raconter enfin l’indicible. L'un de mes livres porté au pinacle par les grandes plumes déjà citées, m'avait valu sa colère et cinq années de mutisme. En 1998, j’allais recevoir le Goncourt en novembre et la Légion d’honneur en décembre. J’ai décidé que mon père me la remettrait. J’avais imaginé qu’il n’allait rien dire de plaisant durant la cérémonie et j’ai demandé à mon mari qu’il y ait un autre discours pour pallier la faille, le cas échéant. Le jour J, toute la famille était là. Mon père arrive, avec sa silhouette impressionnante et son allure hollywoodienne. Il prononce les mots suivants: «Madame vous êtes la victime de votre enfance!» Sur son lit de mort, atteint d’un cancer qui lui défigurait la mâchoire, il m’a dit: «Ton livre est superbe, mais tu n’es pas allée assez loin.»
Qu’en est-il de votre mère? Comment vivait-elle à l’ombre de ce père et mari autoritaire?
Ma mère, très amoureuse de lui, était satisfaite de le voir partager son amour. Elle était habitée par une grande charité chrétienne, qui la rendait trop humble et modeste. Artiste-peintre, elle avait peint les vitraux de la cathédrale de Djibouti, mais elle ne se prenait pas au sérieux. Puis elle avait épousé le mâle de référence, l’acteur hollywoodien, le médecin respecté de tous. Durant l’absence de mon père, parti faire la guerre en Indochine, j’ai été extrêmement aimée, gâtée et couvée par ma mère. Mon père qui est rentré la nuit, après quatre ans d’absence, m’a trouvée dans les bras de ma mère, dormant à sa place. Alors, il a cru bon m’infliger une volée de coups, sans me parler. Je me suis levée sans pleurer ni gémir. Il a été sidéré par mon caractère.
Votre rapport à l’homme en a-t-il pâti?
Non, pas du tout. J’ai cassé avec l’image de l’homme violent, puisque j’ai eu un mari merveilleux, qui a su me donner un cadre et une admiration sans bornes, pour me pousser à écrire. Alité, souffrant d’une maladie incurable, il est mort en formulant le vœu que mon livre sorte malgré le deuil. Pendant sa maladie, il tenait mon manuscrit La Cécité des rivières entre ses mains, tantôt je lui faisais la lecture, tantôt il lisait lui-même. Je ne lui ai pas fait d’enterrement religieux. Je lui ai organisé une cérémonie au crématorium et beaucoup d’hommages furent prononcés. Je l’ai habillé d’un grand boubou africain, car il avait donné sa vie à l’Afrique, et je l’ai entouré des prestigieuses décorations qu’il avait reçues. (Il était neurologue de formation et spécialiste de maladies infectieuses et tropicales. C’était le chef de service à l’hôpital d’Aix-Marseille). À la fin de mon discours, j’ai dit aux enfants: «Maintenant, la légende commence.»
L’écrivaine Paule Constant a soutenu deux thèses de doctorat à l’université de la Sorbonne et a enseigné la littérature à l’université d’Aix-Marseille, avant de se lancer corps et âme dans l’écriture. Parmi les prestigieux prix qu’elle a obtenus: le Grand prix de l’essai de l’Académie française pour son ouvrage Un monde à l’usage des demoiselles en 1987 et le prix Goncourt 1998 pour son roman Confidence pour confidence, édités chez Gallimard, comme tous ses livres. En 2019, la maison Gallimard réunit ses livres qui ont pour dénominateur commun l’Afrique, en un seul volume dans la collection Quarto, intitulé Mes Afriques. L’académicienne du jury Goncourt, élue à l’unanimité au couvert de Robert Sabatier, raconte à Ici Beyrouth sa carrière littéraire et sa vie.
Tout se joue avant six ans. Qu’est-ce qui a marqué votre enfance, puis votre adolescence?
De dix à seize ans, je suis restée chez les Dames de Saint-Maur. Je passais les vacances chez mes grands-parents qui avaient une merveilleuse propriété à sept kilomètres du couvent. Six ans, sans que je ne voie mes parents, au point que ma mère avec qui je correspondais régulièrement m’écrit un jour: comme tu me manques et comme je voudrais te rencontrer dans la rue! À l’opposé, mon père était violent et je lui tenais tête, dès l’enfance. Attention, je ne parle pas d’abus, mais de violence. J’ai vécu au sein d’une famille très religieuse, toujours entourée de moines, de prêtres. Mon frère était et demeure très traditionaliste, voire intégriste. Ma sœur consacre son temps aux activités religieuses. Enfant, mon père voulait m’obliger à lui dire «je t’aime», alors que je refusais obstinément «son éducation». À cinq ans, je me promenais dans la cour de l’hôpital et je disais à qui veut l’entendre: je n’aime pas papa. De retour, il me grondait et je récoltais une fessée d’enfer. Il m’administrait des punitions corporelles, inspirées du catholicisme peut-être. (Se mettre à genoux sur une règle, les bras en forme de croix). Mais la grande douleur de mon père a été que j’écrive.
Quel effet cela lui a fait de vous voir au faîte de la gloire ?
Chez Gallimard, Le Clézio fut mon premier lecteur, Michel Tournier mon second lecteur et Pascal Quignard, mon troisième lecteur. À mon arrivée, Pascal Quignard me demande mon nom. Mon beau-frère était l’écrivain Pierre Bourgeade. Il valait mieux choisir un autre nom. Pour Quignard, mon nom de naissance Paule Constant faisait bien l’affaire. Je fus invitée sur le plateau d’Apostrophe. Je ne connaissais pas Bernard Pivot, à l’époque. Il y avait parmi les invités, un académicien.. Pendant l’émission, ce dernier me dit: «Ah, on veut se venger de son papa», avec mépris. J’ai su par la suite que mon père l’avait appelé pour le remercier de m’avoir maltraitée et lui avait exprimé l’étendue de son estime.
Avez-vous raconté cette violence du père dans vos livres?
Oui, surtout dans La Cécité des rivières. J’ai mis treize livres pour raconter enfin l’indicible. L'un de mes livres porté au pinacle par les grandes plumes déjà citées, m'avait valu sa colère et cinq années de mutisme. En 1998, j’allais recevoir le Goncourt en novembre et la Légion d’honneur en décembre. J’ai décidé que mon père me la remettrait. J’avais imaginé qu’il n’allait rien dire de plaisant durant la cérémonie et j’ai demandé à mon mari qu’il y ait un autre discours pour pallier la faille, le cas échéant. Le jour J, toute la famille était là. Mon père arrive, avec sa silhouette impressionnante et son allure hollywoodienne. Il prononce les mots suivants: «Madame vous êtes la victime de votre enfance!» Sur son lit de mort, atteint d’un cancer qui lui défigurait la mâchoire, il m’a dit: «Ton livre est superbe, mais tu n’es pas allée assez loin.»
Qu’en est-il de votre mère? Comment vivait-elle à l’ombre de ce père et mari autoritaire?
Ma mère, très amoureuse de lui, était satisfaite de le voir partager son amour. Elle était habitée par une grande charité chrétienne, qui la rendait trop humble et modeste. Artiste-peintre, elle avait peint les vitraux de la cathédrale de Djibouti, mais elle ne se prenait pas au sérieux. Puis elle avait épousé le mâle de référence, l’acteur hollywoodien, le médecin respecté de tous. Durant l’absence de mon père, parti faire la guerre en Indochine, j’ai été extrêmement aimée, gâtée et couvée par ma mère. Mon père qui est rentré la nuit, après quatre ans d’absence, m’a trouvée dans les bras de ma mère, dormant à sa place. Alors, il a cru bon m’infliger une volée de coups, sans me parler. Je me suis levée sans pleurer ni gémir. Il a été sidéré par mon caractère.
Votre rapport à l’homme en a-t-il pâti?
Non, pas du tout. J’ai cassé avec l’image de l’homme violent, puisque j’ai eu un mari merveilleux, qui a su me donner un cadre et une admiration sans bornes, pour me pousser à écrire. Alité, souffrant d’une maladie incurable, il est mort en formulant le vœu que mon livre sorte malgré le deuil. Pendant sa maladie, il tenait mon manuscrit La Cécité des rivières entre ses mains, tantôt je lui faisais la lecture, tantôt il lisait lui-même. Je ne lui ai pas fait d’enterrement religieux. Je lui ai organisé une cérémonie au crématorium et beaucoup d’hommages furent prononcés. Je l’ai habillé d’un grand boubou africain, car il avait donné sa vie à l’Afrique, et je l’ai entouré des prestigieuses décorations qu’il avait reçues. (Il était neurologue de formation et spécialiste de maladies infectieuses et tropicales. C’était le chef de service à l’hôpital d’Aix-Marseille). À la fin de mon discours, j’ai dit aux enfants: «Maintenant, la légende commence.»
Lire aussi



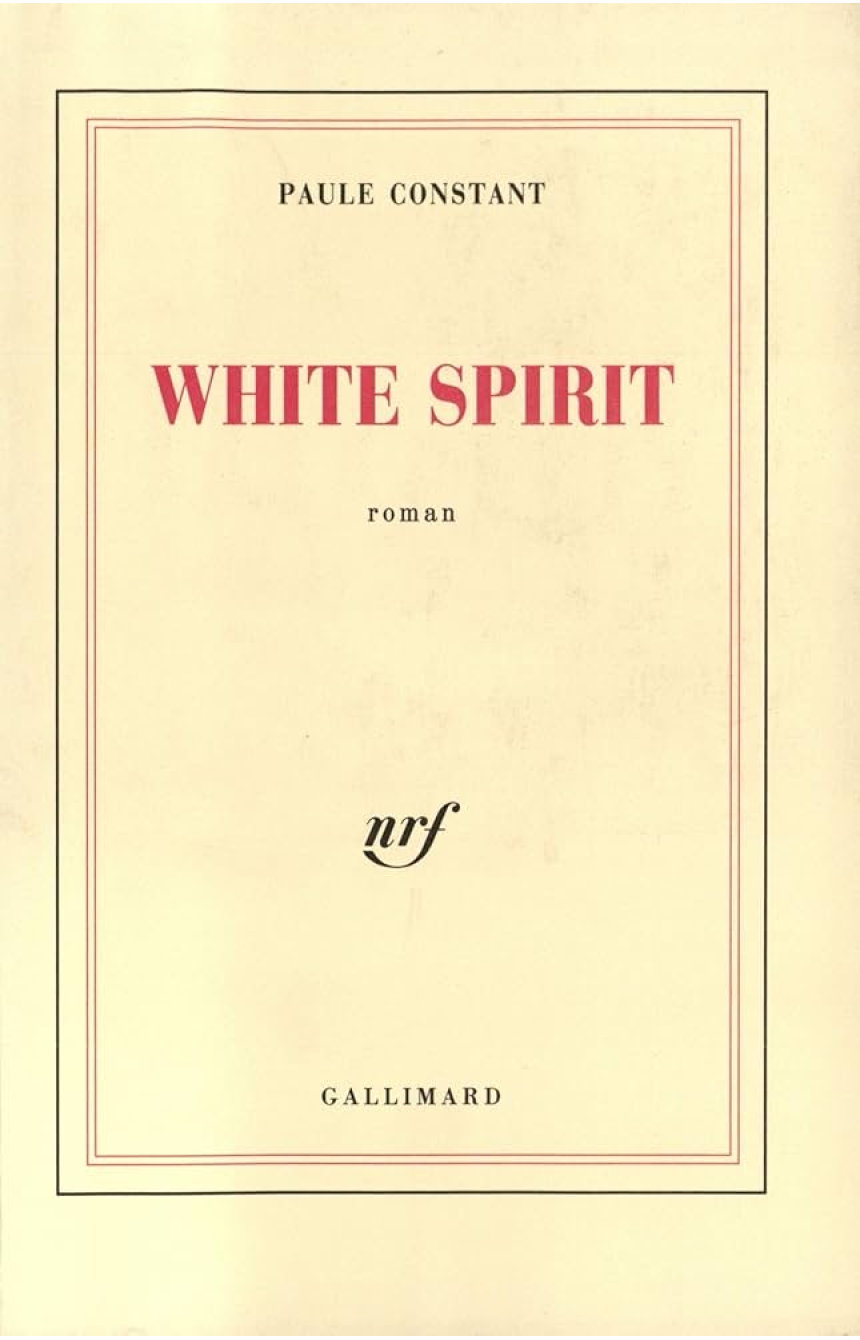



Commentaires