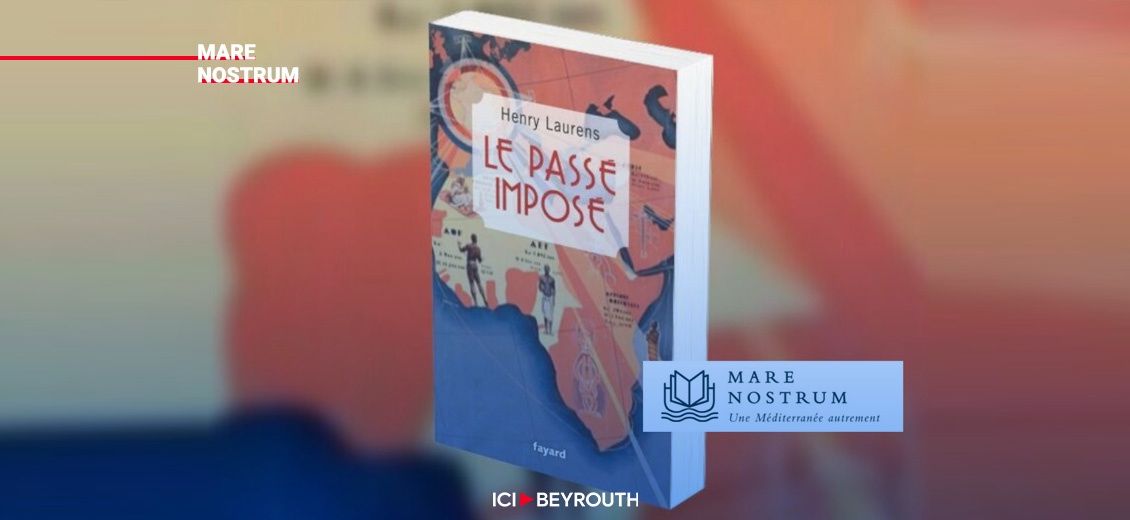
Henry Laurens est né en 1954. À la suite de très brillantes études, il obtient une agrégation suivie d’un doctorat d’État en histoire et un diplôme de l’Institut national des langues et civilisations orientales (Inalco) en arabe littéral. Il est actuellement titulaire de la chaire d’Histoire contemporaine du monde arabe au Collège de France, après avoir été enseignant à l’université du Caire, professeur à l’Inalco, directeur du Centre d’études et de recherches sur le Moyen-Orient contemporain (Cermoc) à Beyrouth, puis directeur scientifique de l’Institut français du Proche-Orient.
Après avoir écrit plus de 20 ouvrages, Henry Laurens, fait œuvre d’épistémologiste en publiant son dernier opus, Le Passé imposé, paru aux éditions Fayard. En effet, cet ouvrage qui se situe à l’intersection de trois disciplines ravira les amateurs d’histoire, de philosophie et de sociologie.
Ce livre très dense commence par un rappel des grands traits des savoirs historiques indispensables pour aborder de façon critique les discours actuels, notamment les questions mémorielles. L’auteur nous rappelle que la mémoire est également une production culturelle: l’avenir est-il déductible du passé? Qu’est-ce que le passé vécu? Le passé qui ne passe pas? L’historien n’est pas le seul maître de la représentation du passé. Henry Laurens cite Le Jour le plus long qui raconte une vision cinématographique du Débarquement. L’historien se charge du segment scientifique de l’histoire. Il est comme un juge d’instruction qui instruit à charge et à décharge. Il ne juge pas. L’objet de l’histoire est le temps. Tout est information, tout est source, même un faux demeure une source. Les historiens racontent des événements vrais, qui ont l’homme pour acteur; l’Histoire est un roman vrai. Pour Paul Veyne, l’Histoire existe au moins depuis les successeurs d’Aristote. Pour Thucydide, l’Histoire est un acquis pour toujours. Si tout est source, la source principale de l’historien est le document historique. Celui-ci est pourvu de deux dimensions: sa finalité propre (lettre d’amour, titre de possession, jugement…) et son utilisation en tant que source historique. L’historien le soumet alors à un questionnaire simple: qui, que, quoi, dont, où, avec qui, pourquoi. L’historien procède ensuite à la confrontation des sources et à leur croisement afin de déterminer ce qui s’est passé. Au passage, Henry Laurens nous indique que si la sérendipité est un trait de l’enquête historique, la qualité principale de l’historien n’est pas l’objectivité, mais l’honnêteté. Bref, il s’agit là d’un véritable «discours de la méthode» concernant le travail de l’historien, où le lecteur trouvera bien d’autres détails et exemples sur la manière de conduire ce travail.
Le deuxième chapitre est consacré à l’orientalisme et à l’occidentalisme ou le désir réciproque des Européens d’avoir des connaissances sur les sociétés ottomanes et musulmanes, et des Ottomans et musulmans de disposer d’une connaissance des sociétés européennes et occidentales. L’auteur nous indique que la comparaison des sociétés européennes et ottomanes avant 1750 montre des niveaux de production équivalents, alors que la consommation d’énergie par habitant est très largement supérieure en Europe, ainsi que dans la maîtrise des arts mécaniques (horlogerie…). La différence majeure réside dans les pratiques de l’écrit. Les Ottomans en sont restés – pour l’essentiel – à la culture du manuscrit, donc d’une petite diffusion réservée à une petite élite. Chez les Ottomans, il n’existe pas de textes écrits sur les sociétés européennes. La porosité des savoirs européens en direction des Ottomans passe par certains chrétiens orientaux qui maîtrisent les langues et naviguent entre les deux mondes. Henry Laurens détaille l’importance des drogmans des deux bords – il s’agit d’interprètes ayant parfois rang de diplomates. Mais le sentiment de supériorité des musulmans lié à la certitude de posséder la «vraie religion» et une meilleure moralité (l’auteur ajoute une meilleure hygiène corporelle) fonde toutes les approches du monde.
En revanche, en Occident, les recherches sur la production écrite des Orientaux se développent vraiment dès la Renaissance avec l’étude du turc, du persan et de l’arabe. Antoine Galland (1646-1715) est le premier à traduire les Mille et une Nuits. La littérature de voyage, les récits de pèlerinages et la narration des aventures de voyageurs, permettent la comparaison entre le «chez nous» et le «chez eux». Les considérations politiques s’en mêlent: c’est le commencement de ce que l’on appellera plus tard la géopolitique. À cela s’ajoute l’œuvre des drogmans et des diplomates: l’Orient est devenu une réalité quasi quotidienne dans le monde de l’imprimé de l’Europe du XVIIIᵉ siècle. En Chine et dans l’Empire ottoman, il n’existe pas d’hérédité des fonctions d’autorité, ce qui choque les noblesses européennes. Un esclave peut devenir grand vizir de l’Empire ottoman (comme Kheireddine Pacha en 1878). En Chine, les fonctionnaires sont recrutés sur concours. Mais si l’Occident a réussi à construire son Histoire, qui porte sur l’ensemble du monde, en créant l’ethnologie et l’anthropologie, l’auteur observe, au fil du temps, le rapprochement des deux mondes qui vivent de plus en plus au même rythme.
Dans un troisième chapitre, l’auteur fait un grand tour des violences des XXᵉ et XXIᵉ siècles où les périodes de «dé-civilisations» se sont multipliées. Il propose une analyse fine et documentée des meurtres de masse et épurations ethniques. Les pays civilisés devraient savoir dissocier l’étranger que l’on confond avec l’ennemi. Les guerres en cours ne connaissent pas de limites. Hannah Arendt pense que les violences coloniales sont à l’origine des violences du XXᵉ siècle. La guerre entre primitifs et civilisés (ou ceux qui s’imaginent comme tels) dont parle Freud, serait l’une des matrices de la violence européenne. Les premiers camps de concentration sont inaugurés à Cuba par les Espagnols en 1895, suivis des Britanniques durant la guerre des Boers. Plus près de nous, l’enjeu du conflit ukrainien n’est pas seulement territorial, car il risque d’enclencher un nouveau processus de «dé-civilisation», dont le prix sera cette fois incalculable.
Henry Laurens conclut dans un dernier chapitre intitulé «Le passé imposé» par une analyse géopolitique très argumentée sur le monde actuel. Ce «passé imposé» serait pour la période présente la résultante de l’évolution des sociétés, des contraintes laissées en héritage, des souffrances mémorielles des guerres, qu’elles soient de religions, d’attritions ou de conquêtes.
Pour conclure sur cet essai passionnant et de haut vol, laissons la parole à l’auteur:
«Toutes ces mémoires ont leurs places dans le roman national. Il faut cependant refuser de se faire imposer un passé pris d’abord comme une arme de combat, savoir vibrer au sacre de Reims comme à la fête de la Fédération, et comprendre que l’histoire coloniale est l’introduction à l’histoire de notre société présente, mais non sa continuité. Pour reprendre Marc Bloch, nous sommes plus des enfants de notre temps que de nos parents.»
Cet ouvrage indispensable est un véritable discours sur la méthode cernant la façon d’appréhender l’Histoire, afin de la restituer et de la comprendre.
Par Dominique Verron
Le Passé imposé d'Henry Laurens, Fayard, 2022, 253 p.
Cet article a été originalement publié sur le blog Mare Nostrum.
Après avoir écrit plus de 20 ouvrages, Henry Laurens, fait œuvre d’épistémologiste en publiant son dernier opus, Le Passé imposé, paru aux éditions Fayard. En effet, cet ouvrage qui se situe à l’intersection de trois disciplines ravira les amateurs d’histoire, de philosophie et de sociologie.
Ce livre très dense commence par un rappel des grands traits des savoirs historiques indispensables pour aborder de façon critique les discours actuels, notamment les questions mémorielles. L’auteur nous rappelle que la mémoire est également une production culturelle: l’avenir est-il déductible du passé? Qu’est-ce que le passé vécu? Le passé qui ne passe pas? L’historien n’est pas le seul maître de la représentation du passé. Henry Laurens cite Le Jour le plus long qui raconte une vision cinématographique du Débarquement. L’historien se charge du segment scientifique de l’histoire. Il est comme un juge d’instruction qui instruit à charge et à décharge. Il ne juge pas. L’objet de l’histoire est le temps. Tout est information, tout est source, même un faux demeure une source. Les historiens racontent des événements vrais, qui ont l’homme pour acteur; l’Histoire est un roman vrai. Pour Paul Veyne, l’Histoire existe au moins depuis les successeurs d’Aristote. Pour Thucydide, l’Histoire est un acquis pour toujours. Si tout est source, la source principale de l’historien est le document historique. Celui-ci est pourvu de deux dimensions: sa finalité propre (lettre d’amour, titre de possession, jugement…) et son utilisation en tant que source historique. L’historien le soumet alors à un questionnaire simple: qui, que, quoi, dont, où, avec qui, pourquoi. L’historien procède ensuite à la confrontation des sources et à leur croisement afin de déterminer ce qui s’est passé. Au passage, Henry Laurens nous indique que si la sérendipité est un trait de l’enquête historique, la qualité principale de l’historien n’est pas l’objectivité, mais l’honnêteté. Bref, il s’agit là d’un véritable «discours de la méthode» concernant le travail de l’historien, où le lecteur trouvera bien d’autres détails et exemples sur la manière de conduire ce travail.
Le deuxième chapitre est consacré à l’orientalisme et à l’occidentalisme ou le désir réciproque des Européens d’avoir des connaissances sur les sociétés ottomanes et musulmanes, et des Ottomans et musulmans de disposer d’une connaissance des sociétés européennes et occidentales. L’auteur nous indique que la comparaison des sociétés européennes et ottomanes avant 1750 montre des niveaux de production équivalents, alors que la consommation d’énergie par habitant est très largement supérieure en Europe, ainsi que dans la maîtrise des arts mécaniques (horlogerie…). La différence majeure réside dans les pratiques de l’écrit. Les Ottomans en sont restés – pour l’essentiel – à la culture du manuscrit, donc d’une petite diffusion réservée à une petite élite. Chez les Ottomans, il n’existe pas de textes écrits sur les sociétés européennes. La porosité des savoirs européens en direction des Ottomans passe par certains chrétiens orientaux qui maîtrisent les langues et naviguent entre les deux mondes. Henry Laurens détaille l’importance des drogmans des deux bords – il s’agit d’interprètes ayant parfois rang de diplomates. Mais le sentiment de supériorité des musulmans lié à la certitude de posséder la «vraie religion» et une meilleure moralité (l’auteur ajoute une meilleure hygiène corporelle) fonde toutes les approches du monde.
En revanche, en Occident, les recherches sur la production écrite des Orientaux se développent vraiment dès la Renaissance avec l’étude du turc, du persan et de l’arabe. Antoine Galland (1646-1715) est le premier à traduire les Mille et une Nuits. La littérature de voyage, les récits de pèlerinages et la narration des aventures de voyageurs, permettent la comparaison entre le «chez nous» et le «chez eux». Les considérations politiques s’en mêlent: c’est le commencement de ce que l’on appellera plus tard la géopolitique. À cela s’ajoute l’œuvre des drogmans et des diplomates: l’Orient est devenu une réalité quasi quotidienne dans le monde de l’imprimé de l’Europe du XVIIIᵉ siècle. En Chine et dans l’Empire ottoman, il n’existe pas d’hérédité des fonctions d’autorité, ce qui choque les noblesses européennes. Un esclave peut devenir grand vizir de l’Empire ottoman (comme Kheireddine Pacha en 1878). En Chine, les fonctionnaires sont recrutés sur concours. Mais si l’Occident a réussi à construire son Histoire, qui porte sur l’ensemble du monde, en créant l’ethnologie et l’anthropologie, l’auteur observe, au fil du temps, le rapprochement des deux mondes qui vivent de plus en plus au même rythme.
Dans un troisième chapitre, l’auteur fait un grand tour des violences des XXᵉ et XXIᵉ siècles où les périodes de «dé-civilisations» se sont multipliées. Il propose une analyse fine et documentée des meurtres de masse et épurations ethniques. Les pays civilisés devraient savoir dissocier l’étranger que l’on confond avec l’ennemi. Les guerres en cours ne connaissent pas de limites. Hannah Arendt pense que les violences coloniales sont à l’origine des violences du XXᵉ siècle. La guerre entre primitifs et civilisés (ou ceux qui s’imaginent comme tels) dont parle Freud, serait l’une des matrices de la violence européenne. Les premiers camps de concentration sont inaugurés à Cuba par les Espagnols en 1895, suivis des Britanniques durant la guerre des Boers. Plus près de nous, l’enjeu du conflit ukrainien n’est pas seulement territorial, car il risque d’enclencher un nouveau processus de «dé-civilisation», dont le prix sera cette fois incalculable.
Henry Laurens conclut dans un dernier chapitre intitulé «Le passé imposé» par une analyse géopolitique très argumentée sur le monde actuel. Ce «passé imposé» serait pour la période présente la résultante de l’évolution des sociétés, des contraintes laissées en héritage, des souffrances mémorielles des guerres, qu’elles soient de religions, d’attritions ou de conquêtes.
Pour conclure sur cet essai passionnant et de haut vol, laissons la parole à l’auteur:
«Toutes ces mémoires ont leurs places dans le roman national. Il faut cependant refuser de se faire imposer un passé pris d’abord comme une arme de combat, savoir vibrer au sacre de Reims comme à la fête de la Fédération, et comprendre que l’histoire coloniale est l’introduction à l’histoire de notre société présente, mais non sa continuité. Pour reprendre Marc Bloch, nous sommes plus des enfants de notre temps que de nos parents.»
Cet ouvrage indispensable est un véritable discours sur la méthode cernant la façon d’appréhender l’Histoire, afin de la restituer et de la comprendre.
Par Dominique Verron
Le Passé imposé d'Henry Laurens, Fayard, 2022, 253 p.
Cet article a été originalement publié sur le blog Mare Nostrum.
Lire aussi



Commentaires