
Les droits de douane sont redevenus l’outil central de la politique commerciale américaine. La Maison Blanche a annoncé jeudi une refonte majeure des tarifs douaniers, marquant une nouvelle étape dans la stratégie protectionniste du président Donald Trump.
Dans un communiqué officiel, la Maison Blanche explique que ces mesures visent à «protéger les travailleurs américains» et à «sécuriser des relations commerciales réciproques et équilibrées» après des décennies de déficits commerciaux jugés «insoutenables» pour l’économie et la sécurité nationale des États-Unis.
Cette politique repose sur une idée simple: en rendant plus coûteuses les importations étrangères, Washington espère inciter les entreprises à rapatrier leur production sur le sol américain et à réinvestir dans les industries locales.
Des hausses tarifaires massives et ciblées
Depuis le 2 avril, Donald Trump a déclenché une série de hausses douanières: initialement, un tarif plancher de 10% s'appliquait par défaut à toutes les importations, sauf pour certains pays explicitement exemptés, tandis que des surtaxes spécifiques, allant jusqu’à 50%, étaient imposées à une majorité de partenaires commerciaux ciblés.
Ce jeudi, il a franchi un cap supplémentaire: près de 70 pays sont désormais visés par des tarifs renforcés, avec des droits allant jusqu’à 41% pour certains partenaires commerciaux.
Le Canada, voisin et allié historique, subit une hausse spectaculaire à 35% – contre 25% auparavant. Ces mesures sont justifiées par la Maison Blanche à la fois par des considérations économiques et sécuritaires: les déficits commerciaux chroniques seraient une «menace» pour la défense industrielle américaine.
Certaines décisions revêtent également une dimension politique. Donald Trump a publiquement lié la sanction contre le Canada à la décision de son Premier ministre, Mark Carney, d’annoncer son soutien à la reconnaissance d’un État palestinien à l’ONU en septembre.
«Cela rendra très difficile la conclusion d’un accord commercial avec eux», a-t-il écrit sur Truth Social, soulignant combien les droits de douane sont désormais utilisés comme levier diplomatique autant qu’économique.
À l’inverse, certains pays bénéficient de traitements préférentiels après des négociations intenses.
Le Japon et l’Union européenne ont accepté non seulement de s’acquitter d’un tarif de base de 15%, mais aussi de conclure de vastes accords d’investissements.
Selon la Maison Blanche, l’UE s’engage à acheter 750 milliards de dollars d’énergie américaine et à investir 600 milliards supplémentaires aux États-Unis d’ici à 2028, tandis que le Japon promet 550 milliards d’investissements.
Un bouleversement des règles du commerce international
Ces hausses tarifaires traduisent une remise en cause frontale de l’ordre commercial mondial hérité de l’après-guerre.
«Pas de doute: le décret exécutif et les accords conclus ces derniers mois déchirent le livre des règles commerciales qui gouvernaient l’échange international depuis la Seconde Guerre mondiale», souligne Wendy Cutler, vice-présidente de l’Asia Society Policy Institute, citée par l’AFP.
Depuis le lancement de ces tarifs réciproques, la Maison Blanche pratique une politique de donnant-donnant: les pays qui négocient obtiennent des tarifs plus bas et un accès au marché américain, tandis que ceux qui refusent de faire des concessions subissent des droits punitifs.
Le décret signé par Donald Trump prévoit même une surtaxe de 40% pour les marchandises transbordées via des pays tiers pour échapper aux droits américains.
La liste des ajustements tarifaires montre que cette approche est très granulaire: 39% pour la Suisse, 20% pour Taiwan (contre 32% précédemment), et 19% pour le Cambodge et la Thaïlande, bien en deçà des 49% et 36% initialement envisagés.
La Chine, quant à elle, dispose d’un répit jusqu’au 12 août: les droits pourraient alors remonter si Pékin et Washington ne prolongent pas leur trêve tarifaire.
Entre opportunités industrielles et risques économiques
Pour Donald Trump, ces droits de douane constituent un instrument économique et politique incontournable. «Sans droits de douane, l’économie américaine n’a aucune chance de survie ou de succès», a-t-il affirmé.
La Maison Blanche met en avant des résultats tangibles: un afflux d’investissements, des projets de relocalisation industrielle et des emplois manufacturiers censés revenir dans les régions dévastées par la désindustrialisation.
Les partisans de cette politique soulignent que les recettes douanières sont en forte hausse et que les relocalisations en cours renforceront la sécurité des chaînes d’approvisionnement.
De plus, l’exécutif encourage explicitement les entreprises étrangères à contourner ces droits en produisant directement aux États-Unis, promettant des procédures administratives «rapides et professionnelles» pour faciliter les implantations.
Mais ces mesures comportent aussi des risques économiques majeurs. Selon une analyse de l’American Enterprise Institute (AEI), la formule utilisée par l’administration pour calculer ces tarifs «réciproques» repose sur une erreur qui multiplie par quatre les taux réellement justifiés.
Si cette erreur est corrigée, la plupart des surtaxes tomberont à 10‑14%, loin des 25 à 50% annoncés. Cette surestimation accroît la volatilité des marchés: après l’annonce de ces tarifs en avril, le S&P 500 a chuté de 9%, et la probabilité d’une récession a été revue à la hausse. Pour l’AEI, ces droits de douane risquent de fragiliser l’économie américaine au lieu de la renforcer.
Les droits de douane ne sont donc plus un simple instrument fiscal ou de régulation du commerce: ils sont devenus l’axe central d’une diplomatie économique américaine qui conjugue politique intérieure, stratégie industrielle et rapports de force géopolitiques.


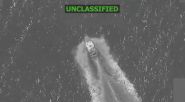

Commentaires