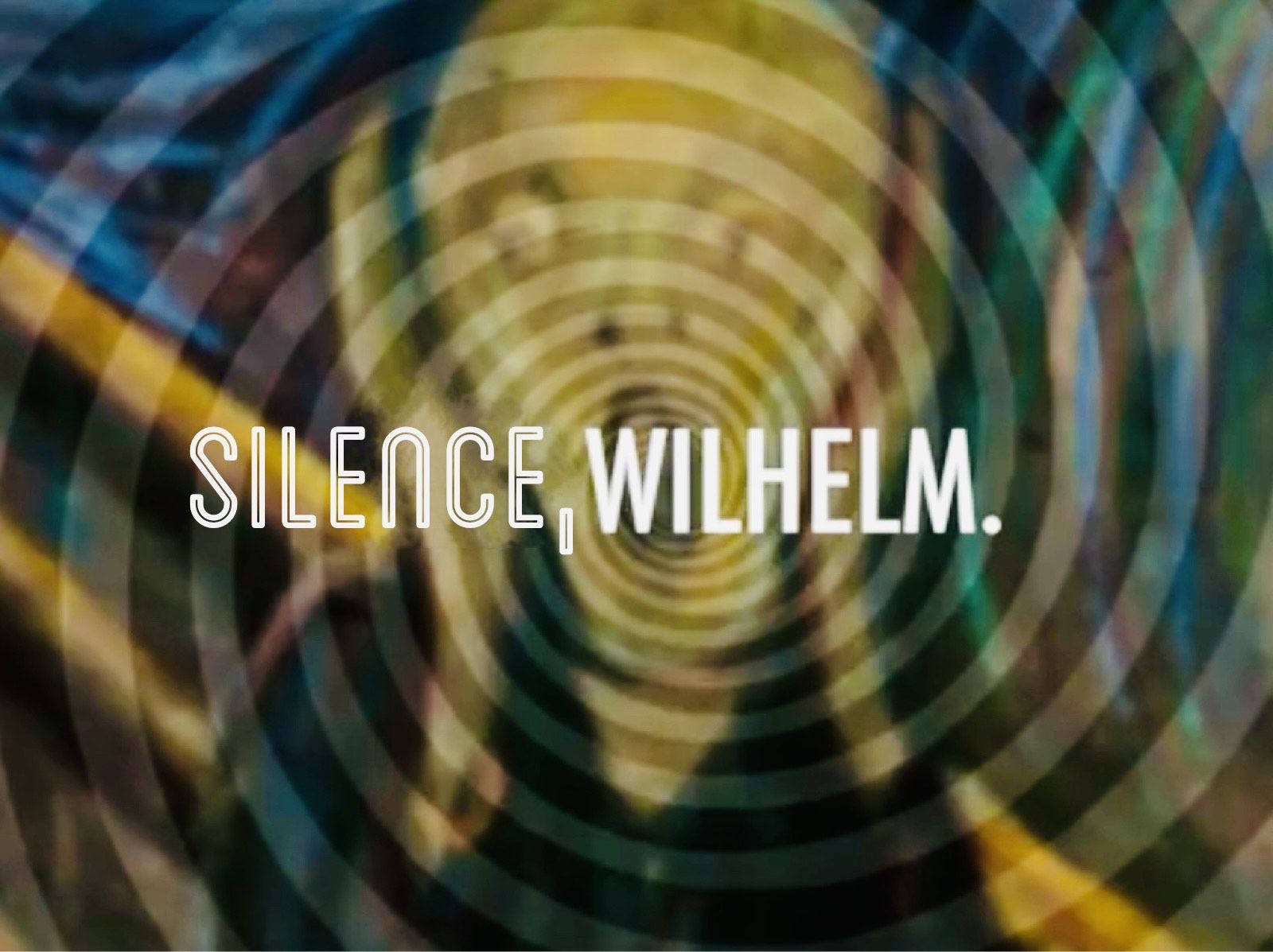
Utilisé dans plus de 500 films et productions, ce cri strident est devenu l’un des plus grands clins d’œil sonores du cinéma. Derrière ce hurlement exagéré, se cache une histoire de studio, d’archives sonores et de complicité entre créateurs.
Il dure à peine deux secondes. Il jaillit en plein chaos, lors d’une chute, d’une explosion ou d’une attaque surprise. Ce cri, que vous avez entendu des centaines de fois sans jamais le remarquer vraiment, s’appelle le «Wilhelm scream». Il est, à ce jour, le son le plus recyclé de l’histoire du cinéma. De Star Wars à Indiana Jones, de Kill Bill à Toy Story, il a traversé les décennies comme une blague sonore, un clin d’œil entre initiés, un totem caché au cœur des plus grands blockbusters. Comment un simple hurlement enregistré au début des années 1950 a-t-il réussi à devenir une légende hollywoodienne?
L’histoire commence en 1951, sur le tournage du film Distant Drums (Les Aventures du capitaine Wyatt), une production Warner Bros avec Gary Cooper. Une scène met en scène un soldat attaqué par un alligator dans un marécage. Il pousse un cri. Ou plutôt, il est censé le faire. Comme souvent à l’époque, les sons sont ajoutés en postproduction. Un comédien de studio – probablement Sheb Wooley – est alors enregistré en train de produire plusieurs cris de douleur. L’un d’entre eux, le quatrième, est conservé dans les archives sonores du studio.
L’anecdote pourrait s’arrêter là, mais ce cri va réapparaître deux ans plus tard dans un western intitulé The Charge at Feather River (La Charge sur la rivière rouge, 1953). Lorsqu’un personnage secondaire, nommé Wilhelm, reçoit une flèche dans la jambe, le hurlement est réutilisé tel quel. Ce sera la première fois qu’il sera associé à un nom. Le «Wilhelm scream» était né.
Le gag sonore devenu icône
Durant les décennies suivantes, Warner Bros continue d’utiliser le même effet sonore. Il devient une solution pratique et économique, à une époque où enregistrer de nouveaux sons coûte cher. On l’entend dans Them! (Des monstres attaquent la ville), A Star is Born (Une étoile est née, version 1954), ou encore The Green Berets (Les Bérets verts).
Mais c’est dans les années 1970 que le cri prend une tout autre dimension. Le responsable? Ben Burtt, ingénieur du son recruté par George Lucas pour concevoir les effets sonores de Star Wars (1977). Passionné par les sons d’archives, Burtt redécouvre le cri de Wilhelm et décide de l’intégrer dans une scène de la saga galactique. Un soldat de l’Empire chute dans un précipice… et pousse exactement le même cri qu’un cow-boy des années 1950. Le clin d’œil est discret, mais remarqué par les fans et les collègues de Burtt. Dès lors, l’effet devient un running gag sonore, repris dans Raiders of the Lost Ark (Les Aventuriers de l’arche perdue), Willow, Gremlins 2, Batman Returns, Reservoir Dogs, Pirates of the Caribbean, The Avengers, et jusqu’à Indiana Jones and the Dial of Destiny (Le Cadran de la destinée, 2023).
Ce cri de détresse caricatural, souvent exagéré, devient une marque de fabrique, un fil rouge discret qui relie les films entre eux. Les ingénieurs du son l’incluent parfois à dessein, parfois par tradition. Il traverse même les genres et les formats: séries télé, dessins animés, jeux vidéo, bandes-annonces... rien ne lui échappe. On l’entend dans The Lord of the Rings, Ice Age, Toy Story, Kung Fu Panda, Doctor Who, Family Guy, Call of Duty, ou Baldur’s Gate III. Il surgit souvent dans des scènes secondaires, où un personnage est projeté, frappé ou disparaît dans le décor. Le hurlement arrive alors, familier, drôle, presque attendrissant dans sa persistance.
Le «Wilhelm scream» est devenu une blague à l’échelle industrielle. Certains spectateurs traquent désormais ses apparitions comme des Easter eggs. Des sites et forums lui sont dédiés. Il est même parfois utilisé à contresens, dans des scènes dramatiques ou intenses, pour ajouter une touche d’ironie imperceptible.
Aujourd’hui, le son original est libre de droits, ce qui facilite sa réutilisation. Mais son succès ne tient pas qu’à sa gratuité: il est devenu un symbole de continuité entre générations de cinéastes et de techniciens. Une manière de signer discrètement un film, comme un graffito sonore niché au cœur de la bande-son.
Sheb Wooley, s’il est bien l’auteur de ce cri mythique, n’a probablement jamais imaginé qu’il serait immortalisé de cette façon. Décédé en 2003, cet acteur et chanteur de country restera peut-être davantage connu pour ce hurlement que pour toute sa filmographie.
Le cri de Wilhelm n’a rien d’un exploit technique, mais il rappelle que le cinéma, même dans ses marges sonores, construit sa mémoire et sa mythologie à coups de répétitions, de clins d’œil et d’hommages ludiques.

Commentaires