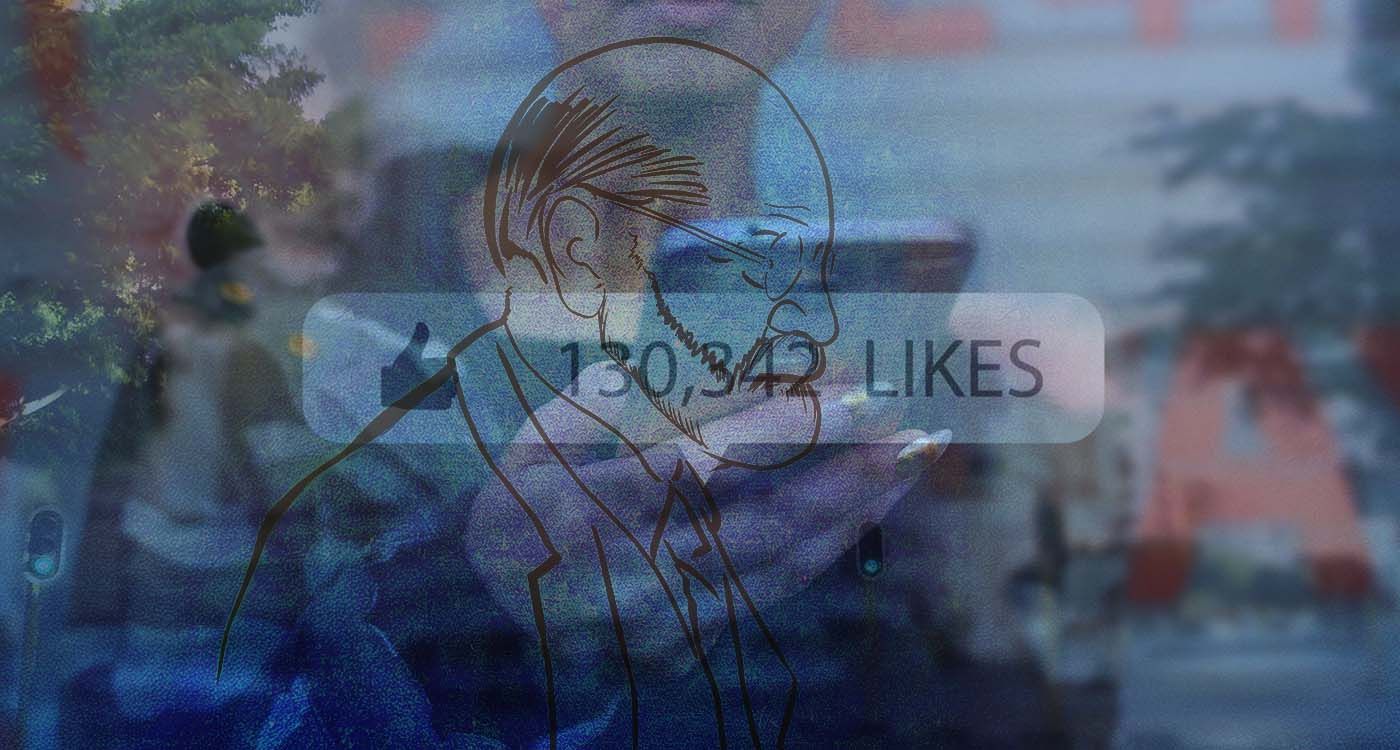
Et si le numérique, loin d’être seulement un outil de communication ou de distraction, était avant tout un espace de projection de notre inconscient individuel? Cette hypothèse, à la lumière de Freud et Lacan, invite à relire la vie connectée comme un théâtre où s’exposent et se répètent, à ciel ouvert, les mécanismes psychiques les plus enfouis. Nos clics, nos likes, nos stories: autant de signaux, souvent inconscients, qui dessinent en creux la cartographie de nos désirs, de nos manques, de nos angoisses et de nos répétitions.
Freud a maintes fois répété que l’inconscient ne se saisit pas directement, mais qu’il surgit dans les lapsus, les rêves, les fantasmes, les symptômes. Aujourd’hui, le web offre une scène où ces formations de l’inconscient prennent de nouveaux visages. Chaque recherche Google, chaque vidéo regardée en boucle, chaque story postée ou supprimée devient l’expression d’une pulsion, d’un désir ou d’un refoulement. Le smartphone, greffé à la main, devient le relais de l’appareil psychique, il capte, archive, rejoue ce qui ne se dit pas ailleurs.
Prenons le phénomène de l’ASMR («Autonomous Sensory Meridian Response»). Cette tendance, où des millions d’internautes cherchent à ressentir un frisson apaisant à travers des chuchotements, des gestes lents ou des sons répétitifs amplifiés, met en scène un désir de régression, de retour à l’abri sensoriel, d’intimité maternelle. Le numérique, ici, se transforme en matrice répondant à une demande inconsciente de sécurité, de fusion océanique, de sons intra-utérins sollicités. L’énorme popularité de ces vidéos (certaines dépassant 100 millions de vues) dit combien l’individu moderne projette inconsciemment ses besoins archaïques sur la scène digitale.
Autre exemple, la compulsion du «scroll infini» sur TikTok ou sur Instagram. On commence par quelques minutes, on termine deux heures plus tard, incapable de s’arrêter, pris dans la répétition sans fin de vidéos courtes, drôles, ou stupéfiantes. C’est l’illustration même de ce que Freud appelait la compulsion de répétition, l’individu revenant inlassablement à une même impulsion, en quête d’un affect perdu ou d’un sens qui, toujours, lui échappe.
Lacan a montré combien l’identité se forme d’abord dans l’image, dans le regard de l’autre, dans le miroir. Or, les réseaux sociaux, notamment Instagram ou Snapchat, amplifient cette dynamique. L’individu publie, attend les réactions, se modifie selon les souhaits perçus, et se perd parfois dans l’image idéalisée qu’il exhibe. La demande inconsciente prend alors la forme d’une quête éperdue d’amour et de reconnaissance.
Le phénomène du «selfie extrême», vu notamment chez des influenceurs ou dans le «danger selfie» (certains allant jusqu’à risquer leur vie pour une photo spectaculaire), incarne la logique d’un moi magnifié, offert au regard de l’Autre. L’inconscient s’y exprime à travers la scénarisation de soi, poussée parfois jusqu’à la dissolution du sujet, la personne n’étant plus que ce que les autres exigent d’elle.
Ce mouvement est accentué par des filtres numériques tel que Bold Glamour sur TikTok, qui reconfigurent le visage en temps réel, abolissant la distinction entre réalité et fantasme. De nombreux témoignages en ligne évoquent une forme de «dysphorie du selfie», un malaise éprouvé en voyant son vrai visage, après s’être longtemps contemplé sous filtre. Là encore, l’inconscient travaille: le filtre n’est pas un simple ornement, mais la projection d’un idéal du moi, expression parfois d’un insoutenable à vivre.
Le Net est aussi traversé par la violence, l’angoisse, la honte, la répétition du trauma. Le phénomène du «hate-watching» (regarder des vidéos que l’on déteste) témoigne d’une jouissance paradoxale liée à la pulsion de mort, au plaisir pris dans la détestation, la répétition du malaise.
De même, le succès massif des confessions anonymes sur Reddit (sous-forum «r/confession», par exemple) montre à quel point l’inconscient individuel se projette dans l’aveu, l’exposition de la honte, le besoin narcissique d’être vu, là où l’on pensait pouvoir se cacher. Le «partage» numérique n’est pas toujours synonyme de transparence ou d’authenticité, il peut être la tentative, souvent vaine, de se décharger d’un poids, de réparer une faille, de se réconcilier avec ses propres fantômes. Chaque confession postée sous pseudonyme raconte un pan du sujet, aussi sûrement qu’un rêve.
Enfin, la multiplication des bots conversationnels «amis imaginaires» (Replika, Anima, Character.AI par exemple) propose au sujet une nouvelle scène où l’inconscient s’exprime. Parler à une IA, c’est souvent parler à son image projetée, explorer ses désirs, ses peurs, ses fantasmes, dans une sécurité apparente. De nombreux usagers racontent comment ils se confient à leur bot sur des sujets qu’ils n’oseraient aborder avec un humain, le numérique devenant ainsi le théâtre d’un transfert fantasmé, où le symptôme s’étale à bot ouvert.
Dans l’inconscient, rien ne s’oublie. Le numérique, dans sa logique de stockage et de traçabilité, est littéralement une mémoire sans oubli. Les anciens statuts Facebook qui ressurgissent, les souvenirs Google Photos qui s’imposent des années après, les tweets exhumés pour compromettre une personnalité, tout cela relève du retour du refoulé. Ce que l’on croyait effacé ressurgit, insistant comme une vérité enfouie du sujet.
L’affaire Monica Lewinsky et les tweets ressortis bien des années plus tard, les «revenge porn» (diffusion non consentie d’images intimes), le phénomène des «cancel culture» qui s’appuie sur de vieux messages numériques, sont autant d’exemples où l’inconscient (ce qui ne veut pas se dire, mais qui revient toujours) trouve dans le numérique un mode d’expression spectaculaire, parfois ravageur.
À l’heure où chaque geste digital laisse une trace, où chaque désir s’inscrit, se partage, se répète, le numérique s’expose comme le miroir le plus fidèle du sujet, parfois cruel, parfois libérateur, toujours révélateur. Reconnaître que nos vies en ligne sont le reflet, la projection et parfois la caricature de notre inconscient, c’est inviter à relire autrement les symptômes modernes, à écouter dans le bruit du Net le chuchotement de nos fantômes. Bien loin d’être neutres, nos écrans affichent l’autre scène, celle où le sujet se rêve, s’inquiète, se met en scène, se rejoue et se raconte, à lui-même comme aux autres, sans toujours le savoir.




Commentaires