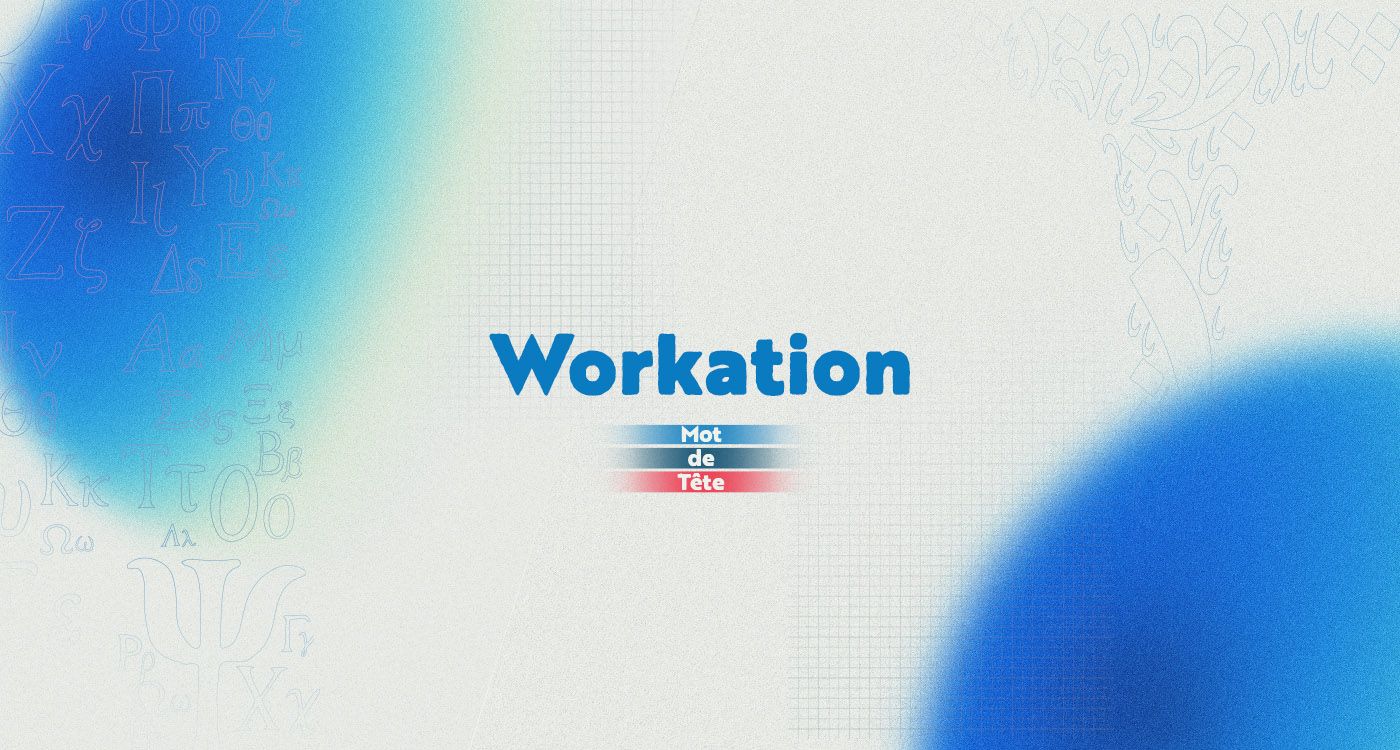
En brouillant la frontière entre loisir et travail, le «workation» est devenu un mot-clé de l’ère post-Covid. Plus qu’un simple effet de mode, il reflète la manière dont le nomadisme digital, les modèles hybrides et la quête d’équilibre redessinent la culture du travail à l’échelle mondiale.
Mi-congé, mi-bureau, le «workation» s’impose comme un marqueur des transformations profondes du travail après la pandémie de la Covid. Ce néologisme attrayant amène une question sérieuse: comment concilier productivité, quête de liberté et droit à la déconnexion?
Un marqueur linguistique de notre époque
Issu de la contraction des mots anglais work (travail) et vacation (vacances), le terme «workation» s’est imposé dans le vocabulaire du travail flexible. Déjà sélectionné en 2020 par l’Oxford Dictionaries parmi les néologismes emblématiques de la pandémie, il continue de circuler dans la presse internationale et s’installe dans l’usage francophone, souvent employé tel quel comme anglicisme masculin.
Le principe est simple: emporter son ordinateur et ses réunions virtuelles dans un cadre de villégiature – au bord de la mer, à la montagne ou dans une maison de campagne – sans pour autant interrompre ses obligations professionnelles. Contrairement au congé classique, on reste «en activité», mais l’environnement se transforme.
En France, selon l’Institut national de la statistique et des études économiques (Insee), 22% des salariés du secteur privé télétravaillaient au moins une fois par mois en 2024. Le service statistique du ministère français du Travail (Dares) rappelle qu’en cinq ans, la proportion de télétravailleurs occasionnels est passée de 9% en 2019 à 26% en 2023.
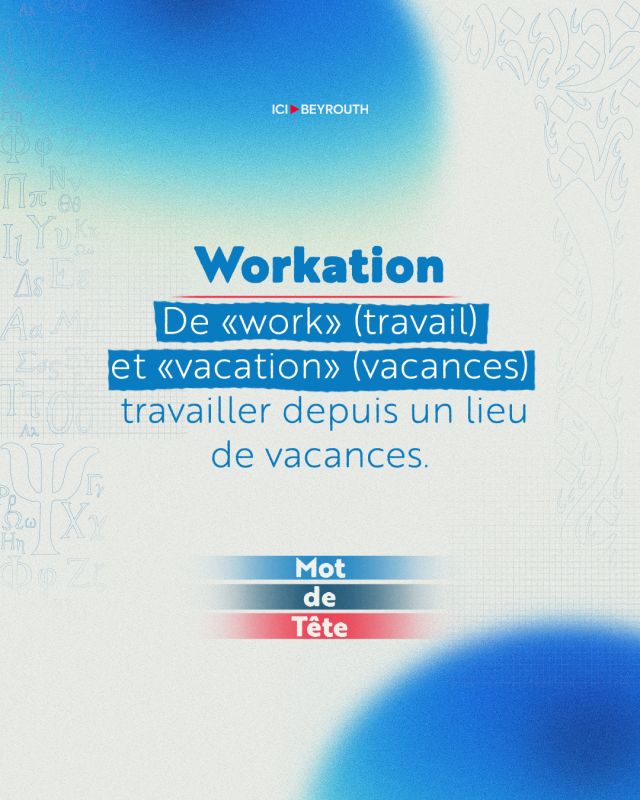
Au Canada, les tendances sont similaires, même si les chiffres diffèrent. Statistics Canada indique qu’en novembre 2024, 12,5% des salariés travaillaient exclusivement à domicile, tandis que 11,5% adoptaient un modèle hybride. Parmi ces derniers, plus de la moitié (55,8%) passaient la majorité de leurs heures de travail hors de leur domicile, une hausse de 4,2 points par rapport à l’année précédente. Selon Statistics Canada, près de 39% des emplois du pays sont considérés comme «télétravaillables», ce qui montre que le potentiel de généralisation reste limité mais significatif.
En Belgique, une enquête menée en 2024 par SD Worx révèle que 26% des salariés aimeraient tenter l’expérience du «workation», une aspiration partagée par 40% des moins de 40 ans. Mais seuls 9% déclarent en avoir la possibilité effective au sein de leur organisation.
Ces chiffres confirment que le «workation» et, plus largement, le nomadisme digital (digital nomad) ne sont plus des pratiques marginales mais bien des tendances durables qui redessinent la culture du travail.
Les promesses et les pièges d’un nouveau modèle
Pour ses défenseurs, le «workation» est un antidote à l’épuisement professionnel (burnout). Changer d’air sans interrompre son activité permettrait de stimuler la créativité, de renforcer la motivation et même de gagner en efficacité. Une étude citée par plusieurs plateformes spécialisées révèle que 86% des personnes ayant testé ce modèle se sont senties plus productives. Certaines entreprises ont déjà intégré des formules de «workation» à leurs politiques, séduites par l’argument d’attractivité auprès des talents.
Mais les experts mettent en garde contre les dérives. Psychologues et coachs rappellent que travailler depuis un lieu de vacances n’équivaut pas à prendre des congés. Si les frontières entre vie professionnelle et personnelle s’effacent complètement, le risque est de ne jamais décrocher, au détriment de la santé mentale. Le «workation» peut alors se transformer en simple transposition du bureau sous le soleil, où l’ordinateur supplante le parasol.
Les inégalités d’accès accentuent également les clivages: cette formule reste surtout accessible aux cadres et aux indépendants dont les tâches sont dématérialisées. Elle demeure hors de portée pour les professions nécessitant une présence physique: enseignants, soignants, ouvriers.
Enfin, le «workation» soulève des enjeux juridiques et fiscaux complexes. Travailler temporairement depuis l’étranger implique des règles différentes en matière de droit du travail, d’assurances, de fiscalité et de protection des données. En Belgique, des spécialistes recommandent d’encadrer strictement la durée et les modalités pour éviter toute insécurité juridique. De fait, beaucoup d’employeurs hésitent encore à formaliser cette pratique.
Le paradoxe moderne: liberté ou nouvelle servitude?
Le «workation» incarne une ambivalence au cœur des sociétés numériques. Pour certains, il offre la possibilité de voyager sans sacrifier sa carrière, voire de devenir digital nomad à plein temps. Pour d’autres, il traduit une extension du domaine du travail, qui ne connaît plus de frontières temporelles ou géographiques. En rendant possible le bureau «partout», il rend plus difficile le droit à la déconnexion, pourtant inscrit dans la législation française depuis 2017.
Au fond, peut-être que le vrai luxe, aujourd’hui, n’est pas de travailler depuis Bali ou la côte atlantique, mais de pouvoir ne pas travailler du tout.





Commentaires