
Chaque année, le 2 novembre, le monde rend hommage à celles et ceux qui risquent leur vie pour informer. Instituée par les Nations unies, la Journée internationale de la fin de l’impunité pour les crimes commis contre les journalistes rappelle une réalité troublante: dans 9 cas sur 10, les assassins de journalistes échappent encore à la justice. En 2025, l’édition met en garde contre une nouvelle menace: la violence numérique et genrée amplifiée par l’intelligence artificielle.
Chaque 2 novembre, les Nations unies célèbrent la Journée internationale de la fin de l’impunité pour les crimes commis contre les journalistes.
Entre 2006 et 2024, plus de 1.700 journalistes ont été tués dans le monde. Et dans près de 9 cas sur 10, leurs assassins n’ont jamais été jugés, selon l'Observatoire des journalistes tués de l’Unesco. Cette absence de justice, qui nourrit la peur et la censure, ne touche pas seulement les médias: elle affaiblit le droit, la démocratie et le débat public.
L’édition 2025 mettra en lumière un danger croissant: la violence sexiste facilitée par l’intelligence artificielle, à l’encontre des femmes journalistes.
Un enjeu de justice
Le mot «impunité» apparaît au XIVᵉ siècle. Il est emprunté au latin impunitas, formé du préfixe in- (qui marque la négation) et de punitus (participe passé de punire, «punir»). Littéralement, impunitas signifie «le fait de n’être pas puni».
Dans la langue française, le terme désigne dès le Moyen Âge «le manque de punition», une tolérance qui encourage la répétition du mal.
Au fil du temps, la notion a dépassé le domaine du droit pénal pour s’imposer dans le langage politique et moral: l’impunité ne désigne plus seulement l’absence de châtiment, mais aussi le refus collectif de rendre justice.
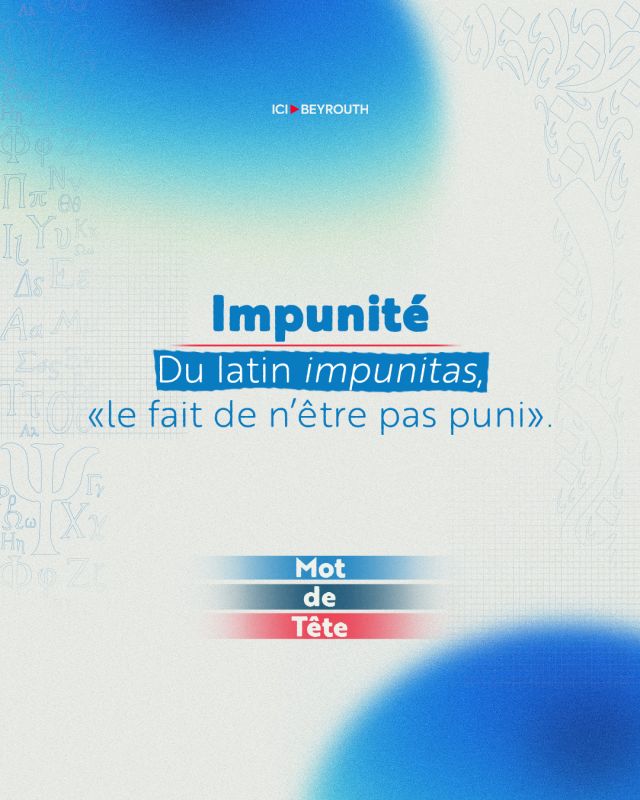
Mettre fin à l’impunité: un combat mondial
La Journée internationale de la fin de l’impunité pour les crimes commis contre les journalistes a été instituée par l’Assemblée générale des Nations unies en 2013. Cette résolution appelle les États à «prendre des mesures précises pour combattre la culture de l’impunité».
La date a été choisie en mémoire de l’assassinat de deux journalistes français, Ghislaine Dupont et Claude Verlon, le 2 novembre 2013 au Mali.
Selon l’Unesco, l’Amérique latine et les Caraïbes demeurent les régions où le nombre d'assassinats de journalistes est le plus élevé, selon le rapport 2024 de l’Unesco.
Les attaques contre les journalistes vont bien au-delà des meurtres: harcèlement, enlèvements, agressions physiques et campagnes de désinformation créent un climat de peur qui entrave la liberté d’expression.
Du crime physique à la violence numérique: une impunité en mutation
Selon une étude de l’Unesco publiée en 2021, 73% des femmes journalistes ont déjà subi des menaces en ligne, et 1 sur 4 a été victime d’agressions hors ligne à la suite de ces violences virtuelles.
L’édition 2025, placée sous le thème «Chat GBV: Sensibiliser à la violence sexiste facilitée par l’intelligence artificielle à l’égard des femmes journalistes», mettra l’accent sur une nouvelle menace. Il s’agit des attaques numériques alimentées par les technologies d’IA, telles que les deepfakes, la désinformation genrée et la surveillance ciblée.
Le Plan d’action des Nations unies: protéger ceux qui informent
Pour faire face à la montée des violences et à la culture persistante de l’impunité, l’ONU a lancé en 2012 le Plan d’action sur la sécurité des journalistes et la question de l’impunité.
Il s’agit du premier effort concerté au niveau mondial pour garantir un environnement libre et sûr aux professionnels des médias.
Depuis son adoption, cette initiative a profondément transformé la manière dont les institutions internationales abordent la sécurité des journalistes. La question a gagné en visibilité au sein des Nations unies, à travers de nouvelles résolutions, déclarations et instruments juridiques, ainsi que l’Appel à l’action pour les droits de l’homme lancé par le Secrétaire général.
Ce plan a eu un impact concret sur le terrain. Il a favorisé la création de mécanismes nationaux de sécurité dans plus de 50 pays, permettant de mieux protéger les journalistes menacés et d’assurer un suivi judiciaire des attaques. Il a également contribué à la constitution de coalitions internationales réunissant gouvernements, médias et organisations de la société civile pour renforcer la prévention, la coopération et la responsabilité des États.
Intégré au Programme 2030 pour le développement durable, le Plan d’action souligne que la liberté de la presse et la sécurité des journalistes sont des conditions essentielles à la paix, à la démocratie et au développement durable.
Protéger les journalistes, c’est défendre le droit de tous à la vérité.





Commentaires