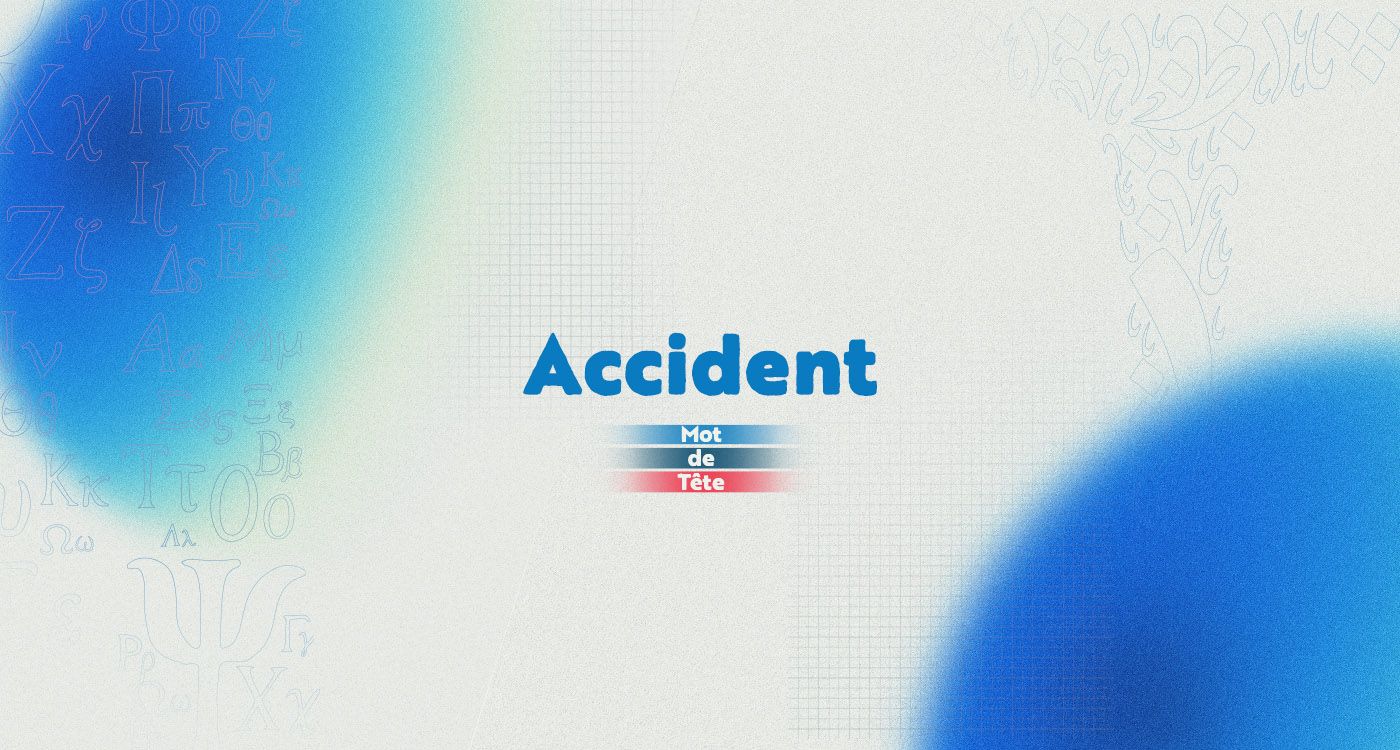
Chaque 16 novembre, la Journée mondiale du souvenir des victimes de la circulation routière rappelle que derrière le mot «accident» se cachent des vies brisées. Longtemps associé au hasard, le terme interroge aujourd’hui notre responsabilité collective face à un fléau évitable.
Environ 1,19 million de personnes meurent chaque année dans des accidents de la route dans le monde.
Chaque 16 novembre, à l’occasion de la Journée mondiale du souvenir des victimes de la circulation routière, instaurée par l’ONU en 2005, le monde se rappelle qu’un mot banal recouvre une réalité terrible.
Le mot «accident», souvent synonyme de fatalité, implique aussi notre responsabilité collective.
À l’origine du mot: le hasard
Le mot «accident» vient du latin accidens, participe présent du verbe accidere, formé du préfixe ad (à) et cadere (tomber). Il signifie littéralement «tomber sur, arriver par hasard».
D’abord neutre, désignant un événement fortuit, le terme commence à revêtir un sens péjoratif au XIIᵉ siècle, où il signifie «événement funeste».
Ce sens s’installe durablement dans la langue et, à partir du XVIᵉ siècle, «accident» désigne désormais, dans l’usage commun, un malheur soudain ou imprévu.
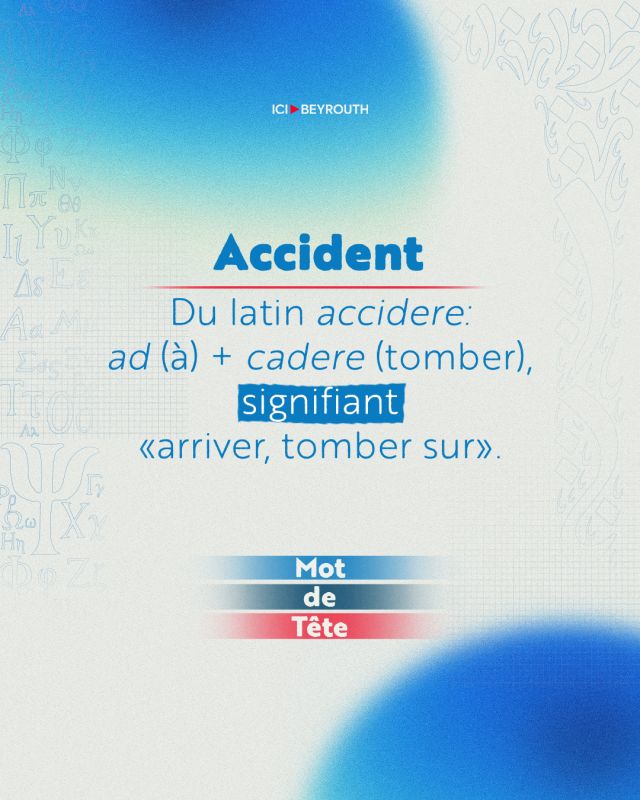
Statistiques et accidentologie: les chiffres qui choquent
Selon l’Organisation mondiale de la santé (OMS), les accidents de la circulation causent 1,19 million de morts par an, et représentent la première cause de décès chez les 5-29 ans.
Quelque 92 % des décès sur les routes surviennent dans les pays à revenu faible ou intermédiaire, alors qu’ils ne possèdent qu’environ 60% du parc mondial de véhicules, d’après l’OMS.
Au Liban, l’association YASA rapporte 876 accidents, 162 morts et 1.034 blessés dans les cinq premiers mois de l’année 2025. L’augmentation du nombre de victimes d’accidents de la route est estimée à plus de 30% par rapport à 2023.
L’«accident» n’est plus une fatalité incompréhensible: il est mesurable, analysable, évitable. D’où l’émergence de l’accidentologie, science consacrée à l’étude des accidents de la circulation: leurs causes, leurs conséquences, leurs moyens de prévention.
Du hasard à la responsabilité: agir pour éviter
Dire «accident» ne doit pas signifier accepter l’inaction.
Un excès de vitesse, un verre de plus, un téléphone en main, une route mal conçue – autant d’«erreurs» que la société transforme en fatalité. D’où l’importance d’une approche systémique: sécuriser les routes et les véhicules, adopter des mesures de sécurité, appliquer les lois.
Sous l’impulsion de l’ONU et de l’OMS, la Décennie d’action pour la sécurité routière (2021-2030) vise à réduire de 50% les décès liés aux accidents. L’OMS coordonne cet effort mondial et préside le mécanisme de collaboration des Nations unies pour la sécurité routière, tout en organisant, tous les deux ans, les Semaines mondiales de la sécurité routière.
Ces initiatives rappellent que la prévention est une responsabilité partagée : celle des conducteurs, des pouvoirs publics et de la société tout entière.
En ce 16 novembre, reconnaître notre responsabilité collective dans la sécurité routière serait un moyen de rendre hommage à ceux dont la vie s’est arrêtée «par accident».





Commentaires