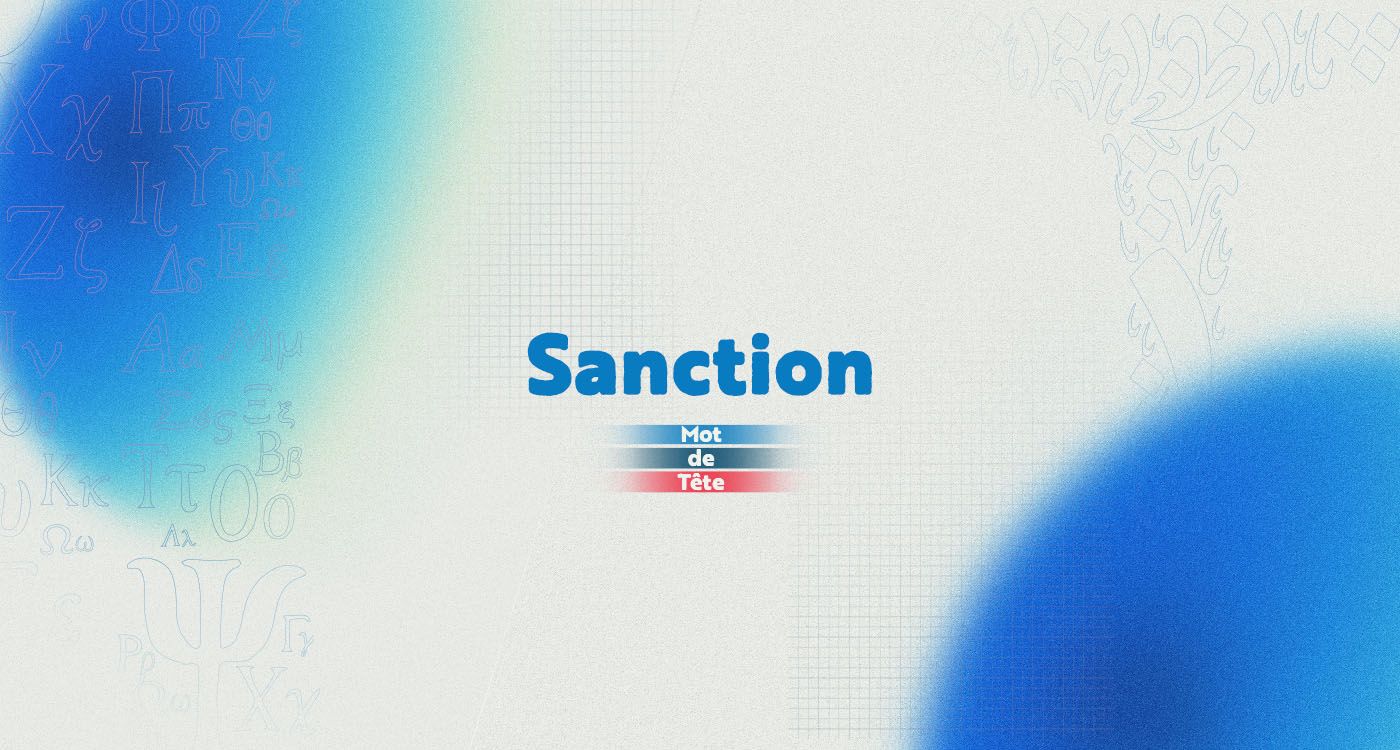
Le mot «sanction» accompagne quotidiennement débats internationaux, décisions politiques et règlements scolaires. Mais derrière son usage courant se cache une étonnante ambiguïté: héritage d’un terme latin lié à la loi et à l’autorité, il désigne à la fois l’approbation et la punition. De l’édit royal à l’embargo économique, l’histoire de ce mot révèle le paradoxe permanent entre légitimité et coercition.
Dès février 2022, l’Union européenne et les États-Unis ont multiplié les sanctions économiques contre la Russie, en réaction à l’invasion de l’Ukraine. Plus récemment, l’Iran, la Corée du Nord ou encore le Mali ont été visés par des mesures restrictives, allant des embargos commerciaux au gel d’avoirs financiers. Au Conseil de sécurité des Nations unies, quatorze régimes de sanctions sont en vigueur, destinés tantôt à lutter contre le terrorisme, tantôt à soutenir une transition politique. Partout dans le monde, le terme «sanction» est devenu synonyme de contrainte, de punition, d’isolement. Mais ce n’est là qu’une facette d’un mot qui recèle une étonnante ambiguïté.
Des origines sacrées
Le mot «sanction» apparaît au XIVᵉ siècle. Il est issu du latin sanctio, dérivé du verbe sancire, qui signifie «décider par une loi, interdire, rendre sacré». Dans le latin chrétien, il désignait l’«édit qui sanctionne», c’est-à-dire le décret qui confère force de loi. Le mot, à l’origine, n’avait donc rien de punitif: il était lié à l’idée d’autorité et de validité.
Au fil des siècles, «sanction» a conservé ce lien avec la légalité et l’approbation. Au XVIIIᵉ siècle, en droit constitutionnel, on parlait de «sanction royale»: l’acte par lequel un souverain confirmait une loi votée par le Parlement, la rendant exécutoire. C’est encore le cas au Royaume-Uni, où toute loi votée doit recevoir la sanction royale avant d’être promulguée.

De l’approbation à la punition: une dualité persistante
Parallèlement à ce sens juridique premier, «sanction» a acquis, dès le XVIIᵉ siècle, une valeur répressive. On parlait alors de «peine prévue par la loi pour assurer le respect d’une règle». Cette acception s’est imposée dans le langage courant: encourir une sanction, infliger une sanction, lever une sanction.
Ainsi naît un paradoxe linguistique: le même mot désigne à la fois l’acte qui valide et l’acte qui punit. Il oscille entre approbation et répression, autorité et châtiment. Dans les années 1980, le sémiologue Roland Barthes classe les mots qui signifient à la fois une chose et son contraire parmi les «énantiosèmes» ou «signifiants contradictoires».
Les multiples visages de la sanction aujourd’hui
Cette ambivalence se reflète dans la variété des usages contemporains. En droit constitutionnel, la «sanction» demeure synonyme d’«approbation», comme dans la formule «la sanction des urnes». Dans le langage administratif ou disciplinaire, elle devient une mesure punitive, appliquée à un fonctionnaire ou à un élève.
Sur la scène internationale, «sanction» prend une dimension géopolitique. Les sanctions économiques ou financières, qu’elles soient unilatérales ou multilatérales, visent à changer le comportement d’un État. Elles peuvent être commerciales (embargos, boycotts), monétaires (restriction de devises) ou financières (gel d’avoirs, exclusion du système SWIFT). Leur objectif va du changement de régime à la défense de valeurs, en passant par la démonstration de puissance politique.
Entre légitimité et coercition
L’histoire du mot révèle ainsi une tension permanente: la sanction est à la fois validation et punition, légitimation et coercition. Un mot qui dit l’autorité dans ce qu’elle a de plus solennel – confirmer une loi, ratifier une décision – et de plus contraignant – infliger une peine, exercer une pression.
Aujourd’hui, en parlant de «sanctions contre la Russie» ou de «sanctions disciplinaires» dans une école, on mobilise un terme dont l’ambiguïté porte en elle le reflet d’un paradoxe politique plus large: l’équilibre fragile entre autorité et liberté, entre contrainte et légitimité.





Commentaires