
Le cinéma français rattrape son retard sur l’un des grands soubresauts sociaux récents. Avec Les Braises de Thomas Kruithof et Dossier 137 de Dominik Moll, deux fictions se saisissent enfin du mouvement des «gilets jaunes», longtemps resté en marge des écrans. En mêlant récit intime et questionnement collectif, ces réalisateurs s’aventurent sur un terrain encore sensible, cherchant moins à rejouer la colère qu’à en sonder les traces dans la société française.
Le grand écran après le grand néant: négligé jusque-là au cinéma, le mouvement des gilets jaunes fait irruption en salles avec la sortie, coup sur coup, de deux films éclairant cette mobilisation qui fit trembler le pouvoir en 2018-2019.
Deux films et deux angles d'approche. En salles mercredi, Les Braises de Thomas Kruithof racontent le tourbillon semé par ce mouvement de contestation au sein d'un couple formé par Virginie Efira et Arieh Worthalter, aux premières heures de la mobilisation fin 2018.
Présenté en compétition au dernier festival de Cannes, Dossier 137 de Dominik Moll, qui sort le 19 novembre, suit, lui, l'impossible enquête d'une inspectrice de la police des polices (Léa Drucker) sur une bavure des forces de l'ordre, en marge d'une manifestation de gilets jaunes.
Avant ce coup double, le mouvement de protestation qui avait tenu en haleine le pays pendant plusieurs mois avait peu inspiré les cinéastes.
La réalisatrice Catherine Corsini en avait certes fait la toile de fond de La Fracture (2021), qui suivait plusieurs personnages au bord de la crise de nerfs dans un service d'urgence un soir de manifestation de gilets jaunes.
Mais le cinéma français était globalement resté sur le bas-côté, illustrant une frilosité à s'emparer de l'actualité quand Hollywood s'est, par exemple, déjà penché sur l'offensive antimigrants aux États-Unis avec Une Bataille après l'autre.
C'est pour combler ce manque que Dominik Moll, le réalisateur césarisé de la Nuit du 12, avait décidé de mettre en chantier son Dossier 137, dont il cosigne le scénario.
«Je me suis dit: c'est quand même fou cette année de gilets jaunes qu'on a vécue, ça a vraiment ébranlé le pouvoir, secoué la France et c'est bizarre que la fiction ne s'en empare pas du tout», a déclaré à l'AFP le cinéaste, interrogé en mai à Cannes.
Certains financeurs du cinéma l'en avaient pourtant dissuadé. «Quand on les a rencontrés pour parler du film, ils ont dit : «Surtout ne mettez pas trop les gilets jaunes en avant, parce que ce n'est pas vendeur».
«Trop clivant?»
Même impression pour Thomas Kruithof, remarqué pour son précédent film Les Promesses, qui explorait les ambitions contrariées et les dilemmes d'une maire de banlieue interprétée par Isabelle Huppert.
«Sur le financement, j'ai senti parfois des réponses révélant peut-être une petite crainte sur le fait de savoir si ce sujet n'est pas trop clivant», explique à l'AFP le réalisateur, qui cosigne lui aussi le scénario des Braises». «Ça montre qu'il reste des plaies.»
Pour coller au plus près d'une réalité encore brûlante, Thomas Kruithof a passé plusieurs jours auprès d'anciens gilets jaunes, dont certains jouent d'ailleurs dans le film.
«Ils nous ont raconté vraiment cette sidération de l'engagement, l'enthousiasme du début de la mobilisation, l'espoir qui naît», détaille le cinéaste.
Pour bâtir son Dossier 137, Dominik Moll s'est, lui, inspiré de plusieurs cas réels de gilets jaunes grièvement blessés lors de manifestations et a effectué une immersion décisive à l'IGPN, la police des polices.
«J'ai réalisé qu'ils passaient un temps énorme à décortiquer des vidéos de manifestations et je trouvais qu'il y avait, dans cette façon de scruter des images et d'essayer de les interpréter, quelque chose de très fictionnel et de très cinématographique», explique-t-il.
Thomas Kruithof voit, lui, dans la fiction un moyen de dépasser la chronique médiatique des mobilisations de gilets jaunes, qui avait fini par se réduire au décompte des manifestants, interpellations ou blessés.
«La fiction permet de regarder ce mouvement de manière peut-être plus nuancée et d'atteindre une autre forme d'émotion, d'avoir une plus grande richesse de couleurs», estime-t-il.
Par Jérémy TORDJMAN / AFP


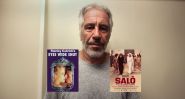
Commentaires