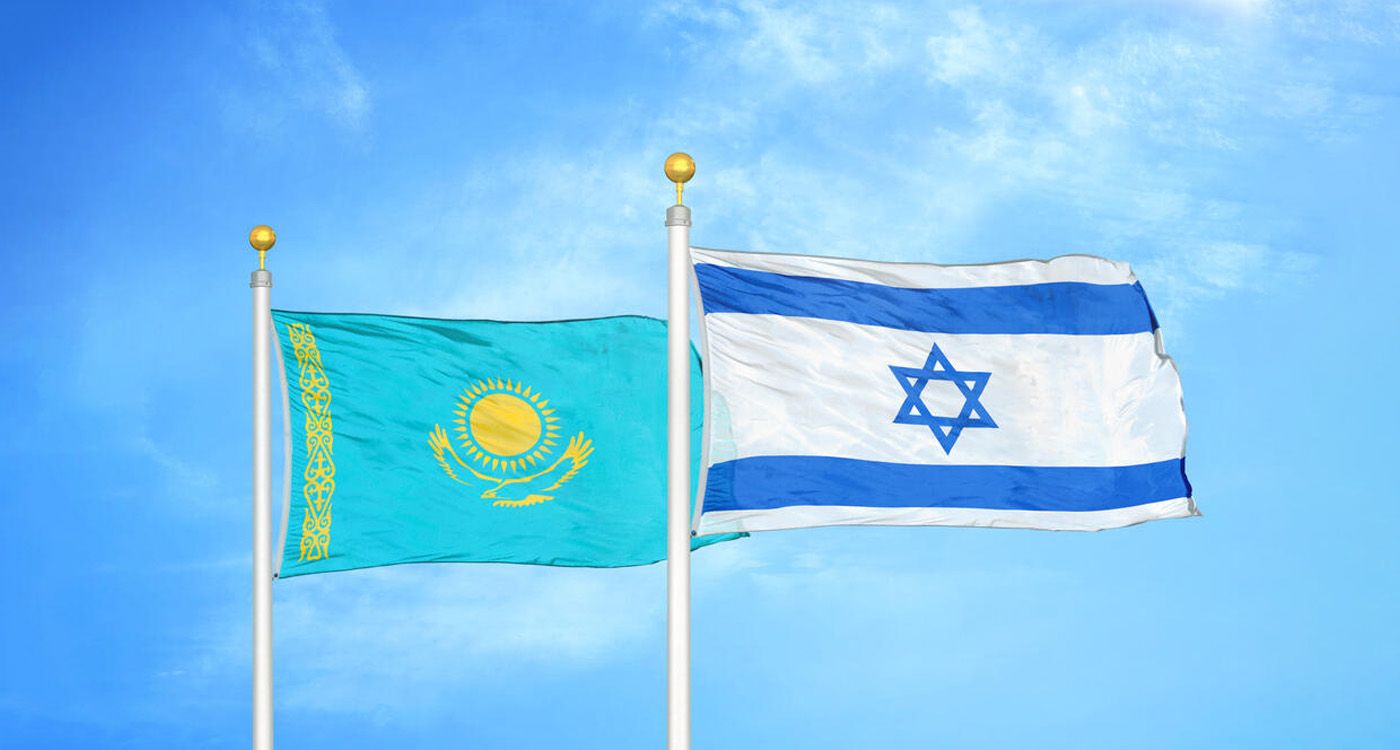
Le président américain Donald Trump a annoncé jeudi que le Kazakhstan allait rejoindre les accords d’Abraham, ces ententes diplomatiques nées en 2020 pour normaliser les relations entre Israël et plusieurs pays arabes et musulmans.
L’annonce est intervenue à l’issue d’un appel téléphonique entre Trump, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou et le président kazakh Kassym-Jomart Tokaïev, alors que ce dernier participait au sommet C5+1 réunissant à Washington les dirigeants d’Asie centrale.
«Nous allons bientôt annoncer une cérémonie de signature officielle, et beaucoup d’autres pays veulent rejoindre ce club de force», a déclaré Trump sur Truth Social. Le gouvernement kazakh a confirmé que les négociations étaient dans leur phase finale et présenté cette décision comme une «continuation naturelle et logique» de sa politique étrangère fondée sur le dialogue et la stabilité régionale.
Le geste n’est pas anodin : s’il ne bouleverse pas les équilibres diplomatiques, il traduit une volonté de part et d’autre de redonner un souffle à un projet géopolitique que la guerre de Gaza avait mis en sommeil.
Washington espère ainsi relancer la dynamique des accords d’Abraham et consolider son influence dans une région stratégique où Moscou et Pékin rivalisent d’ambitions.
Une adhésion symbolique mais politiquement utile
Le Kazakhstan et Israël entretiennent des relations diplomatiques depuis 1992. Ils échangent dans les domaines de l’énergie, de la technologie, de la santé et de la défense. Astana fournit entre 22 et 25 % du pétrole consommé en Israël, tandis que l’État hébreu exporte vers le Kazakhstan des technologies agricoles et de cybersécurité.
Cette coopération, stable et discrète, s’inscrit dans la longue tradition kazakhe de diplomatie multivectorielle – un équilibre permanent entre la Russie, la Chine et l’Occident.
D’après l'Atlantic Council, cette adhésion «n’est pas une percée majeure» mais possède une valeur symbolique importante. Elle traduit une continuité plutôt qu’un changement, mais aussi une volonté de s’associer à un cadre diplomatique prestigieux pour accroître la visibilité internationale d’Astana.
Elle reflète également un message adressé à Washington : celui d’un partenaire musulman modéré prêt à collaborer à des projets de paix et de développement régionaux sous l’égide américaine.
La décision répond donc à une logique de reconnaissance et de positionnement. Le président Tokaïev, conscient des risques d’isolement dans un environnement dominé par la Russie et la Chine, cherche à élargir son cercle d’alliés. Rejoindre les accords d’Abraham lui offre une tribune politique à coût nul et un moyen d’attirer des investissements occidentaux, notamment dans les secteurs minier, énergétique et technologique.
Une nouvelle étape dans la stratégie américaine en Eurasie
Pour les États-Unis, l’annonce est un signal diplomatique. Le Times of Israel cite un haut responsable américain affirmant que l’adhésion du Kazakhstan doit «prouver que la dynamique des accords reste vivante» et qu’elle préfigure d’autres adhésions à venir.
Le secrétaire d’État Marco Rubio a souligné que ces accords vont «au-delà des simples relations bilatérales» : ils visent à créer un cadre de coopération économique et politique entre nations à majorité musulmane et Israël, pour prouver que le dialogue et la prospérité sont possibles.
Cette lecture correspond à la vision défendue par l'Atlantic Council, qui voit un «bloc pan-abrahamique» en train de naître. En élargissant les Accords à l’Asie centrale, Washington espère transformer ce réseau diplomatique en instrument de stabilisation régionale et de contrepoids à l’influence sino-russe.
La présence du Kazakhstan, premier producteur mondial d’uranium et détenteur d’immenses réserves d’hydrocarbures, confère en effet une dimension stratégique nouvelle à ce cadre de coopération.
Mais cette relance reste fragile. Comme le rappelle l’Atlantic Council, sans avancée sur la question palestinienne, l’Arabie saoudite – acteur clé du monde musulman – ne rejoindra pas les accords. Or, sans Riyad, la portée du projet demeure limitée. L’entrée du Kazakhstan a donc une fonction politique avant tout : montrer que la marque des accords d’Abraham reste vivante, à la veille de la visite du prince héritier saoudien Mohammed ben Salmane à la Maison Blanche.
Une relation bilatérale ancienne et complémentaire
L’intégration du Kazakhstan s’appuie sur trois décennies de coopération avec Israël. Dès les années 1990, le pays est devenu un fournisseur énergétique crucial pour l’État hébreu. Selon le Begin-Sadat Center for Strategic Studies, le pétrole kazakh représente jusqu’à un quart des besoins d’Israël, contribuant à sa sécurité énergétique et à la diversification de ses approvisionnements hors du Moyen-Orient.
Les échanges commerciaux dépassent régulièrement le milliard de dollars par an, et plus d’une cinquantaine d’entreprises israéliennes opèrent dans le pays, notamment dans les télécommunications, l’agriculture de précision et la santé.
En parallèle, les deux États ont développé une coopération sécuritaire depuis les années 2000 : Israël apporte son expertise technologique, tandis que le Kazakhstan lui offre un ancrage diplomatique rare dans le monde musulman.
Cette alliance s’explique aussi par des affinités culturelles et politiques. Le Kazakhstan se présente comme un État laïc et tolérant, où cohabitent 130 ethnies et 45 religions. Il accueille depuis 2003 le congrès des leaders des religions mondiales et traditionnelles, un forum interconfessionnel où Israël participe activement.
Cette politique de tolérance religieuse, saluée par Washington et Jérusalem, renforce la légitimité d’Astana à se joindre à un cadre de coopération basé sur la coexistence et le dialogue.
Un choix à la fois opportuniste et révélateur
L’adhésion du Kazakhstan aux accords d’Abraham n’est donc pas un tournant diplomatique, mais plutôt un coup de projecteur géopolitique. Pour Washington, elle ravive un projet emblématique de la première présidence Trump et envoie un message à Pékin et Moscou : l’Asie centrale n’est plus une chasse gardée. Pour Israël, elle confirme sa stratégie de normalisation avec les pays musulmans modérés, au-delà du monde arabe.
Pour le Kazakhstan enfin, ce choix s’inscrit dans une politique d’équilibre habile : coopérer avec les puissances occidentales sans rompre avec ses voisins russes et chinois. Dans un contexte de rivalités globales exacerbées, ce pays de vingt millions d’habitants – vaste comme l’Europe occidentale – parie sur la diplomatie du juste milieu. En rejoignant les accords d’Abraham, il ne change pas de camp, mais s’offre une visibilité nouvelle sur la scène mondiale et un gage de confiance auprès des États-Unis et de leurs alliés.




Commentaires