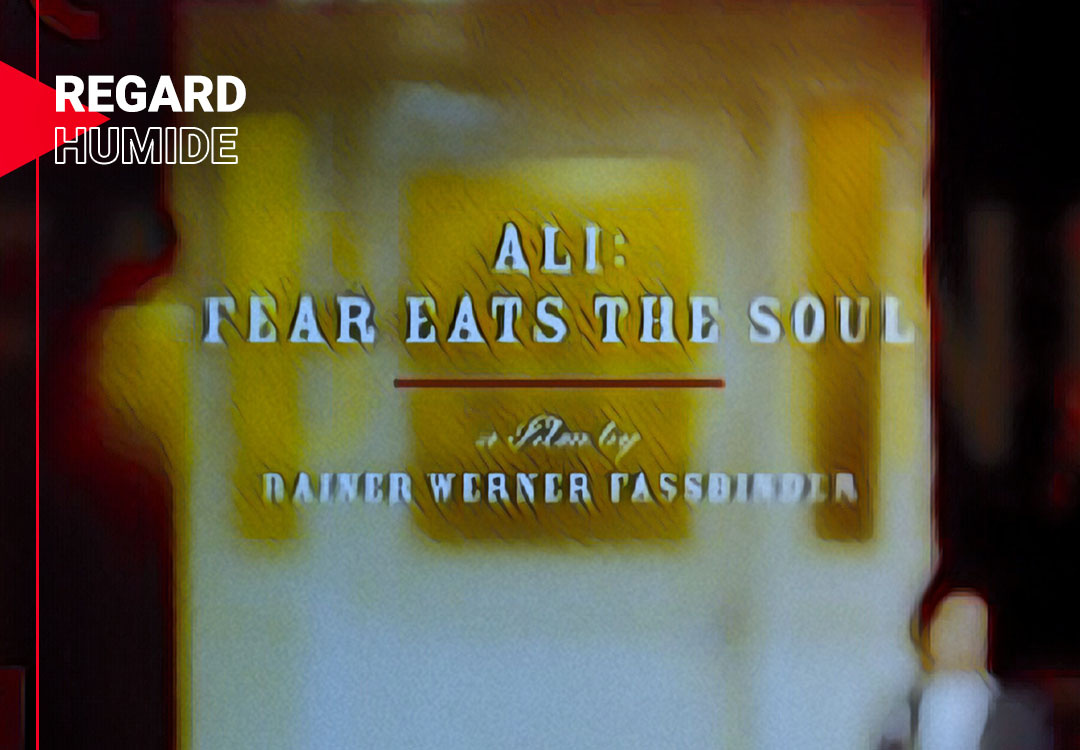
©Affiche du film
L’une de mes premières rencontres touchantes avec l’universalité est un film du cinéaste Allemand Rainer Werner Fassbinder, Ali, l’histoire simple d’un amour trivial. Le contexte est théâtral; un bar lugubre fréquenté par des immigrés de fortune, des logis aux décors dépouillés, des personnages noyés dans la routine des classes populaires, où ni l’ennui, ni la joie n’ont de place prépondérante. Dans Ali, la vie semble immuable, tranquille.
Un soir, une femme, la soixantaine, rentre dans le bar, fatiguée et solitaire; elle semble rechercher un moment de quiétude, elle s’installe seule, commande une bière machinalement.
Les choses sont parfois ainsi faites qu’un simple acte, sans portée particulière, peut enclencher un cataclysme qui ébranle les certitudes inculquées par des croyances séculaires. Emmi est allemande, Ali est marocain et jeune. Leurs regards humides se croisent, un dialogue maladroit s’installe, le vocabulaire est spartiate et brut. L’étrange harmonie qui émerge parfois d’univers hétéroclites se concrétise par une danse, tendre déhanchement sur une musique orientale de la merveilleuse Sabah.
 Photo tirée du film
Photo tirée du film
Cet instant d’insouciance naturelle, cette parenthèse d’humanité sincère où l’on se laisse aller au confort des sensations primaires, est aussi intense qu’éphémère. Très vite de profondes fissures ébranlent l’édifice fragile de la passion, des détails anodins de la vie courante minent le couple. Sous le poids de l’entourage hostile, ce qui s’apparentait au départ à un conte de fée hors du temps, prend les allures inattendues du dilemme du hérisson de Schopenhauer, les piquants fusent de toute part, l’intimité est envahie par des personnes extérieures, si bien que le film met en place un étrange triangle amoureux: Ali, Emmi, Entourage.
La tragédie de Shakespeare s’invite dans une Allemagne austère des années 70, atteint la vie de gens ordinaires, sans réelles attaches. La famille, les amis, les commerçants agressent le couple, l’ostracisent et introduisent la dimension politique, civilisationnelle dans cette relation qui n’a en apparence aucun impact social. Les failles engendrées par le déferlement de haine finissent par creuser un fossé infranchissable et se répercutent immanquablement sur le quotidien. Les premiers émois purs cèdent la place à l’étouffement et le film a cela de subversif qu’il n’exonère pas Emmi et Ali de leur part de responsabilité. Étrangement, c’est lorsque leur entourage finit par les accepter qu’ils succombent à leurs différences. Le délitement progressif de leur amour est un aveu manifeste de lâcheté et de faiblesse.
 Photo tirée du film
Photo tirée du film
Ali est un film de 1974, son titre en français, Tous les autres s’appellent Ali, a une étrange connotation universelle qui va au-delà du mélodrame classique. Autre lieu, à la même époque, un pays était à l’aube d’un conflit qui allait changer toute la conception du vivre ensemble. Comme dans le film, la «peur dévore l’âme»; comme dans le film des acteurs extérieurs fomentaient les troubles; comme dans le film, le lien social explosait. L’image idyllique de carte postale jaunissait à mesure que la haine répandait ses tentacules et s’enracinait dans les esprits.
Heureusement, les frontières de la haine sont souvent poreuses. À travers de minuscules ouvertures, des signes d’apaisement et des amitiés inconditionnelles apparaissent toujours.
Dans le film de Fassbinder comme au Liban, la voix de Sabah transcende l’obscurantisme de l’intolérance, berce les amoureux et, miracle de la culture, l’hospitalité reprend ses droits avec une pointe de nostalgie amère.
Et si tout cela n’était qu’un cauchemar… place au rêve!
Un soir, une femme, la soixantaine, rentre dans le bar, fatiguée et solitaire; elle semble rechercher un moment de quiétude, elle s’installe seule, commande une bière machinalement.
Les choses sont parfois ainsi faites qu’un simple acte, sans portée particulière, peut enclencher un cataclysme qui ébranle les certitudes inculquées par des croyances séculaires. Emmi est allemande, Ali est marocain et jeune. Leurs regards humides se croisent, un dialogue maladroit s’installe, le vocabulaire est spartiate et brut. L’étrange harmonie qui émerge parfois d’univers hétéroclites se concrétise par une danse, tendre déhanchement sur une musique orientale de la merveilleuse Sabah.
 Photo tirée du film
Photo tirée du filmCet instant d’insouciance naturelle, cette parenthèse d’humanité sincère où l’on se laisse aller au confort des sensations primaires, est aussi intense qu’éphémère. Très vite de profondes fissures ébranlent l’édifice fragile de la passion, des détails anodins de la vie courante minent le couple. Sous le poids de l’entourage hostile, ce qui s’apparentait au départ à un conte de fée hors du temps, prend les allures inattendues du dilemme du hérisson de Schopenhauer, les piquants fusent de toute part, l’intimité est envahie par des personnes extérieures, si bien que le film met en place un étrange triangle amoureux: Ali, Emmi, Entourage.
La tragédie de Shakespeare s’invite dans une Allemagne austère des années 70, atteint la vie de gens ordinaires, sans réelles attaches. La famille, les amis, les commerçants agressent le couple, l’ostracisent et introduisent la dimension politique, civilisationnelle dans cette relation qui n’a en apparence aucun impact social. Les failles engendrées par le déferlement de haine finissent par creuser un fossé infranchissable et se répercutent immanquablement sur le quotidien. Les premiers émois purs cèdent la place à l’étouffement et le film a cela de subversif qu’il n’exonère pas Emmi et Ali de leur part de responsabilité. Étrangement, c’est lorsque leur entourage finit par les accepter qu’ils succombent à leurs différences. Le délitement progressif de leur amour est un aveu manifeste de lâcheté et de faiblesse.
 Photo tirée du film
Photo tirée du filmAli est un film de 1974, son titre en français, Tous les autres s’appellent Ali, a une étrange connotation universelle qui va au-delà du mélodrame classique. Autre lieu, à la même époque, un pays était à l’aube d’un conflit qui allait changer toute la conception du vivre ensemble. Comme dans le film, la «peur dévore l’âme»; comme dans le film des acteurs extérieurs fomentaient les troubles; comme dans le film, le lien social explosait. L’image idyllique de carte postale jaunissait à mesure que la haine répandait ses tentacules et s’enracinait dans les esprits.
Heureusement, les frontières de la haine sont souvent poreuses. À travers de minuscules ouvertures, des signes d’apaisement et des amitiés inconditionnelles apparaissent toujours.
Dans le film de Fassbinder comme au Liban, la voix de Sabah transcende l’obscurantisme de l’intolérance, berce les amoureux et, miracle de la culture, l’hospitalité reprend ses droits avec une pointe de nostalgie amère.
Et si tout cela n’était qu’un cauchemar… place au rêve!
Lire aussi



Commentaires