
Né à Rueil-Malmaison en 1967, Éric Genetet est journaliste et romancier vivant entre Paris et Strasbourg. Après un long parcours dans le monde de la radio et de la télévision, il se tourne vers la littérature et publie plusieurs romans dont Le Fiancé de la lune (2008), Tomber (2016) – lauréat du prix Folire – et Un bonheur sans pitié (2019), tous parus aux éditions Héloïse d’Ormesson.
Ce 27 janvier 2022 paraît son sixième roman, On pourrait croire que ce sont des larmes, aux mêmes éditions. À travers le portrait et le parcours d’un homme parti sur les traces de son passé, Genetet fait résonner les silences, les non-dits, et met le doigt sur les plaies encore béantes de l’enfance, dans un roman inondé de lumière et d'espoir.
Ici Beyrouth a rencontré l’écrivain pour discuter de la dimension intimiste de son œuvre, de la puissance cathartique de l’écriture et de son dernier-né.
L’amour est au centre de vos livres. Il occupe toute la place dans vos trois premiers romans et reste fortement présent dans tous les autres. Est-ce que l’amour constitue la quête suprême de votre vie, de vos romans?
L’amour est mon moteur, il me fait avancer dans la vie. Les questions sur l’amour m’obsèdent et en écrivant des livres, j’ai souvent des réponses qui déclenchent d’autres questions. Ma sensibilité est réveillée par l’amour comme elle l’est par la beauté. J’essaie de développer ma sensibilité pour accueillir l’amour en moi.
Pourtant l’homme moderne est focalisé sur sa sexualité et les objectifs qui orientent sa quête individualiste…
Si vous considérez que l’homme moderne ne s’intéresse pas beaucoup à l’amour, alors je ne suis pas un homme moderne. Je suis pourtant bien ancré dans mon époque. C’est surtout ma quête de la culture qui a influencé ma vision des choses et de l’amour. C’est en me plongeant dans les films d’abord, et dans les livres ensuite, que j’ai pu développer ma sensibilité.
Peut-on dépasser l’amertume du vécu, les blessures de la vie, par le biais de l’écriture? Ou faut-il être un écrivain ou un poète pour le faire et le croire?
Je suis toujours attiré par les lieux où la solitude a trouvé une place. On cherche la solitude quand il y a quelque chose qui nous a blessés ou exclus du monde, souvent le manque d’amour. J’ai forcément comme tout le monde des blessures. L’écriture permet d’interroger ces blessures. Elle permet d’aller chercher des territoires où la liberté existe au bout du chemin.
On pourrait également inverser ce rapport et dire que sans les blessures, on ne peut pas aller loin dans l’écriture!
Le désir d’écrire un livre pour moi, ça part toujours d’une blessure, d’un traumatisme, de quelque chose qui m’a fait mal. C’est certain. Et dans certaines familles, il y a des mystères enfouis, tellement lourds, qu’on a du mal à s’aimer, à dire les choses, puis un jour par magie on arrive à en parler. L’aboutissement se fait par le biais de l’écriture, celle d’un livre plus précisément.
Vous avez reçu le prix Folire 2016 pour votre livre Tomber, récompensé par un public qui sort du commun. Racontez cette grande émotion, qui vous a révélé à vous-même.
C’était mon quatrième roman sorti en 2016. Le prix Folire vient de folie. Il s’agit de quatre hôpitaux psychiatriques au sud de la France, en partenariat avec le centre méditerranéen de littérature, qui demandent à leurs patients de lire les trois finalistes du prix sélectionnés par un jury, puis de choisir. Les patients ont voté bulletin fermé et m’ont désigné comme gagnant.
Dans ce livre, je raconte l’histoire d’un adolescent dyslexique, comme moi. Ce fut ma première reconnaissance et ma seconde naissance. Je suis allé les voir avec la marraine du prix qui n’était autre que Mazarine Pingeot, la fille de François Mitterrand. Tomber m’a ouvert le chemin, m’a immergé dans l’écriture, m’a réconcilié avec moi-même.
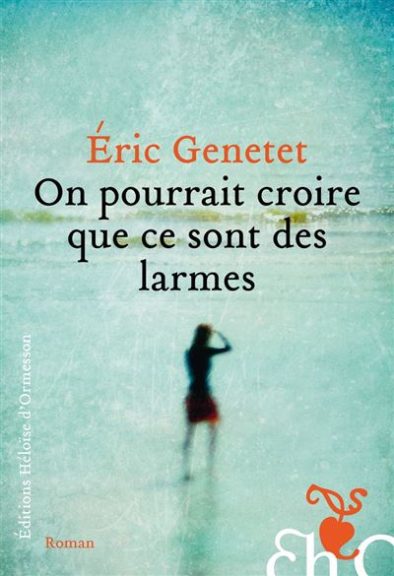
Le 27 janvier 2022, votre sixième roman voit le jour. Son titre ne laisse pas indifférent: On pourrait croire que ce sont des larmes. Ses principaux thèmes: la relation mère-fils, la transmission de la peur, le désamour et la peur de l’abandon. Qu’est-ce qui empêche les êtres «de mettre des mots sur les maux»?
Je vous parlais de ces familles où il existe des mystères un peu trop lourds qui empêchent de parler. C’est aussi la pudeur, une certaine éducation. Parfois on a simplement honte de ses sentiments et on a du mal à les évoquer. Autour de nous, il y a beaucoup de taiseux. Avec mon fils, on s’exprime énormément, on se dit «je t’aime» tous les jours, même trois fois par jour, alors que je viens d’une famille où mes parents ne prononçaient pas du tout ces mots-là. Les seuls mots qu’un fils n’oublie jamais sont ceux que sa mère n’a jamais prononcés. On continue sa vie, mais ce manque persiste. Pour moi, c’est devenu un moteur. Avec le temps, on l’accepte et on comprend pourquoi sans juger. Ce ne fut pas simple, surtout que j’étais un enfant et un ado dyslexique décrété tard à l’âge de 12 ans. Je me sentais exclu de la société. J’avais du mal avec les mots, avec l’école, les relations humaines. Finalement, le fait d’avoir fait de l’écriture ma passion et mon métier me rend heureux. Si j’avais au départ les mêmes capacités que les autres, je n’aurais jamais écrit. C’est pourquoi mon parcours trouve grâce à mes yeux. On pourrait croire que ce sont des larmes dévoile les mots qui n’ont pas été dits et qui rejaillissent dans l’écriture à la place des larmes. En fait je n’ai pleuré qu’après 40 ans, plus précisément après mon livre Tomber. Quelque chose s’est passé en moi qui m’a permis de donner libre cours à mes sentiments. Je pleurais comme un dingue, car je comprenais qui j’étais. C’était l’émotion d’aller à la rencontre de moi-même, de savoir enfin que j’avais ma place sur cette planète.
Êtes-vous devenu écrivain par défi, par prédisposition ou par les deux?
Quand j’avais 19 ans, je faisais 25 fautes d’orthographe par phrase. La lecture m’était impossible en tant que dyslexique. Cependant, j’ai pu lire Le Voyageur magnifique d’Yves Simon que je connaissais en tant que chanteur. J’ai fait alors le double rêve de devenir, à l’image d’Adrien, le personnage qu’il décrit, et de devenir écrivain comme Yves Simon. Alors j’ai tout mis en place pour le faire. Cela m’a pris vingt ans. Un jour, un manuscrit a été accepté par une maison d’édition. Et depuis, j’enchaîne les livres avec bonheur à un rythme fou puisque j’ai dépassé le complexe des débuts. Donc je ne sais pas à quel point cela correspond à une prédisposition, mais c’est surtout beaucoup de travail. C’était aussi une manière d’exister aux yeux du monde et aux regards des filles que je voulais séduire. Quand j’annonçais que j’étais écrivain, il y avait de la magie dans les yeux et je voulais que cette magie continue.
On a l’impression qu’il y a un pacte de fidélité entre vous et la maison d’édition Héloïse d’Ormesson…
C’est le cinquième roman que l’on fait ensemble. Je suis l’un des auteurs les plus anciens de la maison. Avec les autres auteurs, on forme une grande famille, même ceux qui sont arrivés récemment. On est entouré d’une équipe formidable, de l’attaché de presse à la personne qui s’occupe des libraires et des salons. De plus, on n’est jamais tout seul avec son texte. On travaille toujours avec une éditrice dans sa propre maison d’édition. Il y a toutes les conditions pour épanouir sa plume.
Dans votre roman Un bonheur sans pitié, vous montrez une relation amoureuse toxique avec un pervers narcissique. Est-ce une autofiction, ou une expérience vécue par un.e proche, ou l’envie de traiter un thème en vogue?
C’est une fille qui m’a contactée il y a neuf ans, pour me raconter son expérience avec un pervers narcissique. Elle avait lu l’un de mes livres et souhaitait que j’écrive son histoire. Je l’ai écoutée énormément pendant un an, convaincu de la pertinence du sujet. Je lui donnai mon accord avec deux conditions: primo, ce n’était pas un livre qui allait lui rendre justice; je ne voulais juger personne ni faire office de vengeur masqué. Secundo, j’étais totalement libre d’écrire mon roman en m’appuyant sur son histoire. Il a fallu également que je rapproche l’histoire de certains de mes comportements passés, quand jeune, je me comportais en «connard» sans cependant verser dans la violence narcissique.
Par ailleurs, j’ai pu alimenter en gros une vingtaine de témoignages féminins, ce qui constituait une vraie étude sur le sujet. Le pervers narcissique ne peut être heureux que quand l’autre est malheureux. Il doit faire souffrir pour remplir ses propres vides et pouvoir exister. De même, il est intéressant de comprendre pourquoi la femme est attirée par ce profil. Bref, j’en ai fait un livre en donnant la parole à «la victime» et «au bourreau», en alternant les voix, par souci d’objectivité.
Pour les dyslexiques, à force de travailler, on en guérit? Comment vous avez fait? Vous pourriez inspirer beaucoup de talents cachés...
J’ai rencontré beaucoup de dyslexiques ainsi que leurs parents et leurs grands-parents grâce à mon livre Tomber. Le cerveau des dyslexiques fonctionne différemment. Il faut juste trouver ses qualités et les développer, ou découvrir sa passion et canaliser l’énergie qu’elle génère. Les dyslexiques mettront plus de temps et de patience pour se frayer un chemin, mais ils peuvent être très talentueux. Mon conseil pour les parents et les proches des dyslexiques c’est les aimer très fort, car je crois qu’on ne rate jamais sa vie si on est aimé, même si on est différent.
Ce 27 janvier 2022 paraît son sixième roman, On pourrait croire que ce sont des larmes, aux mêmes éditions. À travers le portrait et le parcours d’un homme parti sur les traces de son passé, Genetet fait résonner les silences, les non-dits, et met le doigt sur les plaies encore béantes de l’enfance, dans un roman inondé de lumière et d'espoir.
Ici Beyrouth a rencontré l’écrivain pour discuter de la dimension intimiste de son œuvre, de la puissance cathartique de l’écriture et de son dernier-né.
L’amour est au centre de vos livres. Il occupe toute la place dans vos trois premiers romans et reste fortement présent dans tous les autres. Est-ce que l’amour constitue la quête suprême de votre vie, de vos romans?
L’amour est mon moteur, il me fait avancer dans la vie. Les questions sur l’amour m’obsèdent et en écrivant des livres, j’ai souvent des réponses qui déclenchent d’autres questions. Ma sensibilité est réveillée par l’amour comme elle l’est par la beauté. J’essaie de développer ma sensibilité pour accueillir l’amour en moi.
Pourtant l’homme moderne est focalisé sur sa sexualité et les objectifs qui orientent sa quête individualiste…
Si vous considérez que l’homme moderne ne s’intéresse pas beaucoup à l’amour, alors je ne suis pas un homme moderne. Je suis pourtant bien ancré dans mon époque. C’est surtout ma quête de la culture qui a influencé ma vision des choses et de l’amour. C’est en me plongeant dans les films d’abord, et dans les livres ensuite, que j’ai pu développer ma sensibilité.
Peut-on dépasser l’amertume du vécu, les blessures de la vie, par le biais de l’écriture? Ou faut-il être un écrivain ou un poète pour le faire et le croire?
Je suis toujours attiré par les lieux où la solitude a trouvé une place. On cherche la solitude quand il y a quelque chose qui nous a blessés ou exclus du monde, souvent le manque d’amour. J’ai forcément comme tout le monde des blessures. L’écriture permet d’interroger ces blessures. Elle permet d’aller chercher des territoires où la liberté existe au bout du chemin.
On pourrait également inverser ce rapport et dire que sans les blessures, on ne peut pas aller loin dans l’écriture!
Le désir d’écrire un livre pour moi, ça part toujours d’une blessure, d’un traumatisme, de quelque chose qui m’a fait mal. C’est certain. Et dans certaines familles, il y a des mystères enfouis, tellement lourds, qu’on a du mal à s’aimer, à dire les choses, puis un jour par magie on arrive à en parler. L’aboutissement se fait par le biais de l’écriture, celle d’un livre plus précisément.
Vous avez reçu le prix Folire 2016 pour votre livre Tomber, récompensé par un public qui sort du commun. Racontez cette grande émotion, qui vous a révélé à vous-même.
C’était mon quatrième roman sorti en 2016. Le prix Folire vient de folie. Il s’agit de quatre hôpitaux psychiatriques au sud de la France, en partenariat avec le centre méditerranéen de littérature, qui demandent à leurs patients de lire les trois finalistes du prix sélectionnés par un jury, puis de choisir. Les patients ont voté bulletin fermé et m’ont désigné comme gagnant.
Dans ce livre, je raconte l’histoire d’un adolescent dyslexique, comme moi. Ce fut ma première reconnaissance et ma seconde naissance. Je suis allé les voir avec la marraine du prix qui n’était autre que Mazarine Pingeot, la fille de François Mitterrand. Tomber m’a ouvert le chemin, m’a immergé dans l’écriture, m’a réconcilié avec moi-même.
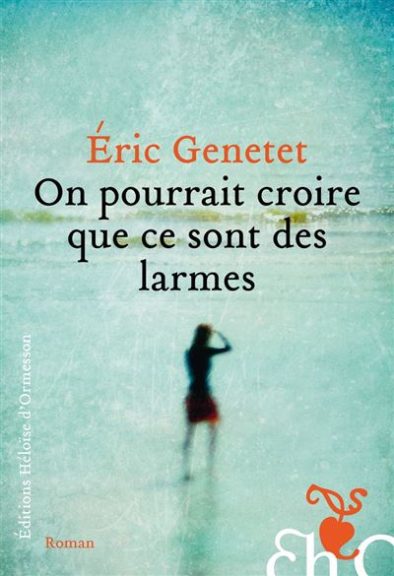
Le 27 janvier 2022, votre sixième roman voit le jour. Son titre ne laisse pas indifférent: On pourrait croire que ce sont des larmes. Ses principaux thèmes: la relation mère-fils, la transmission de la peur, le désamour et la peur de l’abandon. Qu’est-ce qui empêche les êtres «de mettre des mots sur les maux»?
Je vous parlais de ces familles où il existe des mystères un peu trop lourds qui empêchent de parler. C’est aussi la pudeur, une certaine éducation. Parfois on a simplement honte de ses sentiments et on a du mal à les évoquer. Autour de nous, il y a beaucoup de taiseux. Avec mon fils, on s’exprime énormément, on se dit «je t’aime» tous les jours, même trois fois par jour, alors que je viens d’une famille où mes parents ne prononçaient pas du tout ces mots-là. Les seuls mots qu’un fils n’oublie jamais sont ceux que sa mère n’a jamais prononcés. On continue sa vie, mais ce manque persiste. Pour moi, c’est devenu un moteur. Avec le temps, on l’accepte et on comprend pourquoi sans juger. Ce ne fut pas simple, surtout que j’étais un enfant et un ado dyslexique décrété tard à l’âge de 12 ans. Je me sentais exclu de la société. J’avais du mal avec les mots, avec l’école, les relations humaines. Finalement, le fait d’avoir fait de l’écriture ma passion et mon métier me rend heureux. Si j’avais au départ les mêmes capacités que les autres, je n’aurais jamais écrit. C’est pourquoi mon parcours trouve grâce à mes yeux. On pourrait croire que ce sont des larmes dévoile les mots qui n’ont pas été dits et qui rejaillissent dans l’écriture à la place des larmes. En fait je n’ai pleuré qu’après 40 ans, plus précisément après mon livre Tomber. Quelque chose s’est passé en moi qui m’a permis de donner libre cours à mes sentiments. Je pleurais comme un dingue, car je comprenais qui j’étais. C’était l’émotion d’aller à la rencontre de moi-même, de savoir enfin que j’avais ma place sur cette planète.
Êtes-vous devenu écrivain par défi, par prédisposition ou par les deux?
Quand j’avais 19 ans, je faisais 25 fautes d’orthographe par phrase. La lecture m’était impossible en tant que dyslexique. Cependant, j’ai pu lire Le Voyageur magnifique d’Yves Simon que je connaissais en tant que chanteur. J’ai fait alors le double rêve de devenir, à l’image d’Adrien, le personnage qu’il décrit, et de devenir écrivain comme Yves Simon. Alors j’ai tout mis en place pour le faire. Cela m’a pris vingt ans. Un jour, un manuscrit a été accepté par une maison d’édition. Et depuis, j’enchaîne les livres avec bonheur à un rythme fou puisque j’ai dépassé le complexe des débuts. Donc je ne sais pas à quel point cela correspond à une prédisposition, mais c’est surtout beaucoup de travail. C’était aussi une manière d’exister aux yeux du monde et aux regards des filles que je voulais séduire. Quand j’annonçais que j’étais écrivain, il y avait de la magie dans les yeux et je voulais que cette magie continue.
On a l’impression qu’il y a un pacte de fidélité entre vous et la maison d’édition Héloïse d’Ormesson…
C’est le cinquième roman que l’on fait ensemble. Je suis l’un des auteurs les plus anciens de la maison. Avec les autres auteurs, on forme une grande famille, même ceux qui sont arrivés récemment. On est entouré d’une équipe formidable, de l’attaché de presse à la personne qui s’occupe des libraires et des salons. De plus, on n’est jamais tout seul avec son texte. On travaille toujours avec une éditrice dans sa propre maison d’édition. Il y a toutes les conditions pour épanouir sa plume.
Dans votre roman Un bonheur sans pitié, vous montrez une relation amoureuse toxique avec un pervers narcissique. Est-ce une autofiction, ou une expérience vécue par un.e proche, ou l’envie de traiter un thème en vogue?
C’est une fille qui m’a contactée il y a neuf ans, pour me raconter son expérience avec un pervers narcissique. Elle avait lu l’un de mes livres et souhaitait que j’écrive son histoire. Je l’ai écoutée énormément pendant un an, convaincu de la pertinence du sujet. Je lui donnai mon accord avec deux conditions: primo, ce n’était pas un livre qui allait lui rendre justice; je ne voulais juger personne ni faire office de vengeur masqué. Secundo, j’étais totalement libre d’écrire mon roman en m’appuyant sur son histoire. Il a fallu également que je rapproche l’histoire de certains de mes comportements passés, quand jeune, je me comportais en «connard» sans cependant verser dans la violence narcissique.
Par ailleurs, j’ai pu alimenter en gros une vingtaine de témoignages féminins, ce qui constituait une vraie étude sur le sujet. Le pervers narcissique ne peut être heureux que quand l’autre est malheureux. Il doit faire souffrir pour remplir ses propres vides et pouvoir exister. De même, il est intéressant de comprendre pourquoi la femme est attirée par ce profil. Bref, j’en ai fait un livre en donnant la parole à «la victime» et «au bourreau», en alternant les voix, par souci d’objectivité.
Pour les dyslexiques, à force de travailler, on en guérit? Comment vous avez fait? Vous pourriez inspirer beaucoup de talents cachés...
J’ai rencontré beaucoup de dyslexiques ainsi que leurs parents et leurs grands-parents grâce à mon livre Tomber. Le cerveau des dyslexiques fonctionne différemment. Il faut juste trouver ses qualités et les développer, ou découvrir sa passion et canaliser l’énergie qu’elle génère. Les dyslexiques mettront plus de temps et de patience pour se frayer un chemin, mais ils peuvent être très talentueux. Mon conseil pour les parents et les proches des dyslexiques c’est les aimer très fort, car je crois qu’on ne rate jamais sa vie si on est aimé, même si on est différent.
Lire aussi




Commentaires