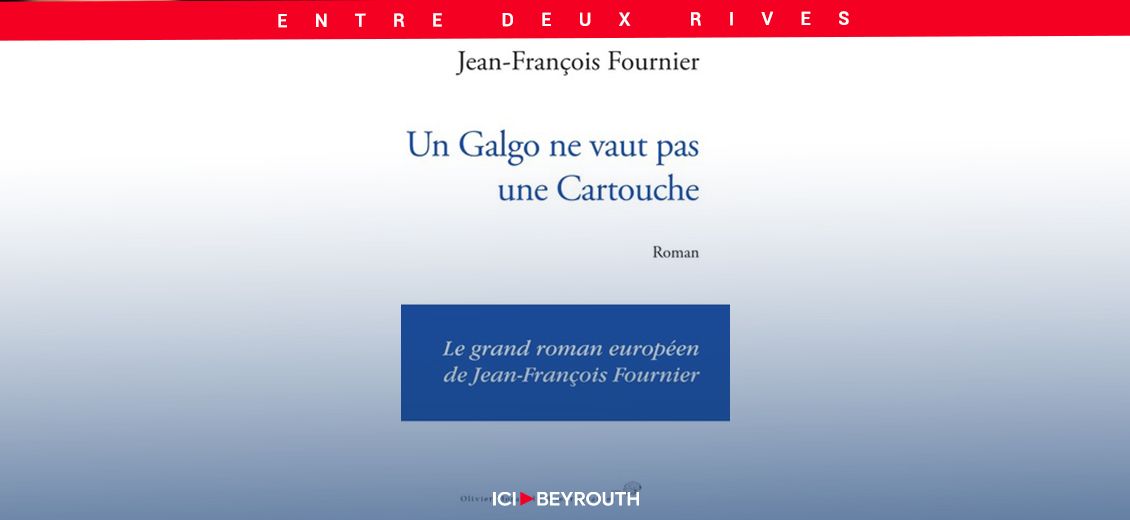
Auteur de vingt-six ouvrages, le Suisse Jean-François Fournier est journaliste spécialiste en gastronomie. Son dixième roman qui se lit d’une traite, paru aux éditions Olivier Morattel, salué par la critique et oscillant entre saga et nouvelles, est un hommage à l’art. Le titre, Un galgo ne vaut pas une cartouche, quelque peu déroutant, ne s’explique qu’une fois le livre terminé, tel un passage initiatique.
Dans une étourdissante traversée de l’Europe baroque sur les pas d’une belle et élégante femelle galgo, lévrier ibérique, Jean-François Fournier nous fait découvrir l’univers fabuleux de l’art, de la gastronomie et des vins millésimés. Le style peaufiné et quelquefois lyrique nous entraîne dans le tourbillon des artistes tourmentés en quête de beauté.
Le galgo n’est-il pas le double de l’auteur-narrateur accompagnant les personnages d’un récit à l’autre, au gré de leurs pérégrinations dans les grandes capitales européennes? Témoin silencieux de leurs errances, le galgo ne juge ni ne condamne quand on le cède facilement à un nouveau maître.
Lady Canela, ainsi surnommée, est sans doute le personnage principal qui relie écrivains ou artistes dans ce roman foisonnant de références culturelles. Qu’il s’agisse de littérature, de peinture ou de musique, les onze chapitres s’emboîtent, le rythme soutenu nous emporte d’un lieu magique à l’autre: Barcelone, Vienne, Prague, Munich, Zurich, Milan, Paris, Marseille, Genève. Et c’est un voyage fabuleux dans une Europe riche de toutes formes d’art que l’on entreprend au fil de la lecture. Les personnages masculins font des repas gargantuesques dans les bistrots, dégustent les meilleurs crus que l’auteur-narrateur, en bon connaisseur, prend plaisir à décrire. Quant aux femmes, lumineuses et blessées par la vie, elles tâtonnent pour réparer l’irréparable.
Les voix narratives varient selon les récits dont la plupart sont médiatisés par le narrateur. À Barcelone, un écrivain déambule dans les rues obscures, entre bars et pension minable, avec le galgo qu’il vient de ramasser. Le narrateur sonde les pensées de l’écrivain qui «aime le matin des tavernes» et pense que «la littérature échappe au temps, aux castes et même aux auteurs» et dont on apprend, au bout de quelques pages, qu’il s’appelle Ludwig mais aussi Ernst. Il mène sa vie comme une corrida, mange avec grand appétit, s’enivre, fréquente des prostituées, arpente la Rambla en quête d’un «fournisseur de jambons, de drogues et de médicaments». Il est celui qui «boit tous les jours avec la mort et la trompe avec ses passes de chapeau», mais elle aura raison de lui et il mourra dans une formidable scène épique.
C’est ensuite le peintre viennois Rainer Richter, dit Goya, qui adopte le galgo et on les retrouve à Vienne, au Café Sperl. On y boit jusqu’à l’ivresse, on y fume les meilleurs cigares. Les dialogues s’ensuivent dans d’autres lieux où l’on parle peinture, musique, vin, cigare et design. Les références abondent: Klimt, Schiele, Egon, Hodler… mais Rainer, joueur de poker, mise Canela qu’il perdra en dernier lieu au profit du saxophoniste Heinrich Matter. Et le narrateur de commenter: «Cette nuit-là, la musique triomphe de la peinture.»
Elle suivra son nouveau maître «sans un regard pour Rainer» à Prague avec ses immeubles Art déco, dans les boîtes de jazz. Et là, commence le troisième récit où le narrateur s’amuse à multiplier les focalisations interne et omnisciente «ils prennent une table au Café Nona, passage obligatoire des intellectuels et des néolibéraux» avant d’atterrir à l’Ambassador Zlata Husa où Matter va jouer Parker, Coltrane, Gordon... puis, les voilà qui repartent à Zurich retrouver Isabelle, peintre journaliste, dont «les blessures s’écoulent en permanence» et c’est pour le narrateur, l’occasion de dénoncer l’inceste. Elle emmènera Canela en montagne chez une chanteuse d’opéra qu’elle veut interviewer. La cantatrice est sous le charme de cette femelle immaculée. Elle l’embarque avec elle à la Scala de Milan où on lui «réserve un triomphe aussi amoureux que bruyant».
Et voilà que l’instance narrative change, le narrateur s’efface pour céder la parole au personnage: «Je suis un nègre nègre», commence-t-il. Et suivent les hommages à la négritude de Senghor, à Toni Morrison et James Baldwin. Il rencontre à Paris la cantatrice qui «brûle de s’essayer à l’écriture» et qui lui confiera Canela. L’écrivain-nègre dont on ne connaîtra pas le nom, est un amoureux des hôtels parisiens parce qu’ils «ont quelque chose de littéraire». Les références littéraires abondent: Oscar Wilde, Borge, Cioran, Ginsberg…
Il rencontrera, à un banquet littéraire, au Balthazar, le producteur Jean-Pascal. L’héritier et son mari qui tombent amoureux de Canela et l’emmènent dans leur maison sur les hauteurs d’Alicante. Les amours homosexuelles sont racontées à la première personne par le producteur avec l’arrivée de Pierre-François Tournier (clin d’œil au nom de l’auteur Jean-François Fournier) «le moine sauvage de l’écriture» qui a eu un coup de foudre pour Canela et qui va l’embarquer avec lui à Vienne.
Le chapitre consacré à la Judith de Klimt amorce le passage du Je narratif au pronom Il qui déstabilise le lecteur – n’est-ce pas le dessein de l’auteur? – et le contraint à la vigilance pour ne pas perdre le fil du récit. Et l’on comprend que ce texte libertin est un récit dans le récit, qu’il s’agit du travail d’un jeune apprenti que Tournier évalue et dont il pose les enjeux de l’écriture. L’écrivain perdra Canela lors d’une ascension aux Alpes et la cherchera en vain. Elle est récupérée par l’historienne de l’art Dominique Arlaud.
À Paris, c’est le jeune écrivain apprenti dont on saura bien plus tard qu’il s’appelle Hugo, qui prend la parole pour relater la fin tragique de son amie Dominique, mais aussi son séjour à Marseille dont il dira: «Quelle ville écoute autant battre le pouls du monde et la parole des peuples?»
Retour à Genève, et au dernier chapitre, la boucle est bouclée. Lady Canela est à Barcelone, point de départ du roman où elle finit par s’échapper et retrouver sa liberté.
Dans l’épilogue, l’auteur cède la parole au galgo qui raconte sa vie antérieure. L’on y apprend la cruauté des chasseurs espagnols envers les galgos et le titre prend tout son sens comme une dénonciation de cette cruelle pratique moyenâgeuse.
On ne peut que saluer le magnifique roman de Jean-François Fournier dont la verve et l’imaginaire flamboyant nous embarquent pour un voyage inoubliable.
Dans une étourdissante traversée de l’Europe baroque sur les pas d’une belle et élégante femelle galgo, lévrier ibérique, Jean-François Fournier nous fait découvrir l’univers fabuleux de l’art, de la gastronomie et des vins millésimés. Le style peaufiné et quelquefois lyrique nous entraîne dans le tourbillon des artistes tourmentés en quête de beauté.
Le galgo n’est-il pas le double de l’auteur-narrateur accompagnant les personnages d’un récit à l’autre, au gré de leurs pérégrinations dans les grandes capitales européennes? Témoin silencieux de leurs errances, le galgo ne juge ni ne condamne quand on le cède facilement à un nouveau maître.
Lady Canela, ainsi surnommée, est sans doute le personnage principal qui relie écrivains ou artistes dans ce roman foisonnant de références culturelles. Qu’il s’agisse de littérature, de peinture ou de musique, les onze chapitres s’emboîtent, le rythme soutenu nous emporte d’un lieu magique à l’autre: Barcelone, Vienne, Prague, Munich, Zurich, Milan, Paris, Marseille, Genève. Et c’est un voyage fabuleux dans une Europe riche de toutes formes d’art que l’on entreprend au fil de la lecture. Les personnages masculins font des repas gargantuesques dans les bistrots, dégustent les meilleurs crus que l’auteur-narrateur, en bon connaisseur, prend plaisir à décrire. Quant aux femmes, lumineuses et blessées par la vie, elles tâtonnent pour réparer l’irréparable.
Les voix narratives varient selon les récits dont la plupart sont médiatisés par le narrateur. À Barcelone, un écrivain déambule dans les rues obscures, entre bars et pension minable, avec le galgo qu’il vient de ramasser. Le narrateur sonde les pensées de l’écrivain qui «aime le matin des tavernes» et pense que «la littérature échappe au temps, aux castes et même aux auteurs» et dont on apprend, au bout de quelques pages, qu’il s’appelle Ludwig mais aussi Ernst. Il mène sa vie comme une corrida, mange avec grand appétit, s’enivre, fréquente des prostituées, arpente la Rambla en quête d’un «fournisseur de jambons, de drogues et de médicaments». Il est celui qui «boit tous les jours avec la mort et la trompe avec ses passes de chapeau», mais elle aura raison de lui et il mourra dans une formidable scène épique.
C’est ensuite le peintre viennois Rainer Richter, dit Goya, qui adopte le galgo et on les retrouve à Vienne, au Café Sperl. On y boit jusqu’à l’ivresse, on y fume les meilleurs cigares. Les dialogues s’ensuivent dans d’autres lieux où l’on parle peinture, musique, vin, cigare et design. Les références abondent: Klimt, Schiele, Egon, Hodler… mais Rainer, joueur de poker, mise Canela qu’il perdra en dernier lieu au profit du saxophoniste Heinrich Matter. Et le narrateur de commenter: «Cette nuit-là, la musique triomphe de la peinture.»
Elle suivra son nouveau maître «sans un regard pour Rainer» à Prague avec ses immeubles Art déco, dans les boîtes de jazz. Et là, commence le troisième récit où le narrateur s’amuse à multiplier les focalisations interne et omnisciente «ils prennent une table au Café Nona, passage obligatoire des intellectuels et des néolibéraux» avant d’atterrir à l’Ambassador Zlata Husa où Matter va jouer Parker, Coltrane, Gordon... puis, les voilà qui repartent à Zurich retrouver Isabelle, peintre journaliste, dont «les blessures s’écoulent en permanence» et c’est pour le narrateur, l’occasion de dénoncer l’inceste. Elle emmènera Canela en montagne chez une chanteuse d’opéra qu’elle veut interviewer. La cantatrice est sous le charme de cette femelle immaculée. Elle l’embarque avec elle à la Scala de Milan où on lui «réserve un triomphe aussi amoureux que bruyant».
Et voilà que l’instance narrative change, le narrateur s’efface pour céder la parole au personnage: «Je suis un nègre nègre», commence-t-il. Et suivent les hommages à la négritude de Senghor, à Toni Morrison et James Baldwin. Il rencontre à Paris la cantatrice qui «brûle de s’essayer à l’écriture» et qui lui confiera Canela. L’écrivain-nègre dont on ne connaîtra pas le nom, est un amoureux des hôtels parisiens parce qu’ils «ont quelque chose de littéraire». Les références littéraires abondent: Oscar Wilde, Borge, Cioran, Ginsberg…
Il rencontrera, à un banquet littéraire, au Balthazar, le producteur Jean-Pascal. L’héritier et son mari qui tombent amoureux de Canela et l’emmènent dans leur maison sur les hauteurs d’Alicante. Les amours homosexuelles sont racontées à la première personne par le producteur avec l’arrivée de Pierre-François Tournier (clin d’œil au nom de l’auteur Jean-François Fournier) «le moine sauvage de l’écriture» qui a eu un coup de foudre pour Canela et qui va l’embarquer avec lui à Vienne.
Le chapitre consacré à la Judith de Klimt amorce le passage du Je narratif au pronom Il qui déstabilise le lecteur – n’est-ce pas le dessein de l’auteur? – et le contraint à la vigilance pour ne pas perdre le fil du récit. Et l’on comprend que ce texte libertin est un récit dans le récit, qu’il s’agit du travail d’un jeune apprenti que Tournier évalue et dont il pose les enjeux de l’écriture. L’écrivain perdra Canela lors d’une ascension aux Alpes et la cherchera en vain. Elle est récupérée par l’historienne de l’art Dominique Arlaud.
À Paris, c’est le jeune écrivain apprenti dont on saura bien plus tard qu’il s’appelle Hugo, qui prend la parole pour relater la fin tragique de son amie Dominique, mais aussi son séjour à Marseille dont il dira: «Quelle ville écoute autant battre le pouls du monde et la parole des peuples?»
Retour à Genève, et au dernier chapitre, la boucle est bouclée. Lady Canela est à Barcelone, point de départ du roman où elle finit par s’échapper et retrouver sa liberté.
Dans l’épilogue, l’auteur cède la parole au galgo qui raconte sa vie antérieure. L’on y apprend la cruauté des chasseurs espagnols envers les galgos et le titre prend tout son sens comme une dénonciation de cette cruelle pratique moyenâgeuse.
On ne peut que saluer le magnifique roman de Jean-François Fournier dont la verve et l’imaginaire flamboyant nous embarquent pour un voyage inoubliable.
Lire aussi



Commentaires