
La figure maternelle, centrale dans la vie, l’est aussi en littérature. Mères aimantes ou difficiles, leur présence irrigue les œuvres, permettant aux écrivains de leur offrir l’immortalité.
La mère est celle qui donne la vie, protège et guide l’enfant durant ses premières années. Son rôle est si fondamental que sa perte est vécue comme un déchirement, une amputation irrémédiable. Il n’est donc pas étonnant que les mères occupent une place de choix dans la littérature, les auteurs cherchant à travers la fiction à rendre éternelles celles qui leur ont donné le jour.
Dès l’incipit de L’Étranger, Albert Camus place la mère au cœur de son roman avec cette phrase devenue culte: «Aujourd’hui, maman est morte. Ou peut-être hier, je ne sais pas.» Sous son apparente banalité, elle touche à une vérité universelle. La mort d’une mère laisse dans le flou, personne ne peut dire avec certitude à quel instant exact celle qui nous a mis au monde l’a quitté. Était-ce au moment où la triste nouvelle a été découverte? Ou un peu avant, le jour même ou la veille? À moins que cela n’ait été un lent processus, la vie la quittant à petit feu jusqu’à s’éteindre définitivement.
Pour la majorité des gens, perdre sa mère est un deuil qui n’en finit pas. Plus encore que le père, c’est elle qui a nourri, habillé, accompagné les premiers pas. Son souvenir s’accompagne toujours d’une douce nostalgie, comme une mélodie du bonheur enfantin à jamais révolu. Les écrivains trouvent dans la fiction un moyen de prolonger la vie de leur mère disparue, de l’arracher au néant de la mort pour lui conférer une forme d’éternité. C’est pourquoi la figure maternelle traverse la littérature de part en part.
Certes, il existe quelques exceptions notables de mères dépeintes sous un jour peu flatteur. On pense à la terrible Folcoche d’Hervé Bazin dans Vipère au poing, ou encore à l’affreuse Madame Lepic qui voue une haine féroce à son fils roux et couvert de taches de rousseur dans Poil de carotte de Jules Renard. Mais ce sont là des cas à part.
Le plus souvent, c’est une image positive, voire idéalisée de la mère que les auteurs transmettent. Dans La Promesse de l’aube, Romain Gary brosse le portrait d’une mère aimante bien que mythomane et affabulatrice. Mina, Nina dans le roman, a rêvé pour son fils un destin grandiose d’écrivain, de séducteur et d’ambassadeur. Poussé par cet amour et cette foi absolue en lui, Gary s’évertuera à faire de ce rêve une réalité. «Nous sommes faits de l’étoffe dont sont tissés les rêves», écrivait Shakespeare. En regardant le parcours de Romain Gary, on serait tenté de dire qu’il est le fruit des rêves de grandeur de sa mère.
La Promesse de l’aube est un vibrant hommage d’un fils prodige à l’amour immense et inconditionnel de sa mère. Lorsque les aléas de la Seconde Guerre mondiale les séparèrent brutalement, Gary recevait encore, trois ans après, des lettres de sa mère, alors qu’il était engagé dans la Résistance entre Londres et l’Afrique. Ce n’est qu’à son retour qu’il apprit qu’elle était en réalité morte depuis trois ans, mais avait pris soin d’écrire des centaines de lettres pour lui épargner un deuil trop douloureux, loin de sa patrie.
Albert Cohen témoigne du même amour filial dans Le Livre de ma mère, où il fait revivre avec émotion celle qui lui a donné la vie et tant d’amour. La mère de Cohen y apparaît presque comme une sainte, tant ses qualités sont immenses et son dévouement pour son fils et son mari sans limites. Elle était pour lui une sainte sentinelle à jamais perdue, guetteuse d’amour toujours à l’affût.
Marguerite Duras, dans Un barrage contre le Pacifique, évoque le combat acharné de sa propre mère contre les épreuves de la vie. Très jeune veuve, cette institutrice s’est battue pour élever ses enfants en Indochine, loin de son pays natal. Acculée par la misère, elle envisage un temps de marier sa fille à un riche vieillard, ce qui entache l’admiration que lui porte son enfant. Mais la jeune Marguerite finit par comprendre l’extraordinaire ténacité de cette femme refusant de plier devant l’adversité. Pendant quinze ans, elle travaille comme pianiste dans un cinéma pour économiser suffisamment et acheter un lopin de terre. Lorsque celui-ci se révèle inexploitable, rongé par les vagues et les crabes, elle s’acharne à construire une digue pour protéger ce maigre patrimoine destiné à ses enfants. Un combat digne de Sisyphe qui illustre magnifiquement sa volonté inflexible de ne jamais céder face aux coups du sort.
Les visages des mères dans la littérature sont multiples, modelés par la relation que chaque écrivain a entretenue avec la sienne. Mais c’est très souvent l’image d’une mère aimante et protectrice qui domine. Pour beaucoup d’auteurs, envisager la mort maternelle relève de l’oxymore insoutenable. La mère est perçue comme une mer, immense, généreuse, éternelle. Même lorsqu’elle disparaît, la mer ne cesse pas d’exister. Elle continue de porter ceux qui se plongent en elle. Tout comme une mère, même morte, continue d’accompagner ses enfants.
Lire aussi

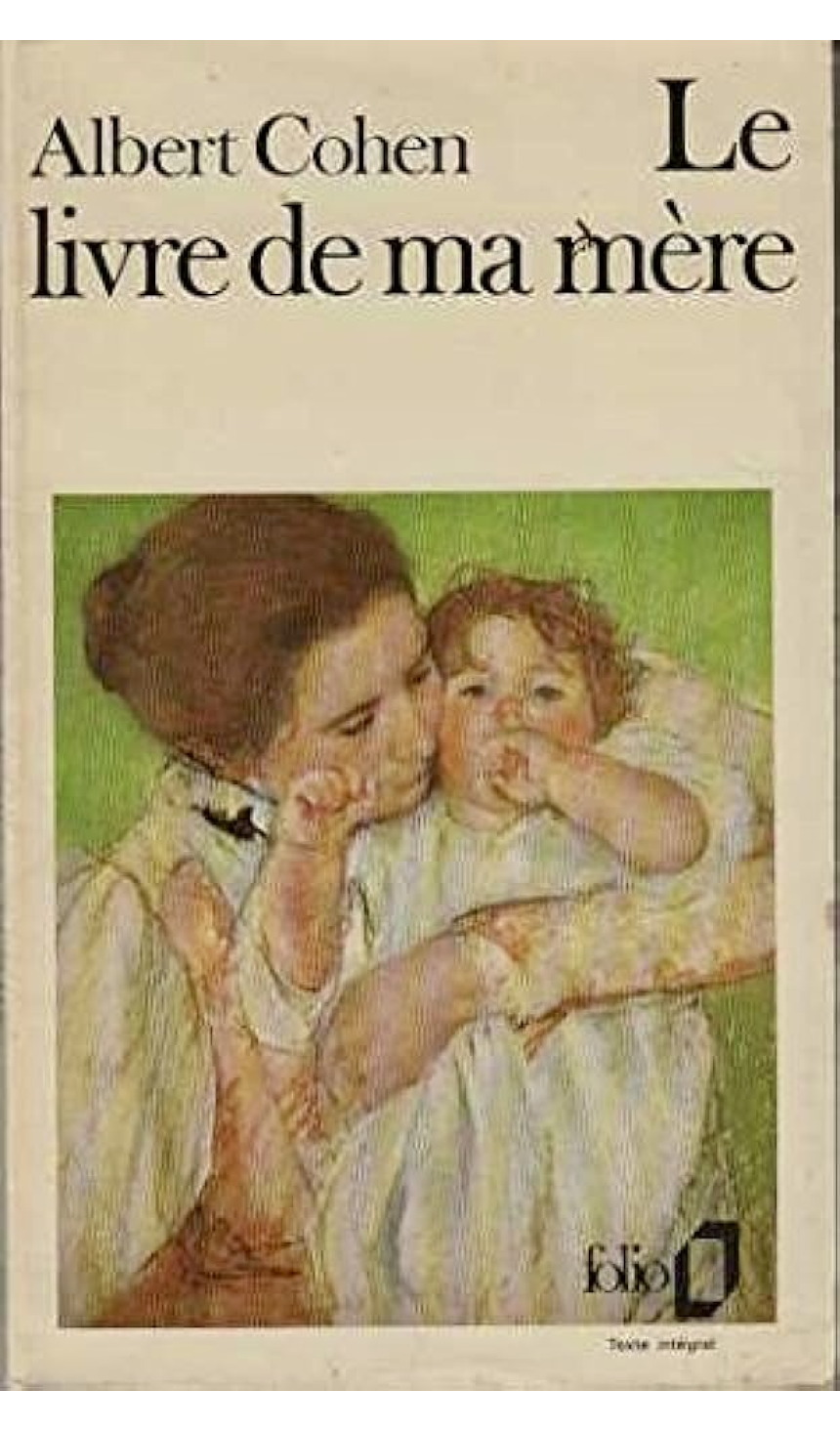
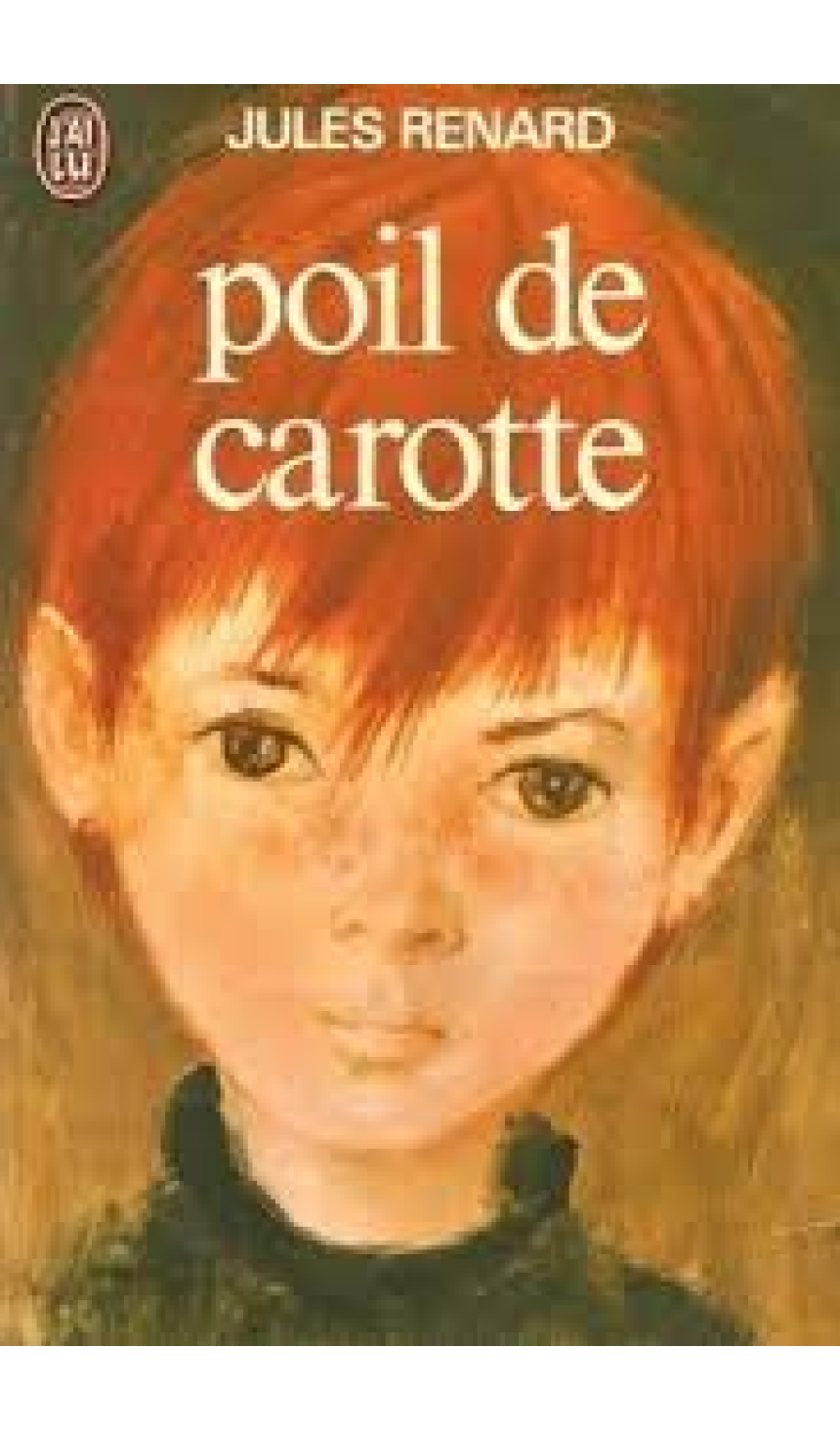

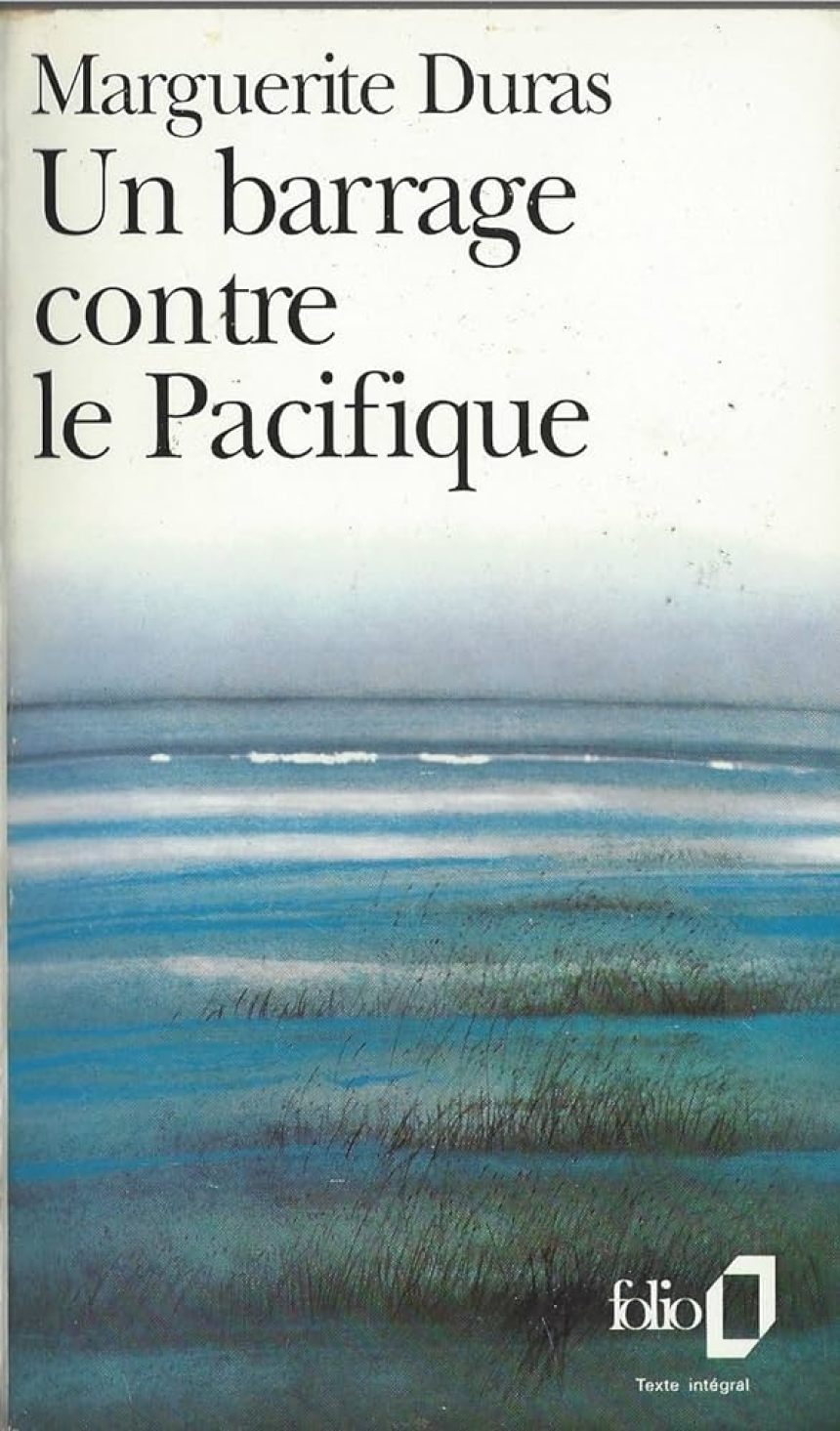
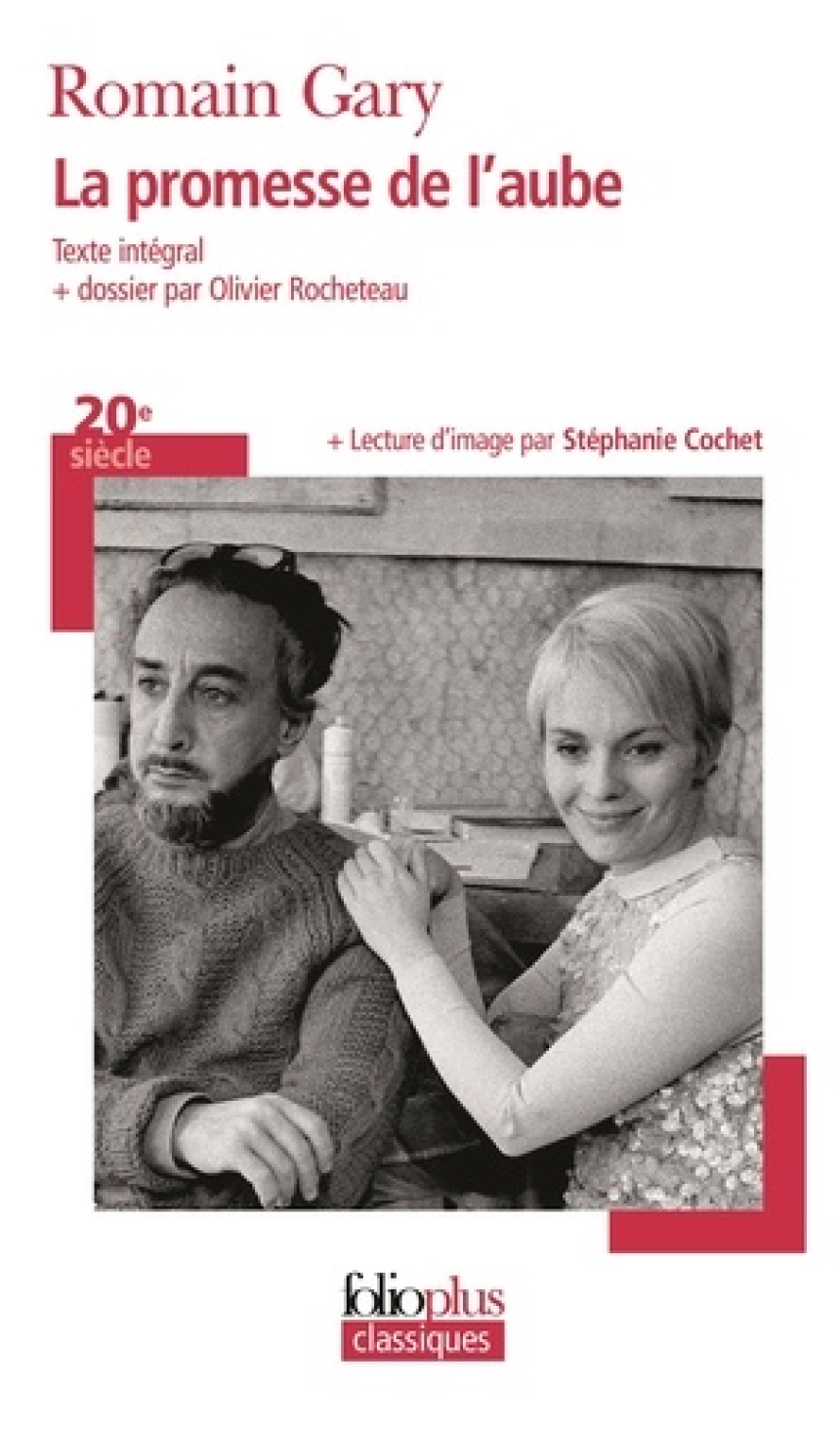



Commentaires