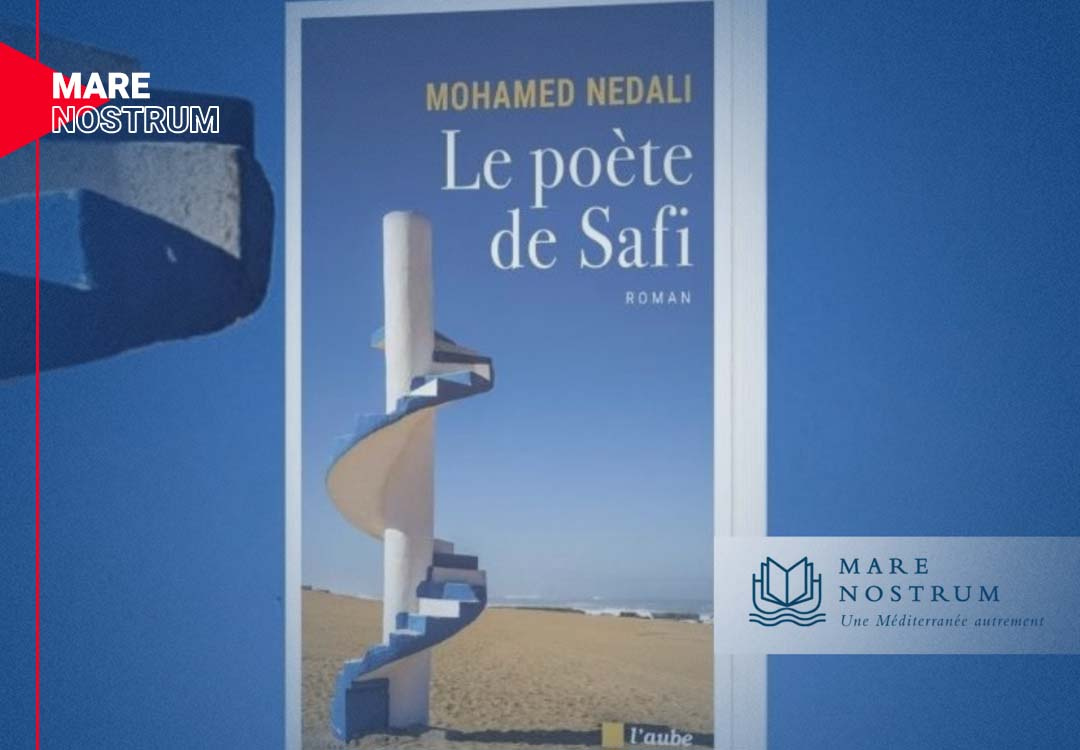
«ll faut qu’un jour le poète prenne d’assaut la citadelle de ces marchands de rêves, qu’il arrache le micro de leurs mains et appelle le vulgum pecus à sortir de sa léthargie séculaire.» Lorsque au beau milieu de l’après-midi, Moncef Bahri déclame un poème subversif depuis le minaret de la mosquée du quartier «populeux et bruyant» de H’raït l’bid, à Safi, il voit son existence basculer à jamais. Une existence qui n’est que subsistance dans la déclinante cité portuaire marocaine, jadis prospère et désormais en proie à une paupérisation favorisant la montée de l’islamisme.
Moncef est un rêveur lucide, acide, irrévérencieux, qui, à défaut de croire en un Dieu tout-puissant («La religion est, pour moi, une invention purement humaine, une construction sociale et culturelle, un moyen d’assurer la cohésion de la société»), voue une «passion pour la poésie arabe préislamique, celle d’Imrou l’Qays, prince triplement fou, de poésie, d’amour et d’errance». Il croit en la vertu des rimes, la puissance des mots. Avec ses deux meilleurs amis, Saïd et Najib, il se désole de voir la ville qu’il chérit sombrer dans l’ignorance et l’obscurantisme entre les Égarés d’un côté et les Homo islamicus de l’autre. Alors, avec ses vers, il ambitionne de réveiller Safi – qui «compte le plus grand nombre de fous au pays» – de sa torpeur.
Lui n’est pas fou. Il semble plutôt fou de rage de constater la déchéance de sa ville «où les habitants (…) croupissent gentiment, de génération en génération, dans le confort abrutissant de leurs convictions religieuses». Alors, depuis les haut-parleurs du minaret de la mosquée, Moncef appelle au sursaut, à la révolte. Cet acte de pure folie lui vaut un lynchage public jusqu’à l’intervention de la police. Mais, dans un pays où l’islam est la religion de l’État et le roi commandeur des croyants, il devient hors-la-loi. Hors des lois religieuses. Hors des lois étatiques. Entre les islamistes qui veulent sa mort et les pouvoirs publics qui entendent le punir de façon exemplaire, la seule alternative qui semble en définitive s’offrir à lui est la voie de l’exil. Tel un poète maudit. «La poésie ne rapporte rien à son auteur (…). Ou alors, parfois, des ennuis, voire des coups.»
De sa poésie, Moncef n’en vit pas. Pas plus que ses camarades d’infortune qui, pourtant, ont suivi des études supérieures dans l’espoir de trouver un emploi. Ils demeurent ainsi cantonnés à leur triste sort. Depuis le Café Tanjrifte, «un point de chute où de pauvres bougres de la Médina se donnent rendez-vous pour dévider leurs revers de fortune et ruminer leurs chagrins à longueur de journée», les trois amis rêvent de prose, de reconnaissance et d’un devenir éclairé, bien loin du tumulte consternant d’un ignorantisme annihilant l’instruction: «Les écoles et universités fabriquent chaque année des légions d’incultes et d’obscurantistes, plus capables de barbarie que d’actes civilisés; le Livre fait la chasse aux livres, les écrivains végètent dans la gêne et l’indifférence, l’intelligence s’éteint, le beau décline, l’esprit critique se meurt, la bêtise bat son plein. Il est écrit quelque part dans la fameuse Mouqaddima d’Ibn Khaldun, encore lui, que lorsqu’une nation opte pour la débilisation massive de ses citoyens, sa fin devient imminente.»
Selon Moncef, l’un des symboles les plus emblématiques de cette débilisation massive, de ce déclin du beau, de cette extinction de l’esprit critique est la statue d’un tagine géant trônant au milieu de la place Mohamed V. «Les Safiots parlent de leur tagine comme d’une merveille du monde, avec émotion et fierté, un peu comme les Égyptiens parlent de leur pyramide ou les Chinois de leur muraille.» Voir Safi décliner ainsi alimente la rage et exacerbe le sentiment de révolte de Moncef qui, en prenant la parole du haut d’un minaret, s’impose un peu comme un homme providentiel, un messie, un prêcheur venu psalmodier la bonne parole pour éveiller les consciences. Une mission sans doute vouée à l’échec. «Pensent-ils seulement déjà, les gens d’ici?»
L’acte de Moncef est celui d’un enragé, d’un désespéré («Peut-être est-ce la certitude de périr qui me rend si audacieux»), tâchant de repousser avec ses mots la fin imminente de Safi. Un port naguère prospère où l’espoir s’éteint et les rêves se brisent dans l’écume iodée de l’océan; une ville en proie au déterminisme social et à la corruption; une cité grignotée par l’islamisme et la sottise crasse des prédicateurs. «Je n’ai ni travail, ni espoir d’en trouver, ni accointances haut perchées à Rabat, ni oncle en Amérique, ni sœur aux Émirats. En quelques mois, ma mère a rendu l’âme, mon père a convolé en justes noces, ma copine m’a largué. Y’a-t-il enfer aussi atroce que le mien?»
Avec Le Poète de Safi, Mohamed Nedali signe un roman courageux, dénonçant les dérives d’une société recroquevillée, résignée, qui s’en remet à la religion ou la paresse intellectuelle pour mieux supporter son sort. Il regrette surtout la renonciation à tout esprit critique, le dédain pour les humanités, l’indifférence envers l’esthétique ou l’histoire. Le Poète de Safi est un hymne à la révolte, un appel à la résistance contre l’obscurantisme qui emporte Safi et son âme. C’est aussi un regard aimant sur ce port marocain chargé d’histoire qui se noie sous les sanglots du poète.
Le poète de Safi de Mohamed Nedali, éditions de l’Aube, 2021, 268 p.
Par Florent Benoit
Cet article a été originalement publié sur le blog Mare Nostrum.
Moncef est un rêveur lucide, acide, irrévérencieux, qui, à défaut de croire en un Dieu tout-puissant («La religion est, pour moi, une invention purement humaine, une construction sociale et culturelle, un moyen d’assurer la cohésion de la société»), voue une «passion pour la poésie arabe préislamique, celle d’Imrou l’Qays, prince triplement fou, de poésie, d’amour et d’errance». Il croit en la vertu des rimes, la puissance des mots. Avec ses deux meilleurs amis, Saïd et Najib, il se désole de voir la ville qu’il chérit sombrer dans l’ignorance et l’obscurantisme entre les Égarés d’un côté et les Homo islamicus de l’autre. Alors, avec ses vers, il ambitionne de réveiller Safi – qui «compte le plus grand nombre de fous au pays» – de sa torpeur.
Lui n’est pas fou. Il semble plutôt fou de rage de constater la déchéance de sa ville «où les habitants (…) croupissent gentiment, de génération en génération, dans le confort abrutissant de leurs convictions religieuses». Alors, depuis les haut-parleurs du minaret de la mosquée, Moncef appelle au sursaut, à la révolte. Cet acte de pure folie lui vaut un lynchage public jusqu’à l’intervention de la police. Mais, dans un pays où l’islam est la religion de l’État et le roi commandeur des croyants, il devient hors-la-loi. Hors des lois religieuses. Hors des lois étatiques. Entre les islamistes qui veulent sa mort et les pouvoirs publics qui entendent le punir de façon exemplaire, la seule alternative qui semble en définitive s’offrir à lui est la voie de l’exil. Tel un poète maudit. «La poésie ne rapporte rien à son auteur (…). Ou alors, parfois, des ennuis, voire des coups.»
De sa poésie, Moncef n’en vit pas. Pas plus que ses camarades d’infortune qui, pourtant, ont suivi des études supérieures dans l’espoir de trouver un emploi. Ils demeurent ainsi cantonnés à leur triste sort. Depuis le Café Tanjrifte, «un point de chute où de pauvres bougres de la Médina se donnent rendez-vous pour dévider leurs revers de fortune et ruminer leurs chagrins à longueur de journée», les trois amis rêvent de prose, de reconnaissance et d’un devenir éclairé, bien loin du tumulte consternant d’un ignorantisme annihilant l’instruction: «Les écoles et universités fabriquent chaque année des légions d’incultes et d’obscurantistes, plus capables de barbarie que d’actes civilisés; le Livre fait la chasse aux livres, les écrivains végètent dans la gêne et l’indifférence, l’intelligence s’éteint, le beau décline, l’esprit critique se meurt, la bêtise bat son plein. Il est écrit quelque part dans la fameuse Mouqaddima d’Ibn Khaldun, encore lui, que lorsqu’une nation opte pour la débilisation massive de ses citoyens, sa fin devient imminente.»
Selon Moncef, l’un des symboles les plus emblématiques de cette débilisation massive, de ce déclin du beau, de cette extinction de l’esprit critique est la statue d’un tagine géant trônant au milieu de la place Mohamed V. «Les Safiots parlent de leur tagine comme d’une merveille du monde, avec émotion et fierté, un peu comme les Égyptiens parlent de leur pyramide ou les Chinois de leur muraille.» Voir Safi décliner ainsi alimente la rage et exacerbe le sentiment de révolte de Moncef qui, en prenant la parole du haut d’un minaret, s’impose un peu comme un homme providentiel, un messie, un prêcheur venu psalmodier la bonne parole pour éveiller les consciences. Une mission sans doute vouée à l’échec. «Pensent-ils seulement déjà, les gens d’ici?»
L’acte de Moncef est celui d’un enragé, d’un désespéré («Peut-être est-ce la certitude de périr qui me rend si audacieux»), tâchant de repousser avec ses mots la fin imminente de Safi. Un port naguère prospère où l’espoir s’éteint et les rêves se brisent dans l’écume iodée de l’océan; une ville en proie au déterminisme social et à la corruption; une cité grignotée par l’islamisme et la sottise crasse des prédicateurs. «Je n’ai ni travail, ni espoir d’en trouver, ni accointances haut perchées à Rabat, ni oncle en Amérique, ni sœur aux Émirats. En quelques mois, ma mère a rendu l’âme, mon père a convolé en justes noces, ma copine m’a largué. Y’a-t-il enfer aussi atroce que le mien?»
Avec Le Poète de Safi, Mohamed Nedali signe un roman courageux, dénonçant les dérives d’une société recroquevillée, résignée, qui s’en remet à la religion ou la paresse intellectuelle pour mieux supporter son sort. Il regrette surtout la renonciation à tout esprit critique, le dédain pour les humanités, l’indifférence envers l’esthétique ou l’histoire. Le Poète de Safi est un hymne à la révolte, un appel à la résistance contre l’obscurantisme qui emporte Safi et son âme. C’est aussi un regard aimant sur ce port marocain chargé d’histoire qui se noie sous les sanglots du poète.
Le poète de Safi de Mohamed Nedali, éditions de l’Aube, 2021, 268 p.
Par Florent Benoit
Cet article a été originalement publié sur le blog Mare Nostrum.
Lire aussi



Commentaires