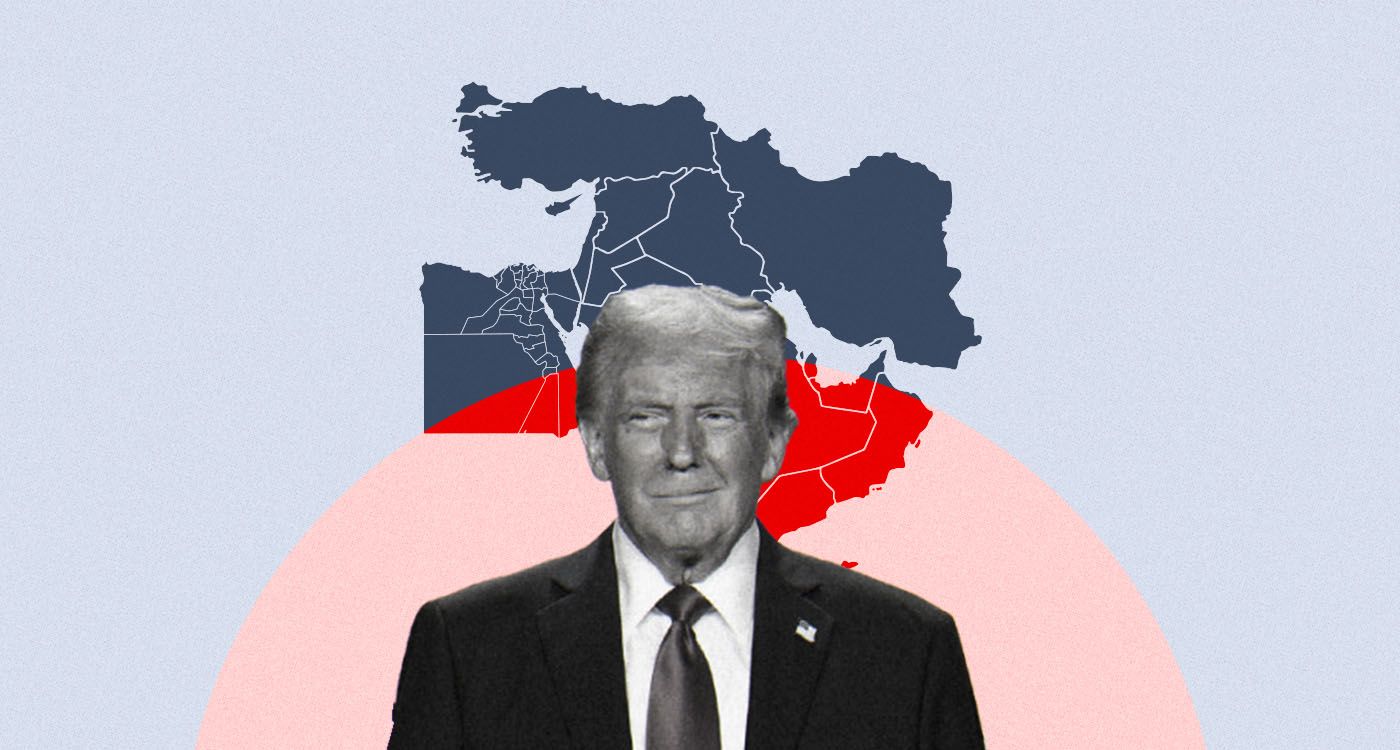
La tournée de Donald Trump en Arabie saoudite, au Qatar et aux Émirats arabes unis n’avait rien d’une simple visite protocolaire dictée par des impératifs économiques ou sécuritaires. Elle s’est imposée comme un tournant décisif, aux effets dépassant largement le cadre bilatéral, redéfinissant les rapports de force au Moyen-Orient. Préparée en amont, cette visite avait un objectif clairement affiché: insuffler une dynamique de paix régionale durable, sous l’égide de la Pax Americana et enclencher un processus de réorganisation géopolitique fondé sur de nouveaux équilibres.
En trois jours à peine, le président américain a multiplié les signaux forts: messages sans équivoque à l’adresse de Téhéran, relance de partenariats stratégiques avec les monarchies du Golfe, sécurisation d’investissements colossaux et, surtout, lancement d’une vision d’ensemble, structurée autour de la fin des conflits et de l’intégration progressive des États exclus jusque-là des grands équilibres régionaux. Avant de quitter la région, Trump l’a affirmé: «Le monde ira mieux dans les semaines à venir», réitérant son ambition de tourner la page des guerres sans fin.
Le moment le plus spectaculaire de cette tournée fut sans conteste la rencontre, hautement symbolique, entre Trump et le président syrien Ahmad el-Chareh, une première depuis un quart de siècle entre dirigeants syrien et américain. À la demande du prince héritier d’Arabie saoudite Mohammed ben Salmane, Trump a annoncé la levée des sanctions contre la Syrie et invité Damas à rejoindre les accords d’Abraham aux côtés d’Israël. Un geste fort, porteur d’un message de réintégration, mais assorti d’exigences fermes: interdiction des opérations contre Israël depuis le territoire syrien, expulsion des factions palestiniennes considérées comme terroristes par Washington et rupture totale avec l’axe irano-hezbollahi.
Damas, de son côté, semble avoir anticipé ce virage. Depuis son arrivée au pouvoir, Ahmad el-Chareh a interdit le port d’armes aux Palestiniens sur le sol syrien, expulsé les Gardiens de la révolution, chassé les combattants du Hezbollah et saisi leurs dépôts d’armes. Il s’attelle désormais à un autre défi: débarrasser le pays de tous les combattants non syriens impliqués dans le coup d’État. Washington salue ces gestes, notamment la décision de sécuriser la frontière libano-syrienne pour couper les routes de contrebande et rompre le pont terrestre reliant l’Iran au Hezbollah.
Dans ce nouveau paysage, le Liban s’est illustré par son absence des rencontres clés. Une exclusion que des sources diplomatiques attribuent au blocage de deux dossiers prioritaires: l’absence de réformes structurelles et l’incapacité à imposer le monopole des armes par l’État. Pourtant, Trump a tenu à adresser un message direct au président libanais Joseph Aoun, dénonçant l’emprise de l’Iran et du Hezbollah, tout en saluant l’émergence d’une nouvelle direction politique qu’il juge sincèrement engagée pour le changement. Pour Washington, le Liban a désormais une «opportunité unique» de bâtir un État stable et souverain, libéré de l’influence des milices.
La clé de cette transformation réside dans une clarification des choix stratégiques. Le Liban est appelé à renouer avec la doctrine de neutralité positive, longtemps défendue depuis l’indépendance, pour ne plus servir de plateforme aux acteurs du camp dit de la «résistance». Le pays, rappellent certains diplomates, continue de payer le prix d’un engagement sans issue dans la cause palestinienne, sachant que les répercussions pèsent toujours sur sa stabilité.
À l’échelle régionale, le message adressé à Téhéran ne souffrait d’aucune ambiguïté: abandonner définitivement l’arme nucléaire, cesser les guerres par procuration et contribuer activement à la stabilité. En réponse, l’Iran a demandé aux Houthis de suspendre leurs attaques contre les navires américains. En outre, Ali Shamkhani, conseiller du guide suprême, a déclaré que Téhéran ne produira pas d’armes nucléaires, qu’il se débarrassera de son stock d’uranium enrichi et qu’il acceptera une supervision internationale. En échange, il réclame la levée des sanctions économiques qui étranglent le pays.
En Irak, plusieurs figures chiites majeures, dont Ali al-Sistani et Moqtada al-Sadr, ont réitéré leur position: le port d’armes doit être réservé à l’État. Une doctrine déjà partagée par Ahmad el-Chareh qui a réservé l’usage des armes aux seules institutions militaires syriennes.
Quant au Liban, il pourrait voir un tournant se dessiner à l’occasion de la visite du président palestinien Mahmoud Abbas, attendue le 21 mai à Beyrouth. Selon une source bien informée, cette rencontre pourrait permettre d’ouvrir un chantier concret: retrait des armes illégales, notamment dans les camps, et mise en œuvre intégrale de la résolution 1701 du Conseil de sécurité. Le même plan prévoit le placement des dépôts d’armes lourdes sous autorité étatique exclusive. Ce projet, porté discrètement par les autorités libanaises, est perçu comme un préalable indispensable à toute relance diplomatique de haut niveau, incluant une possible rencontre entre Joseph Aoun, Donald Trump et d’autres dirigeants.
Mais le temps joue contre Beyrouth. «La fenêtre de tir se rétrécit», prévient cette même source, soulignant que le président libanais serait déterminé à enclencher la mise en œuvre effective du monopole des armes par l’État dès la fin de la visite d’Abbas. Une condition sine qua non pour sortir de l’isolement, débloquer l’aide internationale et inscrire enfin le Liban dans la nouvelle équation régionale.




Commentaires