
Les initiatives de l’Institut français au Liban se suivent sans se ressembler. Force est de constater qu’un pays moribond a besoin de se projeter dans une vitalité que seule la culture peut lui offrir. La France, à travers ses Instituts, s’emploie, par tous les moyens possibles, à apporter un doux réconfort à un peuple exsangue. Entre l’exposition Beyrouth, une ville à l’œuvre aux usines Abroyan qui est d’un éclectisme sans égal, la perspective de Beyrouth Livres 2022 et des multiples manifestations qui se tiendront onze jours d’affilée, avec, cerise sur le gâteau, la présence des auteurs de l’Académie Goncourt qui proclamera la liste des finalistes depuis Beyrouth, que peut-on espérer de plus? Cet acte de résistance culturelle puissant arrive au moment où le mandat présidentiel prend fin et que le pays du Cèdre pourrait bien être livré à un chaos sans précédent…

Ici Beyrouth reprend la double interview de l’Agenda Culturel, média partenaire, qui a donné la parole à Bénédicte Vigner, attachée culturelle à l’Ambassade de France au Liban, et Hala Younes, commissaire du projet «Beyrouth, une ville à l’œuvre» aux usines Abroyan.
Quelle place possèdent l’art et la culture dans la réinvention du Liban?
Bénédicte Vigner (B.V.): L’art est essentiel à la santé de la société, son rôle est d’analyser son fonctionnement en montrant ce qu’elle a de meilleur ou de pire, de développer l'ouverture d’esprit, les facultés d’attention et de tolérance de l’homme. Une ville comme Beyrouth constitue une source d’inspiration et d’investissement pour les artistes qui y voient un réservoir riche de potentialités multiples. Par la diversité de son bâti, son histoire, ses traumatismes, cette ville constitue un argument artistique inépuisable pour la création. Les artistes, par leur présence dans la ville, peuvent contribuer à la vie sociale et à l’attractivité urbaine, ils peuvent inciter à porter un autre regard sur l’environnement par exemple en investissant des lieux délaissés, des lieux industriels et en les transformant en lieux de vie et d’art. Nombreux sont les exemples de regroupements d’artistes qui ont contribué à l’invention de véritables quartiers d’art (l’usine de Genève, les Halles de Schaerbeek à Bruxelles ou La friche belle de mai à Marseille), qui cherchent à accommoder travail artistique et nouvelle urbanité. Aujourd’hui la culture, dans une grande partie du monde, n’est plus abordée comme une cerise sur le gâteau, mais comme un atout nécessaire pour la prospérité des villes. Des villes comme Lille en 2004 ont profité du label «capitale culturelle européenne» pour revitaliser leur image, lui donner un coup de jeune et prendre un nouvel élan économique. Le patrimoine fait aujourd’hui l’objet d’une plus grande attention de la part des villes. Les vieilles pierres, les friches industrielles, sont les instruments d’une pédagogie de l’histoire et de la mémoire destinées à renforcer le lien social entre les habitants. Il faut souligner l’importance du secteur culturel sur le plan économique, la culture représentant un volume conséquent d’emplois directs. L’art et la culture sont un chantier possible pour transformer ou réenchanter le Liban.
Pourquoi avoir choisi les usines Abroyan comme lieu d’exposition?
B.V.: C’est un lieu magnifique du fait de son architecture et émouvant parce qu’il porte en lui la mémoire de la classe ouvrière de Bourj Hammoud qui faisait vivre plus de 500 familles du quartier. J’y suis personnellement sensible parce que nous avons, avec mon frère qui est metteur en scène, commencé notre aventure théâtrale dans une ancienne matelasserie désaffectée à Issy-les-Moulineaux. Mais j’ai surtout pensé aux Usines LU à Nantes, une biscuiterie emblématique de la ville dont le produit phare était le Petit Beurre qui a marqué la mémoire de plusieurs générations. Quand l’usine a été désaffectée, ses bâtiments progressivement détruits, des artistes, dont Royal de Luxe, se sont appropriés la friche et en ont fait un lieu de création atypique dans les années 1990. Jean Blaise, homme de théâtre, a alors convaincu la ville de Nantes de conserver l’édifice et de le transformer en lieu de vie et de culture. C’est l’architecte Patrick Bouchain qui a œuvré à sa réhabilitation, et le «lieu unique», né en 2000, a propulsé la ville sur le plan culturel et est aujourd’hui internationalement reconnu pour son esprit de curiosité dans tous les domaines de l’art. Je pense que c’était aussi l’ambition de Marc Hadifé, propriétaire des usines Abroyan, de faire de ce lieu un centre dédié à la culture et à la création contemporaine avant que la crise ne vienne stopper cet élan. Inscrire le projet «Beyrouth, une ville à l’œuvre» aux usines Abroyan est une façon de rendre hommage et donner, je l’espère, un nouveau souffle à cette aspiration.
*François Delarozière, est intervenu le 29 septembre, à 19h, aux usines Abroyan. Il a été le collaborateur de Royal de Luxe et le créateur de certaines des machines de leurs spectacles jusqu’en 2005.
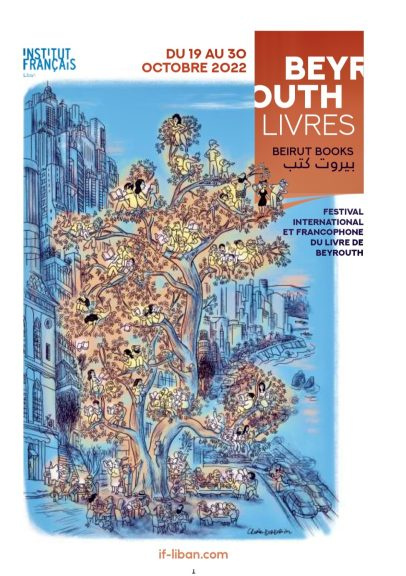
Que cherchez-vous à diffuser avec cette exposition?
Hala Younes (H.Y.): Ce que nous cherchons à promouvoir au travers de cette exposition est un nouveau souffle pour Beyrouth, une nouvelle vocation. Nous avançons l’idée que Beyrouth, en tant que ville d’art et de culture et capitale des industries créatives, est une ville bien plus belle et intéressante que la capitale du commerce et de la finance. C’est la raison pour laquelle, avec Bénédicte Vigner, nous avons choisi d’exposer dans une manufacture abandonnée à Bourj Hammoud pour remettre à l’honneur la créativité, l’inventivité et le capital humain qui sont les vraies richesses des Beyrouthins et que personne ne peut leur enlever.
C’est pour cela qu’en plus du volet urbain qui traite du rez-de-chaussée de la ville, «Beyrouth, une ville à l’œuvre» met l’accent sur les adolescents de la ville qui découvrent ce que peut être leur avenir et qui ont la capacité de dessiner celui qui leur convient. Un autre volet est consacré aux artistes de Beyrouth qui en ont traversé toutes les crises depuis quarante ans et qui continuent à croire et à se nourrir de cette ville.
Que signifie pour vous un «rez-de-ville» ?
H.Y. : «Rez-de-ville» est un néologisme inventé par l’urbaniste français David Mangin qui est le coordinateur de cette recherche. L’idée est de regarder ce niveau de la ville qui englobe le rez-de-chaussée des bâtiments, mais aussi les cours et les jardins, et l’espace public en général, car c’est un niveau déterminant de la qualité de vie dans une grande ville. C’est en effet celui que l’on parcourt en tant que piéton, dans la vie quotidienne, pour se rendre à son lieu de travail, pour faire ses courses, sur le chemin de l’école, mais aussi pour les rassemblements politiques ou festifs. Malheureusement, cet espace est trop souvent pensé pour la voiture et rendu impraticable et inhabitable. L’idée de ce projet de recherche est de dresser un inventaire de toutes les manières de vivre dans ce rez-de-chaussée de la ville à travers des dessins, des photos et des enquêtes de par le monde. Nous avons ainsi pu balayer beaucoup d’idées reçues, par exemple: le rez-de-chaussée n’est pas forcément commercial!... Ensuite, forts de cette expérience, nous proposons de nouvelles manières de penser des villes plus agréables pour le piéton, plus écologiques et plus habitables en rez-de-chaussée. Tout cela sera discuté lors de la discussion organisée le 29 septembre à 19h.
Quels sont les sujets critiques du rez-de-ville de Beyrouth?
H.Y.: En l’absence de transport public, l’espace urbain de Beyrouth est très fortement marqué par la voiture. Toutes les rues sont envahies par le stationnement, devant et derrière les immeubles, et sous les pilotis quand ils existent (quand ce ne se sont pas les voitures, ce sont les réservoirs d’eau, les générateurs, les conteneurs à ordures et les barrières de sécurité). Les trottoirs sont rarement dessinés et rien n’est fait pour permettre de marcher dans la ville. Pourtant avec le prix de l’énergie, cette question devient vitale, les gens n’ayant plus les moyens de se rendre à leur travail, ni les professeurs à leurs écoles, ni les étudiants à leurs universités. L’économie ne pourra pas redémarrer sans une vision urgente pour le transport en commun et il n’est pas besoin pour cela d’attendre les subsides de la banque mondiale. L’observation de rez-de-ville de Beyrouth montre que si nous n’avons pas de transports publics, il existe en revanche beaucoup de transports en commun informels: minivans, services, bus privés, et autres Connex. Les gens qui n’ont pas les moyens de payer l’essence se débrouillent comme ils peuvent, sur l’autoroute on croise des gens à vélo, à trottinette, c’est incroyable, il suffit d’ouvrir les yeux! Malheureusement tout cela est extrêmement dangereux, vétuste et peu recommandable pour les jeunes femmes seules. Ce secteur est complètement abandonné, et l’état n’a jamais pris la peine de composer avec l’initiative privée. Or il suffit d’organiser un minimum, de lutter contre le harcèlement sexuel, de canaliser et d’enrichir le secteur existant pour offrir la possibilité à tous les Libanais de se déplacer sans voiture. Ceci est à portée de main immédiatement; plus tard, nous aurons toujours le temps de nous endetter et de rêver à des métros et des trains rapides.
Propos recueillis par Maureen Dufournet pour l’Agenda Culturel.

Ici Beyrouth reprend la double interview de l’Agenda Culturel, média partenaire, qui a donné la parole à Bénédicte Vigner, attachée culturelle à l’Ambassade de France au Liban, et Hala Younes, commissaire du projet «Beyrouth, une ville à l’œuvre» aux usines Abroyan.
Quelle place possèdent l’art et la culture dans la réinvention du Liban?
Bénédicte Vigner (B.V.): L’art est essentiel à la santé de la société, son rôle est d’analyser son fonctionnement en montrant ce qu’elle a de meilleur ou de pire, de développer l'ouverture d’esprit, les facultés d’attention et de tolérance de l’homme. Une ville comme Beyrouth constitue une source d’inspiration et d’investissement pour les artistes qui y voient un réservoir riche de potentialités multiples. Par la diversité de son bâti, son histoire, ses traumatismes, cette ville constitue un argument artistique inépuisable pour la création. Les artistes, par leur présence dans la ville, peuvent contribuer à la vie sociale et à l’attractivité urbaine, ils peuvent inciter à porter un autre regard sur l’environnement par exemple en investissant des lieux délaissés, des lieux industriels et en les transformant en lieux de vie et d’art. Nombreux sont les exemples de regroupements d’artistes qui ont contribué à l’invention de véritables quartiers d’art (l’usine de Genève, les Halles de Schaerbeek à Bruxelles ou La friche belle de mai à Marseille), qui cherchent à accommoder travail artistique et nouvelle urbanité. Aujourd’hui la culture, dans une grande partie du monde, n’est plus abordée comme une cerise sur le gâteau, mais comme un atout nécessaire pour la prospérité des villes. Des villes comme Lille en 2004 ont profité du label «capitale culturelle européenne» pour revitaliser leur image, lui donner un coup de jeune et prendre un nouvel élan économique. Le patrimoine fait aujourd’hui l’objet d’une plus grande attention de la part des villes. Les vieilles pierres, les friches industrielles, sont les instruments d’une pédagogie de l’histoire et de la mémoire destinées à renforcer le lien social entre les habitants. Il faut souligner l’importance du secteur culturel sur le plan économique, la culture représentant un volume conséquent d’emplois directs. L’art et la culture sont un chantier possible pour transformer ou réenchanter le Liban.
Pourquoi avoir choisi les usines Abroyan comme lieu d’exposition?
B.V.: C’est un lieu magnifique du fait de son architecture et émouvant parce qu’il porte en lui la mémoire de la classe ouvrière de Bourj Hammoud qui faisait vivre plus de 500 familles du quartier. J’y suis personnellement sensible parce que nous avons, avec mon frère qui est metteur en scène, commencé notre aventure théâtrale dans une ancienne matelasserie désaffectée à Issy-les-Moulineaux. Mais j’ai surtout pensé aux Usines LU à Nantes, une biscuiterie emblématique de la ville dont le produit phare était le Petit Beurre qui a marqué la mémoire de plusieurs générations. Quand l’usine a été désaffectée, ses bâtiments progressivement détruits, des artistes, dont Royal de Luxe, se sont appropriés la friche et en ont fait un lieu de création atypique dans les années 1990. Jean Blaise, homme de théâtre, a alors convaincu la ville de Nantes de conserver l’édifice et de le transformer en lieu de vie et de culture. C’est l’architecte Patrick Bouchain qui a œuvré à sa réhabilitation, et le «lieu unique», né en 2000, a propulsé la ville sur le plan culturel et est aujourd’hui internationalement reconnu pour son esprit de curiosité dans tous les domaines de l’art. Je pense que c’était aussi l’ambition de Marc Hadifé, propriétaire des usines Abroyan, de faire de ce lieu un centre dédié à la culture et à la création contemporaine avant que la crise ne vienne stopper cet élan. Inscrire le projet «Beyrouth, une ville à l’œuvre» aux usines Abroyan est une façon de rendre hommage et donner, je l’espère, un nouveau souffle à cette aspiration.
*François Delarozière, est intervenu le 29 septembre, à 19h, aux usines Abroyan. Il a été le collaborateur de Royal de Luxe et le créateur de certaines des machines de leurs spectacles jusqu’en 2005.
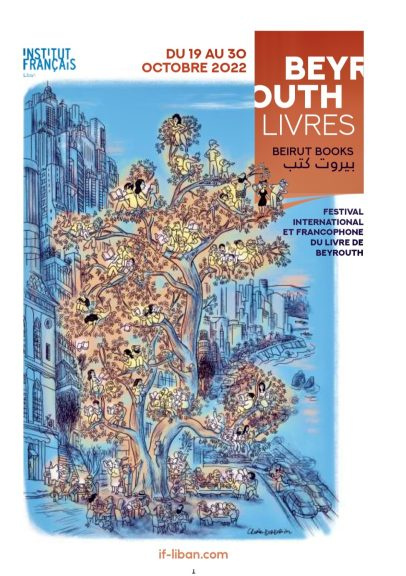
Que cherchez-vous à diffuser avec cette exposition?
Hala Younes (H.Y.): Ce que nous cherchons à promouvoir au travers de cette exposition est un nouveau souffle pour Beyrouth, une nouvelle vocation. Nous avançons l’idée que Beyrouth, en tant que ville d’art et de culture et capitale des industries créatives, est une ville bien plus belle et intéressante que la capitale du commerce et de la finance. C’est la raison pour laquelle, avec Bénédicte Vigner, nous avons choisi d’exposer dans une manufacture abandonnée à Bourj Hammoud pour remettre à l’honneur la créativité, l’inventivité et le capital humain qui sont les vraies richesses des Beyrouthins et que personne ne peut leur enlever.
C’est pour cela qu’en plus du volet urbain qui traite du rez-de-chaussée de la ville, «Beyrouth, une ville à l’œuvre» met l’accent sur les adolescents de la ville qui découvrent ce que peut être leur avenir et qui ont la capacité de dessiner celui qui leur convient. Un autre volet est consacré aux artistes de Beyrouth qui en ont traversé toutes les crises depuis quarante ans et qui continuent à croire et à se nourrir de cette ville.
Que signifie pour vous un «rez-de-ville» ?
H.Y. : «Rez-de-ville» est un néologisme inventé par l’urbaniste français David Mangin qui est le coordinateur de cette recherche. L’idée est de regarder ce niveau de la ville qui englobe le rez-de-chaussée des bâtiments, mais aussi les cours et les jardins, et l’espace public en général, car c’est un niveau déterminant de la qualité de vie dans une grande ville. C’est en effet celui que l’on parcourt en tant que piéton, dans la vie quotidienne, pour se rendre à son lieu de travail, pour faire ses courses, sur le chemin de l’école, mais aussi pour les rassemblements politiques ou festifs. Malheureusement, cet espace est trop souvent pensé pour la voiture et rendu impraticable et inhabitable. L’idée de ce projet de recherche est de dresser un inventaire de toutes les manières de vivre dans ce rez-de-chaussée de la ville à travers des dessins, des photos et des enquêtes de par le monde. Nous avons ainsi pu balayer beaucoup d’idées reçues, par exemple: le rez-de-chaussée n’est pas forcément commercial!... Ensuite, forts de cette expérience, nous proposons de nouvelles manières de penser des villes plus agréables pour le piéton, plus écologiques et plus habitables en rez-de-chaussée. Tout cela sera discuté lors de la discussion organisée le 29 septembre à 19h.
Quels sont les sujets critiques du rez-de-ville de Beyrouth?
H.Y.: En l’absence de transport public, l’espace urbain de Beyrouth est très fortement marqué par la voiture. Toutes les rues sont envahies par le stationnement, devant et derrière les immeubles, et sous les pilotis quand ils existent (quand ce ne se sont pas les voitures, ce sont les réservoirs d’eau, les générateurs, les conteneurs à ordures et les barrières de sécurité). Les trottoirs sont rarement dessinés et rien n’est fait pour permettre de marcher dans la ville. Pourtant avec le prix de l’énergie, cette question devient vitale, les gens n’ayant plus les moyens de se rendre à leur travail, ni les professeurs à leurs écoles, ni les étudiants à leurs universités. L’économie ne pourra pas redémarrer sans une vision urgente pour le transport en commun et il n’est pas besoin pour cela d’attendre les subsides de la banque mondiale. L’observation de rez-de-ville de Beyrouth montre que si nous n’avons pas de transports publics, il existe en revanche beaucoup de transports en commun informels: minivans, services, bus privés, et autres Connex. Les gens qui n’ont pas les moyens de payer l’essence se débrouillent comme ils peuvent, sur l’autoroute on croise des gens à vélo, à trottinette, c’est incroyable, il suffit d’ouvrir les yeux! Malheureusement tout cela est extrêmement dangereux, vétuste et peu recommandable pour les jeunes femmes seules. Ce secteur est complètement abandonné, et l’état n’a jamais pris la peine de composer avec l’initiative privée. Or il suffit d’organiser un minimum, de lutter contre le harcèlement sexuel, de canaliser et d’enrichir le secteur existant pour offrir la possibilité à tous les Libanais de se déplacer sans voiture. Ceci est à portée de main immédiatement; plus tard, nous aurons toujours le temps de nous endetter et de rêver à des métros et des trains rapides.
Propos recueillis par Maureen Dufournet pour l’Agenda Culturel.
Lire aussi



Commentaires