
La science-fiction, autrement désignée par la «fiction spéculative», ou encore par l’«anticipation», est un genre narratif à part entière, et cela depuis plusieurs siècles, en tout cas depuis les débuts des temps modernes. Et même si les historiens génériques ne tombent pas d’accord sur la datation de la genèse de la science-fiction (les uns voulant remonter jusqu’au IIe siècle avec les Histoires vraies de Lucien de Samosate, lesquelles relatent un voyage dans l’espace, pendant que les autres objectent qu’on ne saurait parler de science-fiction avant l’avènement des sciences appliquées en bonne et due forme), nous savons qu’il est possible de remonter au moins au XVIIe siècle, en l’occurrence avec The Man in the Moon or a Discourse of a Voyage Thither by Domingo Gonsales (1638) de Francis Godwin, Voyages aux États de la Lune et du Soleil (1657) de Cyrano de Bergerac, et en allant vers le XVIIIe et le XIXe siècle avec Micromégas (1752) de Voltaire, Frankenstein ou le Prométhée moderne (1818) de Mary Shelly, De la Terre à la Lune (1865) de Jules Verne, etc.
La rentrée littéraire
Tous les ans, à l’entame du mois de septembre, les francophiles du monde entier, amoureux de la littérature, en l’occurrence du roman français ou francophone actuel, attendent impatiemment la rentrée littéraire avec sa pléthore de parutions dont certaines ont la chance d’entrer en lice pour concourir à un prix ou à un autre.
La rentrée de septembre 2022 est, pour sa part, notamment marquée par le grand retour des récits de science-fiction, parmi lesquels certains proposent, en l’occurrence, la découverte de nouveaux paysages eschatologiques. Je pourrais évoquer à titre illustratif trois parmi eux: Les Tout puissants de Mirwais Ahmadzaï, Chien 51 de Laurent Gaudé et Les Liens artificiels de Nathan Devers, dont je suis personnellement persuadée qu’il a toutes les chances d’obtenir le Goncourt de cette année.
Dans Les Tout puissants, Mirwais Ahmadzaï met en scène une ville de Paris métamorphosée, voire littéralement aliénée par l’exercice omnipotent d’un capitalisme sauvage et criminel, une ville dans le labyrinthe de laquelle le personnage, Lazare, représentant de tous les hommes au final, lutte – sans doute vainement – pour sauvegarder un tant soit peu les derniers lambeaux d’une humanité en voie de disparition.

Dans Chien 51, Laurent Gaudé campe, quant à lui, un personnage du nom de Zem Sparak qui, ayant trahi son pays en faillite, la Grèce, lequel d’ailleurs s’est complètement anéanti, devient «chien», c’est-à-dire policier dans une mégalopole privatisée où il perd son âme, si ce n’était cette boîte de nuit du quartier RedQ où il écoule ses nuits, branché à une technologie anticipative en regard de notre actualité et addictive du nom d’Okios, qui lui donne l’illusion, par ailleurs inutile, de pouvoir retrouver l’Athènes de sa jeunesse.
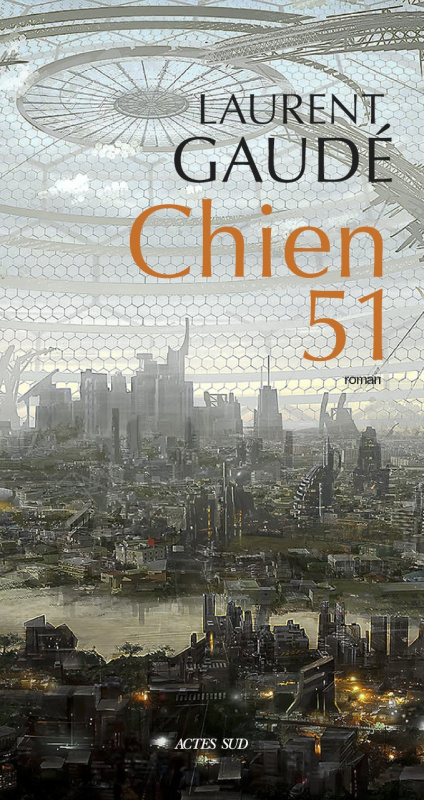
Enfin, dans Les Liens artificiels, Nathan Devers présente Julien, un personnage déçu en tous points par la vie réelle et, qui, découvrant au tournant de son scrolling addictif, un métavers labellisé l’Antimonde, un monde de l’autre côté du miroir, y plonge tout entier, jusqu’au grand plongeon ultime, pour sa part, bien réel.

On aura noté que, dans les trois cas de figure, les auteurs usent de dystopie et de cyberpunk pour suggérer et donner à imaginer, sans détour aucun, ce à quoi nos sociétés actuelles, technologiquement avancées, vont sous peu parvenir. Un futur de fin de l’humanité et du monde, provoquée par le cheminement que ceux-ci empruntent depuis un temps. Paul Watzlawick, le bien notoire fondateur de l’École systémique de Palo Alto, n’affirmait-il pas d’ailleurs, avec force conviction, que le futur se décide, voire se fait au présent?
Le monde d’aujourd’hui: source intarissable d’inspiration pour la science-fiction
Quoi qu’il en soit, ce point commun entre les trois romans que j’évoque ne saurait être anodin. La science-fiction, saisissons-nous-en dans une acception large, celle de la réalité autre, de la méta-réalité, de la surréalité, de la post-réalité, ne serait-elle pas vraiment à l’œuvre, à l’heure actuelle, quasiment partout dans le monde? Celui-ci ne court-il donc pas à son anéantissement comme dans les plus célèbres dystopies du XXe siècle, en l’occurrence Le Meilleur des mondes (1931) d’Aldous Huxley, Ravage (1943) de René Barjavel (où justement une gigantesque panne d'électricité paralyse le monde dans son entièreté), La Ferme des animaux (1945) et 1984 (1949) de George Orwell, Fahrenheit 451 (1953) de Ray Bradbury, et j’en passe?
Lorsque l’on suit les nouvelles au quotidien de la guerre russo-ukrainienne et de ses répercussions partout dans le monde, lorsque l’on apprend les hostilités qui opposent l’Arménie et l’Azerbaïdjan, les tensions entre la Chine et Taïwan, celles entre la Corée du Nord et le Japon, les insurrections au Burkina-Faso, les affrontements entre l’Érythrée et l’Éthiopie, les conflits qui déchirent le Yémen, le Myanmar, l’Afghanistan et j’en passe tout autant, force est de se rendre à l’évidence du paysage eschatologique que le monde d’aujourd’hui donne à regarder et, pis encore, à éprouver, énorme matrice pour l’imagination anticipative et dystopique des romanciers.
Et si l’on parlait de notre Liban?
Venons-en au Liban: très sincèrement, quoi donc de plus science-fictionnel qu’un État qui laisse ses citoyens malades sans médication, notamment les dialysés et les cancéreux parmi eux? Comment, dans ce sillage, ne pas nous rappeler le bien notoire roman de dénonciation d’Alexandre Soljenitsyne, Le Pavillon des cancéreux (1967), titre périphrastique des goulags? Nous, Libanais, ne vivotons-nous donc pas dans une sorte de goulag depuis plusieurs années déjà? Quoi donc de plus science-fictionnel qu’un État qui plonge exprès ses citoyens dans l’obscurité, comme un avant-goût de l’enfer luciférien, fait de ténèbres et de glace (n’y sommes-nous pas déjà en tout cas?)? Quoi donc de plus science-fictionnel qu’un État qui pollue ses eaux de sorte à faire proliférer les pires bactéries et infections, dont le choléra dernièrement au nord du pays? Quoi donc de plus science-fictionnel qu’un État qui laisse ses chaussées se détériorer complètement afin que le plus grand nombre de citoyens se tuent sur les autoroutes (et qu’on en finisse enfin!)? Quoi donc de plus science-fictionnel qu’un État qui affame ses citoyens, le seul sac de pain journalier coûtant par mois bien plus que le salaire minimal? Et j’en passe parce que la suite est si science-fictionnelle que l’entendement humain préfèrerait sans doute ne pas y croire. Il n’en demeure pas moins que cette suite ne peut qu’être une source d’inspiration très fertile pour les nouveaux romanciers du monde entier, férus de production de récits de science-fiction, qui y trouveront une matrice d’histoires si terrifiantes qu’elles en sont incroyables et qui, pour emprunter les mots mêmes de l’auteur des Liens artificiels, sont profondément habitées par «la volonté tenace d'assassiner le réel».
La rentrée littéraire
Tous les ans, à l’entame du mois de septembre, les francophiles du monde entier, amoureux de la littérature, en l’occurrence du roman français ou francophone actuel, attendent impatiemment la rentrée littéraire avec sa pléthore de parutions dont certaines ont la chance d’entrer en lice pour concourir à un prix ou à un autre.
La rentrée de septembre 2022 est, pour sa part, notamment marquée par le grand retour des récits de science-fiction, parmi lesquels certains proposent, en l’occurrence, la découverte de nouveaux paysages eschatologiques. Je pourrais évoquer à titre illustratif trois parmi eux: Les Tout puissants de Mirwais Ahmadzaï, Chien 51 de Laurent Gaudé et Les Liens artificiels de Nathan Devers, dont je suis personnellement persuadée qu’il a toutes les chances d’obtenir le Goncourt de cette année.
Dans Les Tout puissants, Mirwais Ahmadzaï met en scène une ville de Paris métamorphosée, voire littéralement aliénée par l’exercice omnipotent d’un capitalisme sauvage et criminel, une ville dans le labyrinthe de laquelle le personnage, Lazare, représentant de tous les hommes au final, lutte – sans doute vainement – pour sauvegarder un tant soit peu les derniers lambeaux d’une humanité en voie de disparition.

Dans Chien 51, Laurent Gaudé campe, quant à lui, un personnage du nom de Zem Sparak qui, ayant trahi son pays en faillite, la Grèce, lequel d’ailleurs s’est complètement anéanti, devient «chien», c’est-à-dire policier dans une mégalopole privatisée où il perd son âme, si ce n’était cette boîte de nuit du quartier RedQ où il écoule ses nuits, branché à une technologie anticipative en regard de notre actualité et addictive du nom d’Okios, qui lui donne l’illusion, par ailleurs inutile, de pouvoir retrouver l’Athènes de sa jeunesse.
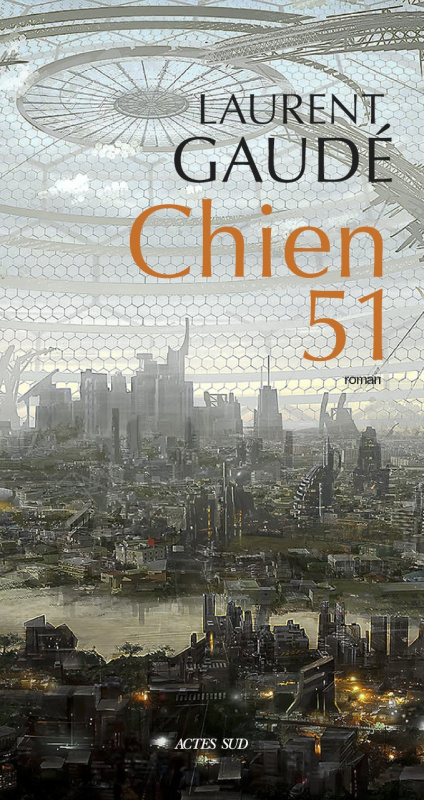
Enfin, dans Les Liens artificiels, Nathan Devers présente Julien, un personnage déçu en tous points par la vie réelle et, qui, découvrant au tournant de son scrolling addictif, un métavers labellisé l’Antimonde, un monde de l’autre côté du miroir, y plonge tout entier, jusqu’au grand plongeon ultime, pour sa part, bien réel.

On aura noté que, dans les trois cas de figure, les auteurs usent de dystopie et de cyberpunk pour suggérer et donner à imaginer, sans détour aucun, ce à quoi nos sociétés actuelles, technologiquement avancées, vont sous peu parvenir. Un futur de fin de l’humanité et du monde, provoquée par le cheminement que ceux-ci empruntent depuis un temps. Paul Watzlawick, le bien notoire fondateur de l’École systémique de Palo Alto, n’affirmait-il pas d’ailleurs, avec force conviction, que le futur se décide, voire se fait au présent?
Le monde d’aujourd’hui: source intarissable d’inspiration pour la science-fiction
Quoi qu’il en soit, ce point commun entre les trois romans que j’évoque ne saurait être anodin. La science-fiction, saisissons-nous-en dans une acception large, celle de la réalité autre, de la méta-réalité, de la surréalité, de la post-réalité, ne serait-elle pas vraiment à l’œuvre, à l’heure actuelle, quasiment partout dans le monde? Celui-ci ne court-il donc pas à son anéantissement comme dans les plus célèbres dystopies du XXe siècle, en l’occurrence Le Meilleur des mondes (1931) d’Aldous Huxley, Ravage (1943) de René Barjavel (où justement une gigantesque panne d'électricité paralyse le monde dans son entièreté), La Ferme des animaux (1945) et 1984 (1949) de George Orwell, Fahrenheit 451 (1953) de Ray Bradbury, et j’en passe?
Lorsque l’on suit les nouvelles au quotidien de la guerre russo-ukrainienne et de ses répercussions partout dans le monde, lorsque l’on apprend les hostilités qui opposent l’Arménie et l’Azerbaïdjan, les tensions entre la Chine et Taïwan, celles entre la Corée du Nord et le Japon, les insurrections au Burkina-Faso, les affrontements entre l’Érythrée et l’Éthiopie, les conflits qui déchirent le Yémen, le Myanmar, l’Afghanistan et j’en passe tout autant, force est de se rendre à l’évidence du paysage eschatologique que le monde d’aujourd’hui donne à regarder et, pis encore, à éprouver, énorme matrice pour l’imagination anticipative et dystopique des romanciers.
Et si l’on parlait de notre Liban?
Venons-en au Liban: très sincèrement, quoi donc de plus science-fictionnel qu’un État qui laisse ses citoyens malades sans médication, notamment les dialysés et les cancéreux parmi eux? Comment, dans ce sillage, ne pas nous rappeler le bien notoire roman de dénonciation d’Alexandre Soljenitsyne, Le Pavillon des cancéreux (1967), titre périphrastique des goulags? Nous, Libanais, ne vivotons-nous donc pas dans une sorte de goulag depuis plusieurs années déjà? Quoi donc de plus science-fictionnel qu’un État qui plonge exprès ses citoyens dans l’obscurité, comme un avant-goût de l’enfer luciférien, fait de ténèbres et de glace (n’y sommes-nous pas déjà en tout cas?)? Quoi donc de plus science-fictionnel qu’un État qui pollue ses eaux de sorte à faire proliférer les pires bactéries et infections, dont le choléra dernièrement au nord du pays? Quoi donc de plus science-fictionnel qu’un État qui laisse ses chaussées se détériorer complètement afin que le plus grand nombre de citoyens se tuent sur les autoroutes (et qu’on en finisse enfin!)? Quoi donc de plus science-fictionnel qu’un État qui affame ses citoyens, le seul sac de pain journalier coûtant par mois bien plus que le salaire minimal? Et j’en passe parce que la suite est si science-fictionnelle que l’entendement humain préfèrerait sans doute ne pas y croire. Il n’en demeure pas moins que cette suite ne peut qu’être une source d’inspiration très fertile pour les nouveaux romanciers du monde entier, férus de production de récits de science-fiction, qui y trouveront une matrice d’histoires si terrifiantes qu’elles en sont incroyables et qui, pour emprunter les mots mêmes de l’auteur des Liens artificiels, sont profondément habitées par «la volonté tenace d'assassiner le réel».
Lire aussi



Commentaires