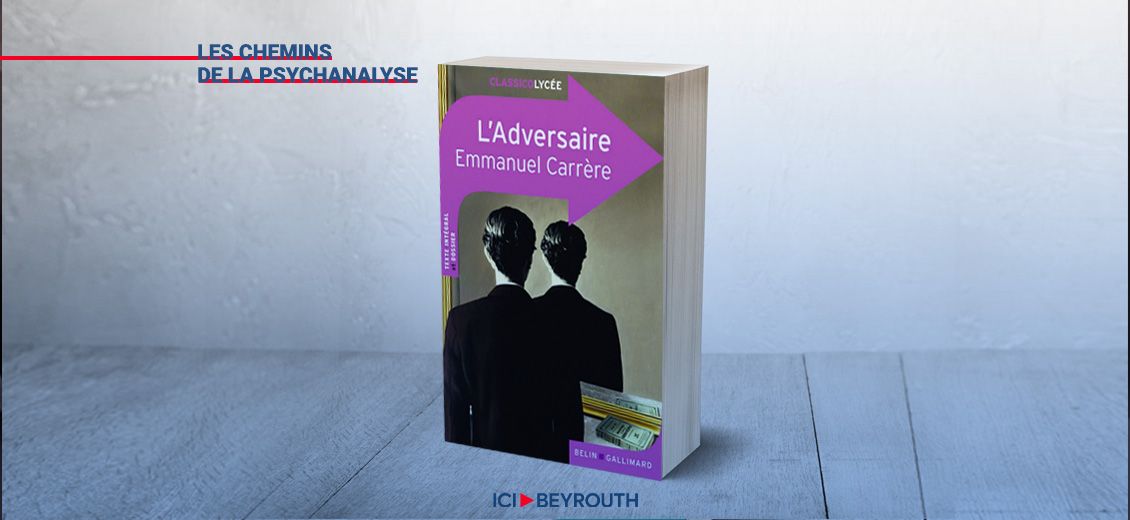
En l’an 2000, le journaliste et écrivain Emmanuel Carrère a publié le récit autobiographique de Jean-Claude Romand, un ouvrage retraçant la vie d’un homme empêtré dans le mensonge depuis son jeune âge et qui, au fil des années, s’est graduellement transformé en menteur pathologique. Son livre, qui a été adapté au cinéma, s’intitule L’Adversaire, illustration du mensonge pathologique qui sera développé dans l’article suivant.
Le 9 janvier 1993, J.-C. Romand tue sa femme, ses deux enfants ainsi que ses deux parents. Puis il met le feu à sa maison et tente de se suicider.
Pendant dix-huit ans, il a réussi à duper son entourage en inventant des situations fictives, à bâtir une existence professionnelle imaginaire, abusant sa famille et ses amis qui lui avaient tous accordé leur confiance. Lorsque sa situation est devenue intenable et qu’il a perçu les soupçons des plus proches comme menaçants, il a décidé d’en finir.
Ce qui est remarquable dans le récit d'Emmanuel Carrère, c’est sa préoccupation constante de ne pas porter de jugement, de demeurer au plus proche des faits, dans une tentative de compréhension des rouages psychiques internes qui ont conduit Romand à édifier, chaque fois qu’il en a senti la nécessité, une existence reposant sur des mensonges. Carrère ne cache pas son trouble et sa perplexité face à l’attitude tantôt inquiétante et pathétique, tantôt totalement insensée de Romand, mais, en observateur sensible et en témoin dépourvu de préjugés, il nous communique le compte rendu d’une investigation proche d’une véritable anamnèse psychanalytique. Je vous en livre l’essentiel dans cet article et le suivant.
Luc était le meilleur ami de Jean-Claude. Lui-même médecin, il était convaincu que son ami exerçait la même profession et qu’il incarnait une sommité dans le domaine de la recherche. Il était persuadé qu’il occupait un poste important à l’OMS, participait à des colloques internationaux et comptait parmi ses amis des personnages influents. Tout son entourage, proche et lointain, partageait cette même certitude. Après les meurtres, c’est l’enquête de la gendarmerie qui a révélé les faits. Les premières vérifications ont établi la vérité: personne à l’OMS ne le connaissait, il n’y avait pas de trace de son inscription à l’ordre des médecins et son nom ne figurait dans aucun hôpital où il se disait interne, ni même à la faculté de médecine de Lyon où il affirmait avoir accompli son cursus. Tout était faux. A Luc, qui avait bien du mal à admettre qu’il avait côtoyé pendant toutes ces années son ami sans soupçonner quoi que ce soit, trouvant parfois des excuses à certaines invraisemblances, les gendarmes apprennent qu’on a trouvé dans la voiture de Jean-Claude une note manuscrite où il s’accusait des crimes qu’il avait commis et reconnaissait qu’il avait leurré tout le monde. Toujours abasourdi et encore quelque peu incrédule, Luc apprend que l’examen des cadavres montre que la femme de Romand ainsi que ses deux jeunes enfants avaient été tués avant l’incendie, sa femme avec un instrument contondant et ses enfants par balles. Plus tard, il découvrira qu’il avait aussi tué par balles ses deux parents âgés, de même que leur chien. Après avoir accompli ces meurtres, il avait retrouvé sa maîtresse en forêt et avait tenté de l’assassiner, mais elle s’était débattue. Il avait alors renoncé à son intention, imputant à son prétendu cancer les raisons de sa folie meurtrière. Jean-Claude Romand avait en effet informé ses proches qu’il était atteint d’un cancer et qu’il se faisait soigner dans le service de cancérologie d’un grand professeur, mais son dossier s’est révélé inexistant.
On apprend graduellement d’où lui venaient les ressources qui lui permettaient de mener un train de vie aisé sinon luxueux: comme il inspirait une totale confiance à son entourage, sa maîtresse, ses propres parents, son oncle et son beau-père lui avaient tous remis des sommes importantes, certains qu’il était expert dans les placements bancaires fructueux alors qu’il n’en était rien; il utilisait cet argent au gré de ses besoins familiaux et personnels. Son beau-père était mort en tombant dans l’escalier alors qu’ils étaient seuls tous les deux. «L’aurait-il tué lui aussi?» se sont demandé les enquêteurs.
Carrère reprend la question que tout le monde s’est posée: «Comment avons-nous pu vivre si longtemps auprès de cet homme sans rien soupçonner?». Tout le monde admirait sa réussite tout en étant demeuré si modeste et si proche de ses parents qu'il appelait tous les jours et visitait souvent. Et Carrère de commenter: «Ils auraient dû voir Dieu et à sa place ils avaient vu, prenant les traits de leur fils bien-aimé, celui que la Bible appelle le satan, c'est-à-dire l’Adversaire».
Dans le but de cerner au plus près le fonctionnement psychique de Romand, l’écrivain a cherché à s’identifier à ce personnage. Il voulait savoir, au-delà des faits concrets, ce qui se passait dans sa tête durant toutes ces journées où, au lieu d’aller à son bureau comme il l’affirmait, il se perdait dans les bois. Il lui écrit, alors qu’il se trouve en prison, pour lui faire part de son projet. Ce n’est que deux ans plus tard qu’il obtient sa réponse: «Dans l'attente de vous lire ou de vous rencontrer, je vous adresse tous mes vœux de succès pour votre livre et vous prie de croire, Monsieur, à toute ma reconnaissance pour votre compassion et mon admiration pour votre talent d'écrivain». Tout au long de l’écriture de son livre, E. Carrère a cherché à le voir «non comme quelqu'un qui a fait quelque chose d'épouvantable, mais comme quelqu'un à qui quelque chose d'épouvantable est arrivé, le jouet infortuné de forces démoniaques». Et, plus loin: «Certaines contraintes lui pesaient dans la vie carcérale mais dans l'ensemble elle lui convenait. Tout le monde était au courant de ce qu'il avait fait, il n'avait plus à mentir et, à côté de la souffrance, goûtait une liberté psychique toute neuve. C'était un détenu modèle, aussi apprécié de ses compagnons que du personnel. Sortir de ce cocon où il avait trouvé sa place pour être jeté en pâture à des gens qui le considéraient comme un monstre le terrifiait. Il se répétait qu'il le fallait, qu'il était essentiel pour les autres et pour lui qu'il ne se dérobe pas devant le tribunal des hommes. Je ressentais de la pitié, une sympathie douloureuse en mettant mes pas dans ceux de cet homme errant sans but, année après année, replié sur son absurde secret». Au cours du procès, un journaliste du Monde écrit: «On n'a pas tous les jours l'occasion de voir le visage du diable». Dans son article, Carrère corrige: «le visage d’un damné».
Poursuivant son investigation anamnestique, à la recherche des sources de sa pathologie, il apprend que par deux fois, «Anne-Marie, sa mère, a été hospitalisée pour des grossesses extra-utérines qui ont fait craindre pour sa vie. Son père a essayé de cacher ce qui se passait au petit garçon, pour ne pas l'inquiéter et parce que ce qui se passait avait trait au monde malpropre et menaçant du sexe. L'hystérectomie a été camouflée en appendicite mais, les deux fois, il a déduit de l'absence de sa mère, du chuchotement sinistre dans lequel on prononçait le mot «hôpital» qu'elle était morte et qu'on lui cachait cette mort… Il dit que sa mère se faisait du souci, à tout propos, et qu'il a tôt appris à donner le change pour qu'elle ne s'en fasse pas davantage. Il admirait son père de ne jamais laisser paraître ses émotions et s'est efforcé de l'imiter. Tout devait toujours aller bien, sans quoi sa mère irait plus mal et il aurait été un ingrat de la faire aller plus mal pour des broutilles, de petits chagrins d'enfant. Mieux valait les cacher. Dans le village, par exemple, les fratries étaient nombreuses, c'était plus animé chez les autres que chez lui, mais il sentait que cela peinait ses parents quand il leur demandait pourquoi lui n'avait pas de frère ou de sœur. Il sentait que cette question recouvrait quelque chose de caché et que sa curiosité, mais plus encore sa peine leur faisait du chagrin. C'était un mot de sa mère, le chagrin, auquel elle donnait un sens curieusement concret, comme s'il s'agissait d'une maladie organique qui la minait. Il savait qu'en s'avouant lui aussi atteint de cette maladie, il ferait empirer celle de sa mère, qui était beaucoup plus grave et risquait de la tuer. D'un côté, on lui avait appris à ne pas mentir, c'était un dogme absolu: un Romand n'avait qu'une parole, un Romand était franc comme l'or. De l'autre, il ne fallait pas dire certaines choses, même si elles étaient vraies».
A l’audience, alors qu’on évoque le chien auquel il était attaché durant son enfance, il dit que «ça m'a rappelé des secrets de mon enfance, des secrets lourds à porter… C'est peut-être indécent de parler des souffrances de mon enfance… Je ne pouvais pas en parler parce que mes parents n'auraient pas compris, auraient été déçus… Je ne mentais pas alors, mais je ne confiais jamais le fond de mes émotions, sauf à mon chien… J'étais toujours souriant, et je crois que mes parents n'ont jamais soupçonné ma tristesse… Je n'avais rien d'autre à cacher alors, mais je cachais cela: cette angoisse, cette tristesse…».
L’idée lui venait parfois de se confier à sa femme ou à Luc, mais il ne se décidait jamais malgré sa conviction d’être bien écouté.
Le 9 janvier 1993, J.-C. Romand tue sa femme, ses deux enfants ainsi que ses deux parents. Puis il met le feu à sa maison et tente de se suicider.
Pendant dix-huit ans, il a réussi à duper son entourage en inventant des situations fictives, à bâtir une existence professionnelle imaginaire, abusant sa famille et ses amis qui lui avaient tous accordé leur confiance. Lorsque sa situation est devenue intenable et qu’il a perçu les soupçons des plus proches comme menaçants, il a décidé d’en finir.
Ce qui est remarquable dans le récit d'Emmanuel Carrère, c’est sa préoccupation constante de ne pas porter de jugement, de demeurer au plus proche des faits, dans une tentative de compréhension des rouages psychiques internes qui ont conduit Romand à édifier, chaque fois qu’il en a senti la nécessité, une existence reposant sur des mensonges. Carrère ne cache pas son trouble et sa perplexité face à l’attitude tantôt inquiétante et pathétique, tantôt totalement insensée de Romand, mais, en observateur sensible et en témoin dépourvu de préjugés, il nous communique le compte rendu d’une investigation proche d’une véritable anamnèse psychanalytique. Je vous en livre l’essentiel dans cet article et le suivant.
Luc était le meilleur ami de Jean-Claude. Lui-même médecin, il était convaincu que son ami exerçait la même profession et qu’il incarnait une sommité dans le domaine de la recherche. Il était persuadé qu’il occupait un poste important à l’OMS, participait à des colloques internationaux et comptait parmi ses amis des personnages influents. Tout son entourage, proche et lointain, partageait cette même certitude. Après les meurtres, c’est l’enquête de la gendarmerie qui a révélé les faits. Les premières vérifications ont établi la vérité: personne à l’OMS ne le connaissait, il n’y avait pas de trace de son inscription à l’ordre des médecins et son nom ne figurait dans aucun hôpital où il se disait interne, ni même à la faculté de médecine de Lyon où il affirmait avoir accompli son cursus. Tout était faux. A Luc, qui avait bien du mal à admettre qu’il avait côtoyé pendant toutes ces années son ami sans soupçonner quoi que ce soit, trouvant parfois des excuses à certaines invraisemblances, les gendarmes apprennent qu’on a trouvé dans la voiture de Jean-Claude une note manuscrite où il s’accusait des crimes qu’il avait commis et reconnaissait qu’il avait leurré tout le monde. Toujours abasourdi et encore quelque peu incrédule, Luc apprend que l’examen des cadavres montre que la femme de Romand ainsi que ses deux jeunes enfants avaient été tués avant l’incendie, sa femme avec un instrument contondant et ses enfants par balles. Plus tard, il découvrira qu’il avait aussi tué par balles ses deux parents âgés, de même que leur chien. Après avoir accompli ces meurtres, il avait retrouvé sa maîtresse en forêt et avait tenté de l’assassiner, mais elle s’était débattue. Il avait alors renoncé à son intention, imputant à son prétendu cancer les raisons de sa folie meurtrière. Jean-Claude Romand avait en effet informé ses proches qu’il était atteint d’un cancer et qu’il se faisait soigner dans le service de cancérologie d’un grand professeur, mais son dossier s’est révélé inexistant.
On apprend graduellement d’où lui venaient les ressources qui lui permettaient de mener un train de vie aisé sinon luxueux: comme il inspirait une totale confiance à son entourage, sa maîtresse, ses propres parents, son oncle et son beau-père lui avaient tous remis des sommes importantes, certains qu’il était expert dans les placements bancaires fructueux alors qu’il n’en était rien; il utilisait cet argent au gré de ses besoins familiaux et personnels. Son beau-père était mort en tombant dans l’escalier alors qu’ils étaient seuls tous les deux. «L’aurait-il tué lui aussi?» se sont demandé les enquêteurs.
Carrère reprend la question que tout le monde s’est posée: «Comment avons-nous pu vivre si longtemps auprès de cet homme sans rien soupçonner?». Tout le monde admirait sa réussite tout en étant demeuré si modeste et si proche de ses parents qu'il appelait tous les jours et visitait souvent. Et Carrère de commenter: «Ils auraient dû voir Dieu et à sa place ils avaient vu, prenant les traits de leur fils bien-aimé, celui que la Bible appelle le satan, c'est-à-dire l’Adversaire».
Dans le but de cerner au plus près le fonctionnement psychique de Romand, l’écrivain a cherché à s’identifier à ce personnage. Il voulait savoir, au-delà des faits concrets, ce qui se passait dans sa tête durant toutes ces journées où, au lieu d’aller à son bureau comme il l’affirmait, il se perdait dans les bois. Il lui écrit, alors qu’il se trouve en prison, pour lui faire part de son projet. Ce n’est que deux ans plus tard qu’il obtient sa réponse: «Dans l'attente de vous lire ou de vous rencontrer, je vous adresse tous mes vœux de succès pour votre livre et vous prie de croire, Monsieur, à toute ma reconnaissance pour votre compassion et mon admiration pour votre talent d'écrivain». Tout au long de l’écriture de son livre, E. Carrère a cherché à le voir «non comme quelqu'un qui a fait quelque chose d'épouvantable, mais comme quelqu'un à qui quelque chose d'épouvantable est arrivé, le jouet infortuné de forces démoniaques». Et, plus loin: «Certaines contraintes lui pesaient dans la vie carcérale mais dans l'ensemble elle lui convenait. Tout le monde était au courant de ce qu'il avait fait, il n'avait plus à mentir et, à côté de la souffrance, goûtait une liberté psychique toute neuve. C'était un détenu modèle, aussi apprécié de ses compagnons que du personnel. Sortir de ce cocon où il avait trouvé sa place pour être jeté en pâture à des gens qui le considéraient comme un monstre le terrifiait. Il se répétait qu'il le fallait, qu'il était essentiel pour les autres et pour lui qu'il ne se dérobe pas devant le tribunal des hommes. Je ressentais de la pitié, une sympathie douloureuse en mettant mes pas dans ceux de cet homme errant sans but, année après année, replié sur son absurde secret». Au cours du procès, un journaliste du Monde écrit: «On n'a pas tous les jours l'occasion de voir le visage du diable». Dans son article, Carrère corrige: «le visage d’un damné».
Poursuivant son investigation anamnestique, à la recherche des sources de sa pathologie, il apprend que par deux fois, «Anne-Marie, sa mère, a été hospitalisée pour des grossesses extra-utérines qui ont fait craindre pour sa vie. Son père a essayé de cacher ce qui se passait au petit garçon, pour ne pas l'inquiéter et parce que ce qui se passait avait trait au monde malpropre et menaçant du sexe. L'hystérectomie a été camouflée en appendicite mais, les deux fois, il a déduit de l'absence de sa mère, du chuchotement sinistre dans lequel on prononçait le mot «hôpital» qu'elle était morte et qu'on lui cachait cette mort… Il dit que sa mère se faisait du souci, à tout propos, et qu'il a tôt appris à donner le change pour qu'elle ne s'en fasse pas davantage. Il admirait son père de ne jamais laisser paraître ses émotions et s'est efforcé de l'imiter. Tout devait toujours aller bien, sans quoi sa mère irait plus mal et il aurait été un ingrat de la faire aller plus mal pour des broutilles, de petits chagrins d'enfant. Mieux valait les cacher. Dans le village, par exemple, les fratries étaient nombreuses, c'était plus animé chez les autres que chez lui, mais il sentait que cela peinait ses parents quand il leur demandait pourquoi lui n'avait pas de frère ou de sœur. Il sentait que cette question recouvrait quelque chose de caché et que sa curiosité, mais plus encore sa peine leur faisait du chagrin. C'était un mot de sa mère, le chagrin, auquel elle donnait un sens curieusement concret, comme s'il s'agissait d'une maladie organique qui la minait. Il savait qu'en s'avouant lui aussi atteint de cette maladie, il ferait empirer celle de sa mère, qui était beaucoup plus grave et risquait de la tuer. D'un côté, on lui avait appris à ne pas mentir, c'était un dogme absolu: un Romand n'avait qu'une parole, un Romand était franc comme l'or. De l'autre, il ne fallait pas dire certaines choses, même si elles étaient vraies».
A l’audience, alors qu’on évoque le chien auquel il était attaché durant son enfance, il dit que «ça m'a rappelé des secrets de mon enfance, des secrets lourds à porter… C'est peut-être indécent de parler des souffrances de mon enfance… Je ne pouvais pas en parler parce que mes parents n'auraient pas compris, auraient été déçus… Je ne mentais pas alors, mais je ne confiais jamais le fond de mes émotions, sauf à mon chien… J'étais toujours souriant, et je crois que mes parents n'ont jamais soupçonné ma tristesse… Je n'avais rien d'autre à cacher alors, mais je cachais cela: cette angoisse, cette tristesse…».
L’idée lui venait parfois de se confier à sa femme ou à Luc, mais il ne se décidait jamais malgré sa conviction d’être bien écouté.
Lire aussi





Commentaires