
Grande figure de la littérature française, l’écrivain franco-libanais Charif Majdalani répond aux questions d'Ici Beyrouth.
Après avoir soutenu une thèse sur Antonin Artaud à l’Université d’Aix-en-Provence, Charif Majdalani retourne au Liban et occupe en 1999 le poste de chef de département des lettres françaises à l’Université Saint-Joseph de Beyrouth où il enseigne toujours. Depuis 2006, il est membre du comité de rédaction de L'Orient littéraire. Il signe également des articles d’opinion dans L’Orient-Le Jour, Le Monde, Libération, La Montagne et publie régulièrement une chronique dans La Croix.
Il écrit son premier roman en 2005, suivi de huit autres traduits dans six langues et récompensés par des prix littéraires prestigieux. Ainsi, il remporte le prix Tropiques 2008 et le prix François Mauriac de l’Académie française pour Caravansérail, sorti en 2008, ainsi que le prix Jean Giono pour Villa des femmes en 2015. Son livre Beyrouth 2020, journal d’un effondrement a reçu le Fémina, prix spécial du jury. Le romancier milite sur le terrain (dans les manifestations) et à travers son œuvre, en remontant aux précurseurs de la corruption endémique au Liban, à partir de la rencontre de destins individuels avec le cours sinueux de l’Histoire. Son besoin de donner du sens rejoint son obsession de raconter le déracinement erratique des maisons, à priori solidement construites. De quelles maisons s’agit-il? Histoire de la grande maison, Villa des femmes? Diverses histoires de familles jalonnent ses différents livres, dont celui de la chute de Beyrouth, avant sa destruction le soir du 4 août.
Toujours est-il que l’écrivain a besoin de créer une cohérence, un ordre, une signification. Pour ses étudiant.e.s, il fait partie des professeurs dont les commentaires sont constructifs, sans jamais recourir à l’ironie hostile ou à l’étalage rébarbatif et pédant. Entretien avec un bâtisseur, dont la vocation est de dresser des ponts culturels, d’ériger constamment des passerelles.
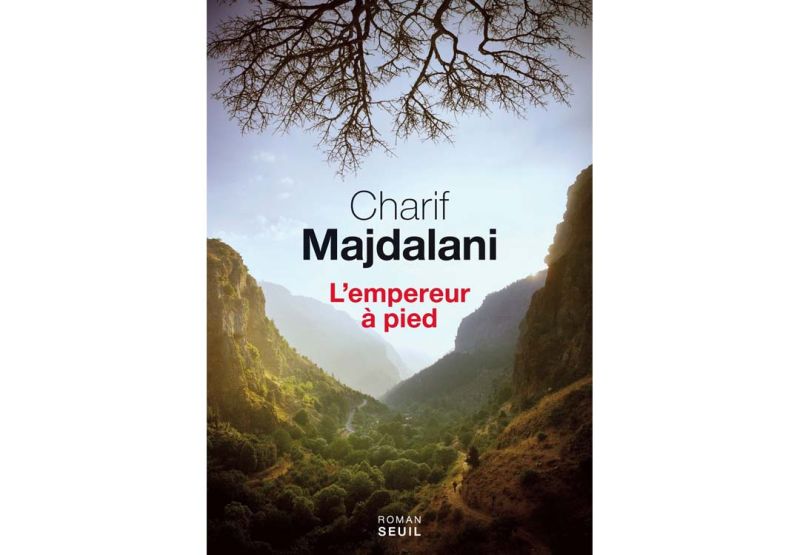
Il y a toujours dans vos romans des histoires de familles, l’histoire d’une maison à priori solide, rapidement rattrapée par l’engrenage dramatique des événements. Soudain, la maison semble construite sur du sable mouvant. À quoi correspond le choix récurrent d’une telle thématique?
Ce qui m’intéresse et qui est, je crois, au cœur de la plupart de mes livres, c’est la question du temps, mais non pas seulement le temps intime et la perception de son passage par l’individu, mais le temps long, c’est-à-dire la marche de l’Histoire. Ce que j’essaye de faire, c’est de décrire les changements et les transformations que l’Histoire apporte, souvent hélas dans la violence, mais pas seulement – parce que les changements viennent aussi lentement, à travers les lentes modifications des manières d’être et de vivre et qui, à la longue, emportent imperceptiblement les sociétés, les civilisations, les nations. Et la maison (dans les deux sens que le mot Beyt peut prendre en arabe, c’est-à-dire les murs, mais aussi la famille, le clan au sens large) est un peu la métaphore des sociétés et des civilisations. J’observe et décris à travers elle et à travers les vicissitudes que traversent les maisons aussi bien que les familles les processus de changements, d’effondrement ou de lentes transformations des sociétés.
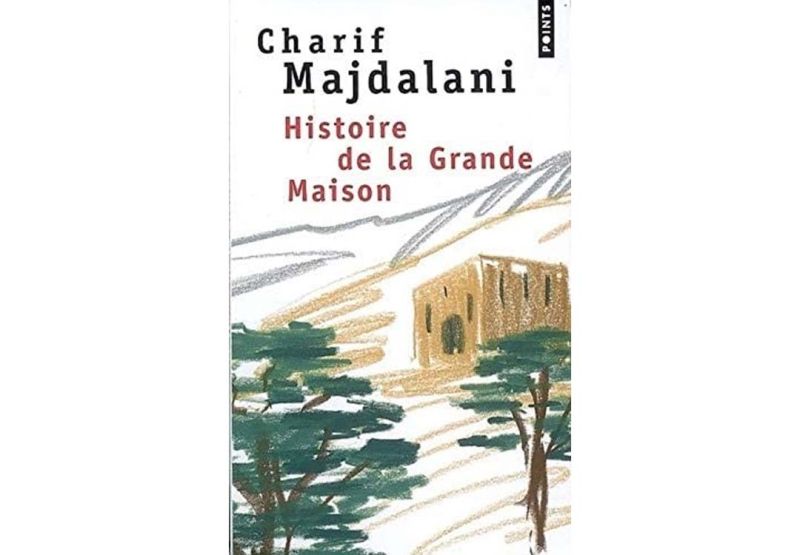
Il paraît que Caranvansérail est inspiré un peu par l’histoire réelle de la rencontre de votre grand-père maternel avec des personnalités célèbres arabes comme Lawrence d’Arabie et le roi Fayçal. Peut-on déduire qu’enfant, votre imaginaire a été nourri aux histoires racontées? D’où vient votre talent de conteur?
Mon imaginaire et mon devenir d’écrivain viennent de mes lectures. Les livres sont présents autour de moi depuis que j’ai conscience d’exister. Ma mère nous en a très tôt achetés, ma sœur et moi, je suis devenu familier des récits dans les collections pour enfants puis pour adolescents de cette époque (bibliothèque rose, verte, deux coqs d’or…) et je crois que c’est dans ces ouvrages que se trouve la genèse de mon envie d’écrire et de la façon de le faire. Mais quand je parle des livres, cela ne veut pas dire seulement les romans ou des récits historiques. Une lecture qui m’a profondément marqué est celle des bandes dessinées, notamment des séries qu’il y avait dans le Journal de Tintin auquel ma mère m’avait abonné. Les aventures de Tintin lui-même, par Hergé, m’ont aussi initié de manière inégalée au dynamisme d’une narration, au découpage des séquences, à l’économie de moyens pour raconter une histoire. Et bien entendu, tout cela s’est trouvé ensuite cimenté par les lectures d’adultes, qui m’ont marqué – celle de Proust, Faulkner, Stendhal, Chateaubriand, Claude Simon, Giono, etc.
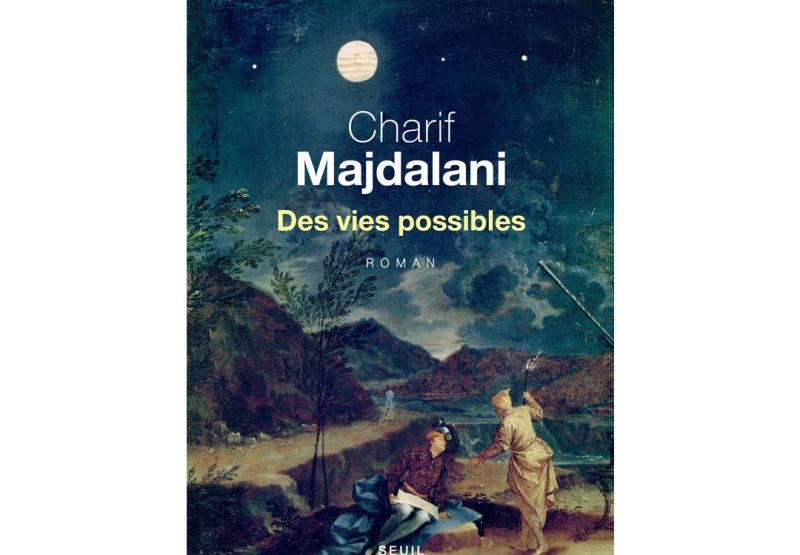
Vous êtes obsédé par l’intrusion d’un élément, fruit du hasard ou d’un concours de circonstances qui changera tout le cours de l’Histoire. Dans vos romans nous voyons le retentissement de ce possible sur l’histoire individuelle, d’où votre titre évocateur Des vies possibles. Croyez-vous davantage au pouvoir de la liberté humaine ou au fatalisme auquel il est parfois difficile d'échapper?
Cette question est aussi au cœur de mon dernier livre, Dernière Oasis, où je la traite en l’élargissant au mouvement de l’Histoire. Ce que je dis dans l’un et l’autre livre, c’est que nos vies et le devenir du monde sont ce qu’ils sont, mais qu’ils auraient évidemment pu être différents, et prendre cent mille autres visages, et que tout cela souvent ne tient qu’à un rien, un hasard, un détail imperceptible et qui de proche en proche finit par avoir des conséquences immenses. Cela n’a pas directement à voir avec la question de la liberté. S’il semble qu’en effet nous ne soyons pas libres puisque des milliers de choses déterminent à priori nos existences, nous le sommes d’agir à chaque instant en fonction de chaque nouvelle donnée que la vie ou le monde nous imposent. Nous sommes libres de retourner en notre avantage tout ce qui advient ou qui s’impose et d’en faire non plus quelque chose de subi, mais quelque chose à quoi nous avons imposé nos marques et notre volonté, jusqu’à en modifier le cours.
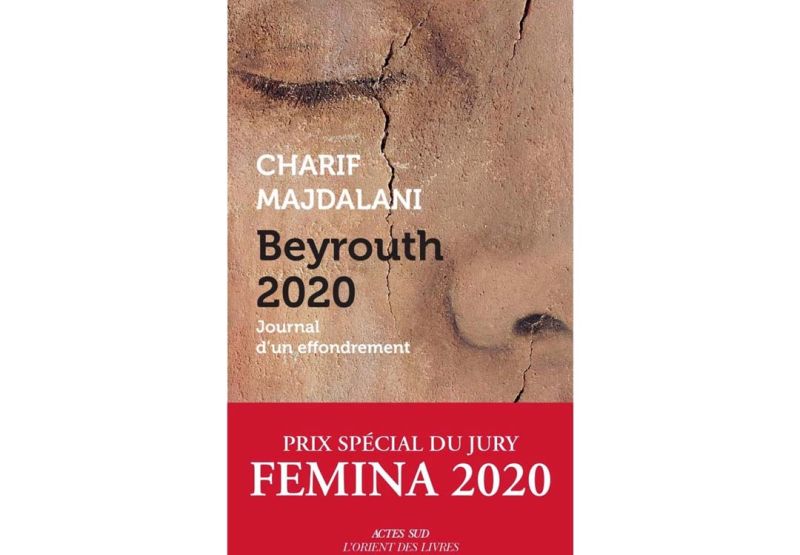
Dans Beyrouth 2020, journal d’un effondrement, l’ex-Suisse de l’Orient subit sa déchéance programmée avant sa démolition criminelle. La peinture réaliste et sobre des événements choquants, alliée à l’emploi du passé composé, exprime un détachement, un hiatus, une rupture. Le thème de l’absurde et le temps verbal ne sont pas sans rappeler L’Étranger de Camus qui privilégie le passé composé pour traduire l’indifférence. Sauf que dans votre journal, le passé composé exprime plutôt le déni dans lequel nous vivons! Êtes-vous d’accord?
Je crois que ce n’est pas tout à fait la même chose. Dans L'Étranger, le temps verbal est le résultat d’un choix esthétique et narratif en rupture volontaire avec la coutume de la narration romanesque et mis au service d’un propos particulier. Beyrouth 2020 n’est pas un roman, c’est vraiment un journal qui rapporte des choses qui se sont passées dans les heures qui précèdent le moment de l’écriture. Il était difficile de les raconter sur le mode temporel qu’on emploierait dans un récit. Cela leur aurait donné quelque chose de guindé et d’artificiel, alors que l’essentiel était de garder aux faits la spontanéité de leur surgissement.
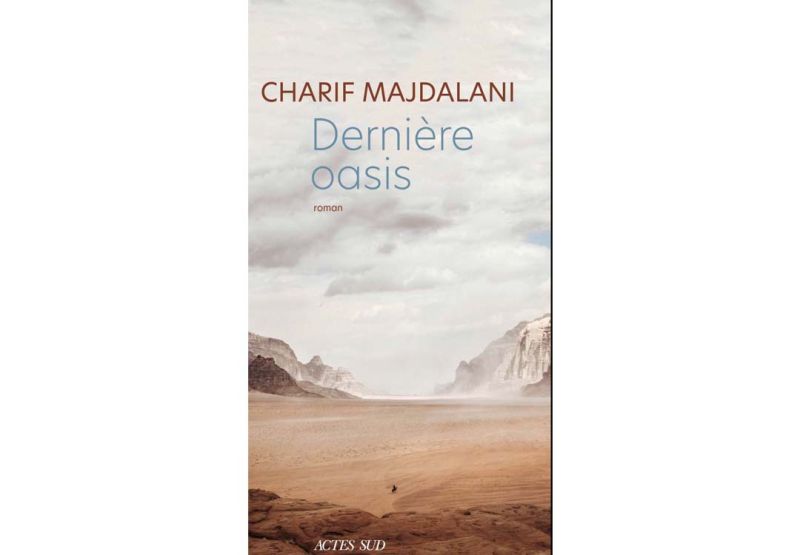
On retrouve également dans ce journal des moments marqués par l’intrusion d’un détail infime qui renvoie à la douceur de la vie, à une possible solidarité humaine devant le scandale d’un présent tragique augurant un futur improbable. Or, c’est de l’ordre des joies sensuelles, comme chez Camus: l’odeur du jasmin et des gardénias, un dîner avec des amis, les fleurs qui poussent grâce aux efforts d’un jardinier humble et besogneux…
Là aussi, je n’ai fait que raconter ce qui arrivait, et il arrivait en effet que se côtoient deux niveaux de réalité, l’effondrement et nos misères quotidiennes d’un côté, et de l’autre la permanence de la vie, du passage du temps, de la succession des saisons. C’est un peu l’expression de l’indifférence du monde face à la souffrance humaine.

Ce livre commence et se termine par l’achat d’un terrain. Un lopin de terre dans cet enfer, voilà ce qui reste à faire comme acte de résistance au sens propre comme au sens figuré. Serait-ce la métaphore de la terre brûlée régénérée, la terre perdue retrouvée?
Peut-être, pourquoi pas. Mais c’est surtout effectivement un acte presque inconscient de résistance. Cela dit, nous avons acheté ce terrain pour sortir notre argent des banques. C’est donc un achat forcé, par lequel de l’argent se retrouve sauvé d’un côté et immobilisé de l’autre. Mais cela a abouti à quelque chose de singulier: issu d’une famille beyrouthine, j’ai toujours rêvé de posséder un petit lopin de terre à la montagne. À défaut de l’avoir dans mon patrimoine, il me fallait l’acquérir de toute pièce. Je ne me décidai pas à le faire, et c’est la crise qui m’y a amené. La crise m’a donc forcé à réaliser un vieux rêve. C’est un des multiples paradoxes de la vie. Mais à côté de ça, il y a le fantasme, évoqué dans le livre, de construire sur ce lopin, ce qui est une autre affaire, et là, en effet, il s’agit d’un acte de résistance. Construire par temps d’effondrement, c’est défier l’effondrement, c’est refuser qu’il devienne l’axe autour duquel tournent nos vies et nos réflexes, autrement dit une fatalité à laquelle on se soumet.
Dernière oasis évoque une quête de l’immobilité, une vie calme hors du temps et de l’espace voués aux tribulations déstabilisantes et aux rebondissements tragiques. L’oasis n’est donc pas le paradis perdu du bonheur, mais juste un havre de paix et de silence que le contemplatif appelle de ses vœux? Peut-être la terrasse où vous écrivez ? Le lieu qui vous permet d’admirer la virginité de certains paysages qui ont échappé à la voracité destructrice de la mafia au pouvoir?
Les plantations où se déroule une partie de l’action dans Dernière oasis sont un lieu à l’écart des violences de l’Histoire, des transformations et des changements qui affectent le monde et les sociétés. C’est ainsi en tout cas que le vit le personnage, qui vient y expertiser des œuvres archéologiques fruits d’un mystérieux pillage. Il se retrouve donc à attendre ses commanditaires, et expérimente cette attente comme une délicieuse suspension du temps, jusqu’à ce que les événements de l’été 2014 arrivent et emportent tout. C’est en ce sens que le personnage aura la tentation de comparer ces lieux pourtant difficiles par le climat et l’environnement, à une sorte de paradis. Et ce paradis-là, on peut en effet le trouver dans tous les lieux que l’on éprouve comme extérieurs à la tourmente du monde et du temps: cela peut être l’enfance, ou encore des endroits qui échappent au brutal appétit de pouvoir et de spéculation des hommes, comme cela se produit à la fin de L’Empereur à pied, au cœur des montagnes libanaises, en un point encore préservé des ravages que les humains font subir à leur environnement. Il y a de ce point de vue de nombreuses similitudes entre Dernière oasis et l’Empereur à pied.
Le concept de résilience médiatisé par Boris Cyrulnik n’est-il pas perverti comme tout ce qui nous parvient? Ne sommes-nous pas en train d’accepter l’inacceptable, de s’adapter à l’innommable sous prétexte de résilience? Que peut la littérature quand rien ne marche plus ?
Le concept de résilience est fort mal utilisé par les Libanais. La résilience est le fait de se reconstruire une fois que les responsables de notre malheur ont été désignés et que réparation a été faite. Cela n’a jamais été le cas ici. Afin de conserver nos acquis matériels et une vie somme toute agréable dans ce pays, nous avons tout accepté, et en particulier de fermer les yeux sur la mauvaise gouvernance et sur toutes les aberrations qu’elle a produites et qui nous ont finalement et littéralement explosé à la figure. Quant à la littérature, elle permet de décrire les faits et les réalités, d’ordonner le chaos des choses pour leur donner sens. Elle peut ainsi devenir thérapeutique, ou aider à trouver ou à donner de la signification au réel et à nos vies.
Après avoir soutenu une thèse sur Antonin Artaud à l’Université d’Aix-en-Provence, Charif Majdalani retourne au Liban et occupe en 1999 le poste de chef de département des lettres françaises à l’Université Saint-Joseph de Beyrouth où il enseigne toujours. Depuis 2006, il est membre du comité de rédaction de L'Orient littéraire. Il signe également des articles d’opinion dans L’Orient-Le Jour, Le Monde, Libération, La Montagne et publie régulièrement une chronique dans La Croix.
Il écrit son premier roman en 2005, suivi de huit autres traduits dans six langues et récompensés par des prix littéraires prestigieux. Ainsi, il remporte le prix Tropiques 2008 et le prix François Mauriac de l’Académie française pour Caravansérail, sorti en 2008, ainsi que le prix Jean Giono pour Villa des femmes en 2015. Son livre Beyrouth 2020, journal d’un effondrement a reçu le Fémina, prix spécial du jury. Le romancier milite sur le terrain (dans les manifestations) et à travers son œuvre, en remontant aux précurseurs de la corruption endémique au Liban, à partir de la rencontre de destins individuels avec le cours sinueux de l’Histoire. Son besoin de donner du sens rejoint son obsession de raconter le déracinement erratique des maisons, à priori solidement construites. De quelles maisons s’agit-il? Histoire de la grande maison, Villa des femmes? Diverses histoires de familles jalonnent ses différents livres, dont celui de la chute de Beyrouth, avant sa destruction le soir du 4 août.
Toujours est-il que l’écrivain a besoin de créer une cohérence, un ordre, une signification. Pour ses étudiant.e.s, il fait partie des professeurs dont les commentaires sont constructifs, sans jamais recourir à l’ironie hostile ou à l’étalage rébarbatif et pédant. Entretien avec un bâtisseur, dont la vocation est de dresser des ponts culturels, d’ériger constamment des passerelles.
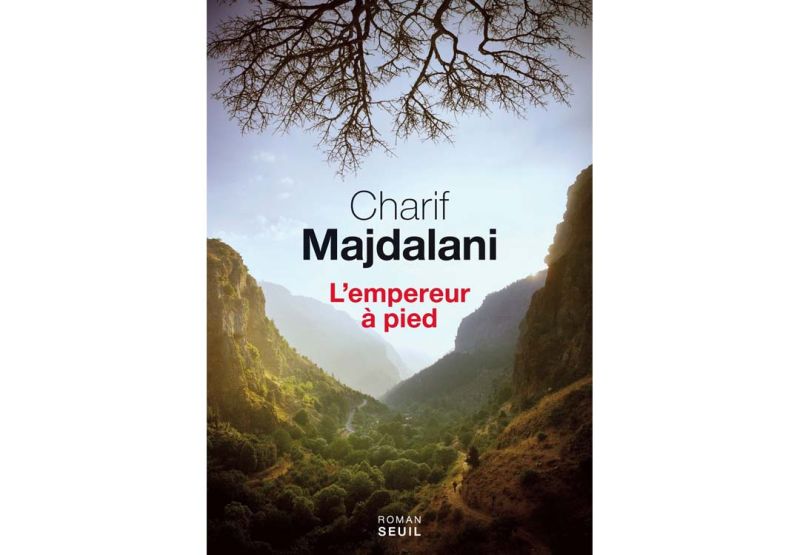
Il y a toujours dans vos romans des histoires de familles, l’histoire d’une maison à priori solide, rapidement rattrapée par l’engrenage dramatique des événements. Soudain, la maison semble construite sur du sable mouvant. À quoi correspond le choix récurrent d’une telle thématique?
Ce qui m’intéresse et qui est, je crois, au cœur de la plupart de mes livres, c’est la question du temps, mais non pas seulement le temps intime et la perception de son passage par l’individu, mais le temps long, c’est-à-dire la marche de l’Histoire. Ce que j’essaye de faire, c’est de décrire les changements et les transformations que l’Histoire apporte, souvent hélas dans la violence, mais pas seulement – parce que les changements viennent aussi lentement, à travers les lentes modifications des manières d’être et de vivre et qui, à la longue, emportent imperceptiblement les sociétés, les civilisations, les nations. Et la maison (dans les deux sens que le mot Beyt peut prendre en arabe, c’est-à-dire les murs, mais aussi la famille, le clan au sens large) est un peu la métaphore des sociétés et des civilisations. J’observe et décris à travers elle et à travers les vicissitudes que traversent les maisons aussi bien que les familles les processus de changements, d’effondrement ou de lentes transformations des sociétés.
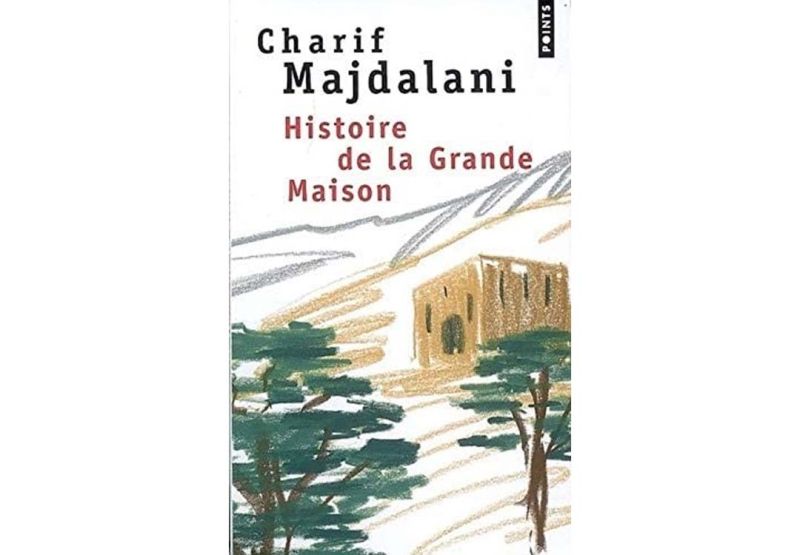
Il paraît que Caranvansérail est inspiré un peu par l’histoire réelle de la rencontre de votre grand-père maternel avec des personnalités célèbres arabes comme Lawrence d’Arabie et le roi Fayçal. Peut-on déduire qu’enfant, votre imaginaire a été nourri aux histoires racontées? D’où vient votre talent de conteur?
Mon imaginaire et mon devenir d’écrivain viennent de mes lectures. Les livres sont présents autour de moi depuis que j’ai conscience d’exister. Ma mère nous en a très tôt achetés, ma sœur et moi, je suis devenu familier des récits dans les collections pour enfants puis pour adolescents de cette époque (bibliothèque rose, verte, deux coqs d’or…) et je crois que c’est dans ces ouvrages que se trouve la genèse de mon envie d’écrire et de la façon de le faire. Mais quand je parle des livres, cela ne veut pas dire seulement les romans ou des récits historiques. Une lecture qui m’a profondément marqué est celle des bandes dessinées, notamment des séries qu’il y avait dans le Journal de Tintin auquel ma mère m’avait abonné. Les aventures de Tintin lui-même, par Hergé, m’ont aussi initié de manière inégalée au dynamisme d’une narration, au découpage des séquences, à l’économie de moyens pour raconter une histoire. Et bien entendu, tout cela s’est trouvé ensuite cimenté par les lectures d’adultes, qui m’ont marqué – celle de Proust, Faulkner, Stendhal, Chateaubriand, Claude Simon, Giono, etc.
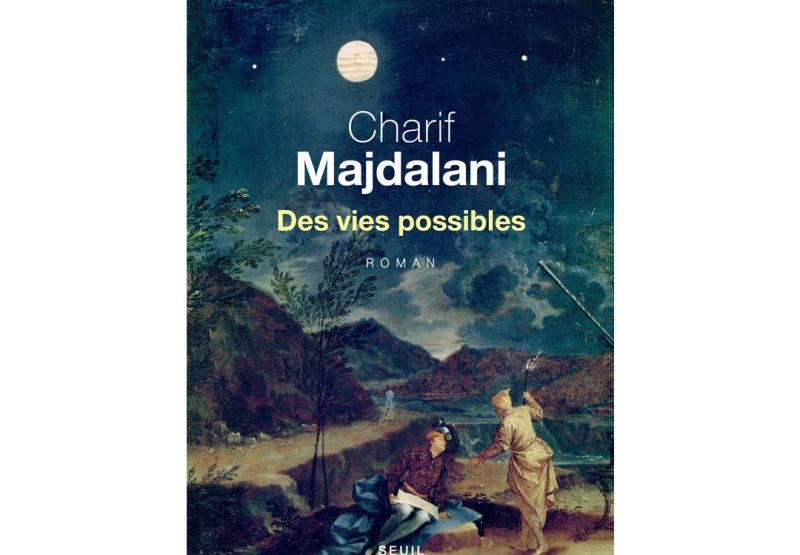
Vous êtes obsédé par l’intrusion d’un élément, fruit du hasard ou d’un concours de circonstances qui changera tout le cours de l’Histoire. Dans vos romans nous voyons le retentissement de ce possible sur l’histoire individuelle, d’où votre titre évocateur Des vies possibles. Croyez-vous davantage au pouvoir de la liberté humaine ou au fatalisme auquel il est parfois difficile d'échapper?
Cette question est aussi au cœur de mon dernier livre, Dernière Oasis, où je la traite en l’élargissant au mouvement de l’Histoire. Ce que je dis dans l’un et l’autre livre, c’est que nos vies et le devenir du monde sont ce qu’ils sont, mais qu’ils auraient évidemment pu être différents, et prendre cent mille autres visages, et que tout cela souvent ne tient qu’à un rien, un hasard, un détail imperceptible et qui de proche en proche finit par avoir des conséquences immenses. Cela n’a pas directement à voir avec la question de la liberté. S’il semble qu’en effet nous ne soyons pas libres puisque des milliers de choses déterminent à priori nos existences, nous le sommes d’agir à chaque instant en fonction de chaque nouvelle donnée que la vie ou le monde nous imposent. Nous sommes libres de retourner en notre avantage tout ce qui advient ou qui s’impose et d’en faire non plus quelque chose de subi, mais quelque chose à quoi nous avons imposé nos marques et notre volonté, jusqu’à en modifier le cours.
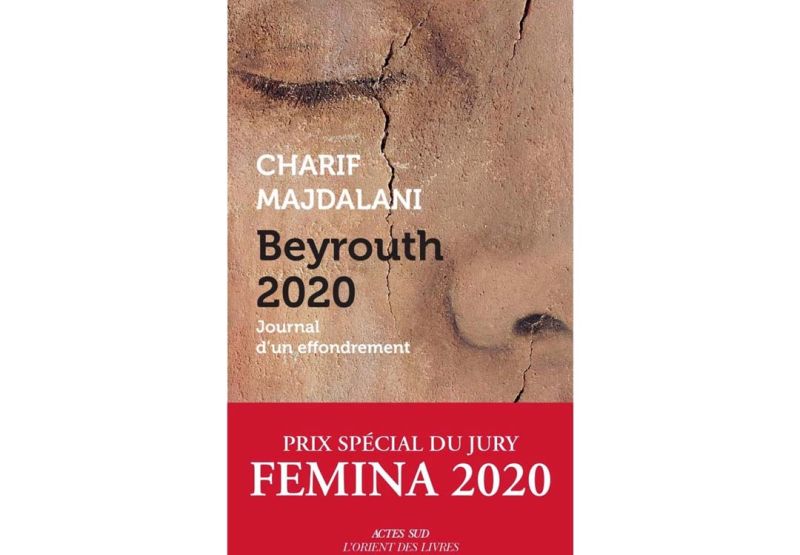
Dans Beyrouth 2020, journal d’un effondrement, l’ex-Suisse de l’Orient subit sa déchéance programmée avant sa démolition criminelle. La peinture réaliste et sobre des événements choquants, alliée à l’emploi du passé composé, exprime un détachement, un hiatus, une rupture. Le thème de l’absurde et le temps verbal ne sont pas sans rappeler L’Étranger de Camus qui privilégie le passé composé pour traduire l’indifférence. Sauf que dans votre journal, le passé composé exprime plutôt le déni dans lequel nous vivons! Êtes-vous d’accord?
Je crois que ce n’est pas tout à fait la même chose. Dans L'Étranger, le temps verbal est le résultat d’un choix esthétique et narratif en rupture volontaire avec la coutume de la narration romanesque et mis au service d’un propos particulier. Beyrouth 2020 n’est pas un roman, c’est vraiment un journal qui rapporte des choses qui se sont passées dans les heures qui précèdent le moment de l’écriture. Il était difficile de les raconter sur le mode temporel qu’on emploierait dans un récit. Cela leur aurait donné quelque chose de guindé et d’artificiel, alors que l’essentiel était de garder aux faits la spontanéité de leur surgissement.
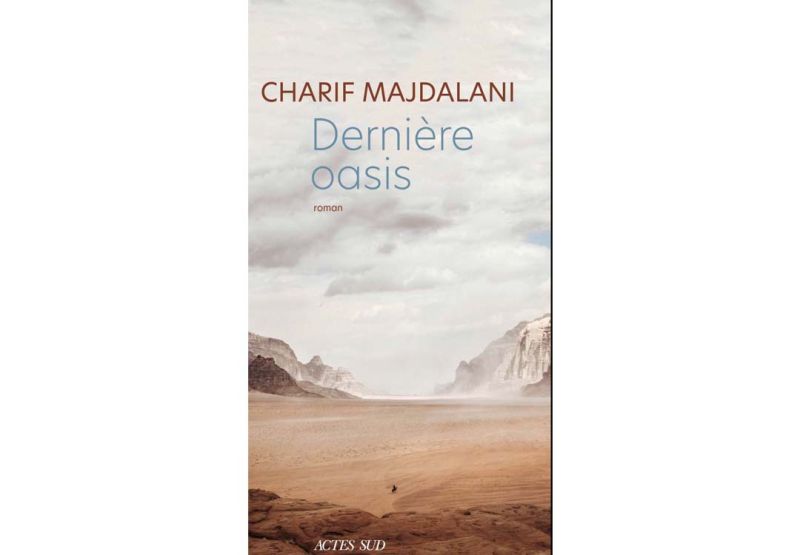
On retrouve également dans ce journal des moments marqués par l’intrusion d’un détail infime qui renvoie à la douceur de la vie, à une possible solidarité humaine devant le scandale d’un présent tragique augurant un futur improbable. Or, c’est de l’ordre des joies sensuelles, comme chez Camus: l’odeur du jasmin et des gardénias, un dîner avec des amis, les fleurs qui poussent grâce aux efforts d’un jardinier humble et besogneux…
Là aussi, je n’ai fait que raconter ce qui arrivait, et il arrivait en effet que se côtoient deux niveaux de réalité, l’effondrement et nos misères quotidiennes d’un côté, et de l’autre la permanence de la vie, du passage du temps, de la succession des saisons. C’est un peu l’expression de l’indifférence du monde face à la souffrance humaine.

Ce livre commence et se termine par l’achat d’un terrain. Un lopin de terre dans cet enfer, voilà ce qui reste à faire comme acte de résistance au sens propre comme au sens figuré. Serait-ce la métaphore de la terre brûlée régénérée, la terre perdue retrouvée?
Peut-être, pourquoi pas. Mais c’est surtout effectivement un acte presque inconscient de résistance. Cela dit, nous avons acheté ce terrain pour sortir notre argent des banques. C’est donc un achat forcé, par lequel de l’argent se retrouve sauvé d’un côté et immobilisé de l’autre. Mais cela a abouti à quelque chose de singulier: issu d’une famille beyrouthine, j’ai toujours rêvé de posséder un petit lopin de terre à la montagne. À défaut de l’avoir dans mon patrimoine, il me fallait l’acquérir de toute pièce. Je ne me décidai pas à le faire, et c’est la crise qui m’y a amené. La crise m’a donc forcé à réaliser un vieux rêve. C’est un des multiples paradoxes de la vie. Mais à côté de ça, il y a le fantasme, évoqué dans le livre, de construire sur ce lopin, ce qui est une autre affaire, et là, en effet, il s’agit d’un acte de résistance. Construire par temps d’effondrement, c’est défier l’effondrement, c’est refuser qu’il devienne l’axe autour duquel tournent nos vies et nos réflexes, autrement dit une fatalité à laquelle on se soumet.
Dernière oasis évoque une quête de l’immobilité, une vie calme hors du temps et de l’espace voués aux tribulations déstabilisantes et aux rebondissements tragiques. L’oasis n’est donc pas le paradis perdu du bonheur, mais juste un havre de paix et de silence que le contemplatif appelle de ses vœux? Peut-être la terrasse où vous écrivez ? Le lieu qui vous permet d’admirer la virginité de certains paysages qui ont échappé à la voracité destructrice de la mafia au pouvoir?
Les plantations où se déroule une partie de l’action dans Dernière oasis sont un lieu à l’écart des violences de l’Histoire, des transformations et des changements qui affectent le monde et les sociétés. C’est ainsi en tout cas que le vit le personnage, qui vient y expertiser des œuvres archéologiques fruits d’un mystérieux pillage. Il se retrouve donc à attendre ses commanditaires, et expérimente cette attente comme une délicieuse suspension du temps, jusqu’à ce que les événements de l’été 2014 arrivent et emportent tout. C’est en ce sens que le personnage aura la tentation de comparer ces lieux pourtant difficiles par le climat et l’environnement, à une sorte de paradis. Et ce paradis-là, on peut en effet le trouver dans tous les lieux que l’on éprouve comme extérieurs à la tourmente du monde et du temps: cela peut être l’enfance, ou encore des endroits qui échappent au brutal appétit de pouvoir et de spéculation des hommes, comme cela se produit à la fin de L’Empereur à pied, au cœur des montagnes libanaises, en un point encore préservé des ravages que les humains font subir à leur environnement. Il y a de ce point de vue de nombreuses similitudes entre Dernière oasis et l’Empereur à pied.
Le concept de résilience médiatisé par Boris Cyrulnik n’est-il pas perverti comme tout ce qui nous parvient? Ne sommes-nous pas en train d’accepter l’inacceptable, de s’adapter à l’innommable sous prétexte de résilience? Que peut la littérature quand rien ne marche plus ?
Le concept de résilience est fort mal utilisé par les Libanais. La résilience est le fait de se reconstruire une fois que les responsables de notre malheur ont été désignés et que réparation a été faite. Cela n’a jamais été le cas ici. Afin de conserver nos acquis matériels et une vie somme toute agréable dans ce pays, nous avons tout accepté, et en particulier de fermer les yeux sur la mauvaise gouvernance et sur toutes les aberrations qu’elle a produites et qui nous ont finalement et littéralement explosé à la figure. Quant à la littérature, elle permet de décrire les faits et les réalités, d’ordonner le chaos des choses pour leur donner sens. Elle peut ainsi devenir thérapeutique, ou aider à trouver ou à donner de la signification au réel et à nos vies.
Lire aussi







Commentaires