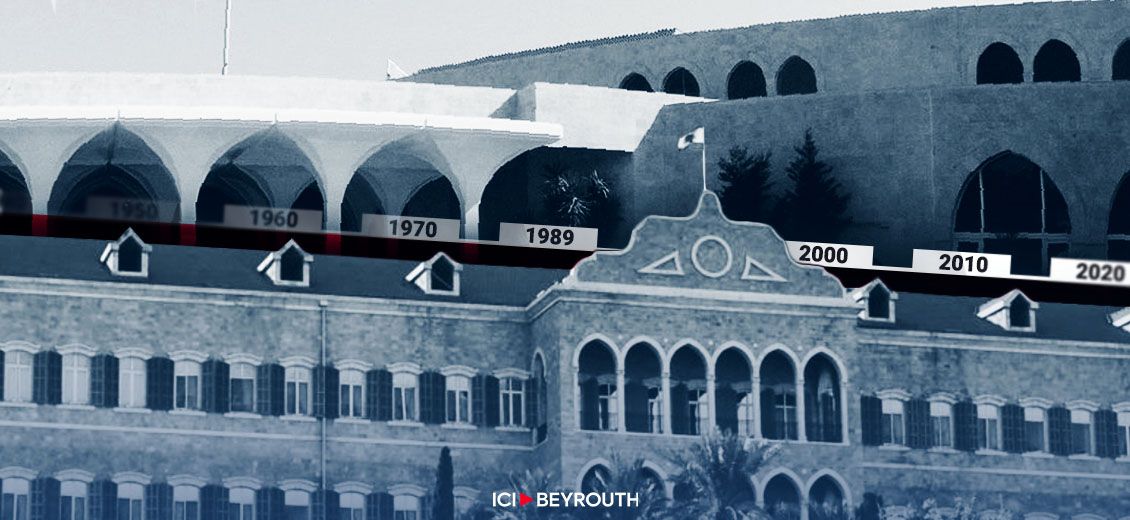
Constitutionnellement, les prérogatives présidentielles ont changé en 1990. Comment la modification des textes après Taëf a-t-elle impacté les pratiques et les coutumes de l’Exécutif, notamment de la première magistrature? Le président était-il un monarque dont on a limité les pouvoirs?
"À cause de Taëf, le président chrétien n’a plus de prérogatives constitutionnelles". Assénée depuis 1989, date de naissance de l’accord qui constitue la base de la Constitution libanaise et qui qui porte le nom de la ville où il a été conclu en Arabie saoudite, tout Libanais a entendu cette phrase au moins une fois depuis.
Cri de ralliement des chrétiens libanais déçus de la période post-1990 ou de leurs compatriotes lésés durant la période de "reconstruction" du pays par un Premier ministre-homme d’affaires, en l’occurrence Rafic Hariri, les détracteurs du document d’entente nationale sont nostalgiques des années "glorieuses" du Liban. Ils considèrent que c’est cet accord qui est la source des problèmes structurels profonds auxquels le pays est confronté depuis plus de 15 ans.
Les amendements constitutionnels décidés à Taëf en novembre 1989 et votés en septembre 1990 ont transféré certaines prérogatives constitutionnelles de la présidence de la République au Conseil des ministres. L'article de la nouvelle Constitution est clair: "Le pouvoir exécutif est confié au Conseil des ministres". Depuis 1927, il était "confié au président de la République qui l’exerce avec l’assistance des ministres […]".
Mais, contrairement à certaines croyances populaires, le président sunnite du Conseil des ministres n’est pas devenu le nouveau "président", et ne peut pas l’être, comme le camp présidentiel essaie aujourd’hui de le faire croire. Le président sortant Michel Aoun l’a laissé entendre au cours de ses dernières interventions publiques, mais son gendre, le chef du CPL Gebran Bassil, n’arrête pas de le répéter depuis trois jours.
Dans son commentaire au sujet de l’accord, fin 1989, Joseph Maïla, alors rédacteur en chef de la revue "Les Cahiers de l’Orient", soulignait que les "réformes politiques entreprises à Taëf restent fortement inspirés par la logique du système communautaire. En l’occurrence, ce ne sont pas à proprement parler des «réformes» qui ont été adoptées à Taëf mais plutôt de nouveaux accommodements communautaires s’inscrivant dans le cadre inchangé du système politique libanais" (MAILA Joseph, «Le document d’entente nationale, un commentaire», Les Cahiers de l’Orient, 4ᵉ trimestre 1989/1er trimestre 1990, no 16/17, p. 178). Et d’ajouter: "Le document tend à faire du Conseil des ministres l’organe collégial investi du pouvoir exécutif […] Le texte tranche ici un débat où le clivage islamo-chrétien opérait au grand jour."
 À gauche, le président de la République, Michel Aoun, présidant un Conseil des ministres. À sa droite, le Premier ministre Hassan Diab, chef de l'Éxecutif
À gauche, le président de la République, Michel Aoun, présidant un Conseil des ministres. À sa droite, le Premier ministre Hassan Diab, chef de l'Éxecutif
Un président-monarque, tête du maronitisme politique
La Constitution, rédigée et adoptée à l’époque du Mandat, s’est largement inspirée des lois constitutionnelles de la IIIᵉ République française de 1875. Un régime parlementaire est mis en place avec deux assemblées: le Sénat et la Chambre des députés. Le Parlement élit un président de la République. Ce dernier forme un gouvernement pour gérer les affaires publiques exécutives. La responsabilité du chef de l’État, maître de l’Exécutif, ne pouvait être retenue devant aucune institution, il ne pouvait donc pas être démis de ses fonctions, contrairement aux ministres, responsables de leurs actes devant le Législatif qui accorde la confiance au gouvernement ou la lui retire.
Or, des amendements constitutionnels en 1927 et 1929 vont transformer le système en un régime semi-présidentiel, "une préfiguration de la Constitution de la Ve République" française, selon le constitutionnaliste Béchara Menassa, dans son ouvrage de référence "Dictionnaire de la Constitution libanaise". Le constitutionnaliste Edmond Rabbath précise également dans le même ouvrage que les amendements d’octobre 1927 ont rendu "le Parlement tributaire du président de la République". En 1929, c’est l’article 55 qui est amendé et donne au président de la République, "par décret motivé, pris sur l’avis conforme du Conseil des ministres, le droit de dissoudre la Chambre des députés [...]". Le pouvoir est donc entre les mains du chef de l’État, élu pour six ans, inamovible et irresponsable.
D’autres juristes considèrent que le régime parlementaire moniste – donc quand le gouvernement n’est responsable que devant le Législatif – prévu dans les textes, n’a pas été respecté par les présidents entre 1943 et 1990, faisant du Liban un régime parlementaire dualiste.
Après l’indépendance et le départ du tuteur français, le président de la République s'est retrouvé en conséquence doté de pouvoirs importants, sans réel contre-pouvoir. C’est bien une période où la prééminence maronite s’ancre avec l’attribution ou l’octroi à des personnalités de cette communauté de plusieurs postes importants au sein de l’administration, à l’instar du commandement de l’armée, du service de renseignements, du secrétariat général du ministère des Affaires étrangères, du gouvernorat de la Banque du Liban, etc. Ces personnalités sont toutes nommées par le président de la République.
Le maronitisme politique ainsi enraciné comptait bien perdurer. Le président tout seul, selon l’article 53 de la Constitution, "nomme et révoque les ministres parmi lesquels il désigne un président du Conseil des ministres". Il pouvait également rendre le budget exécutoire passé le 31 janvier si le texte n’est pas voté par la Chambre dans les délais, ouvrir des crédits en dehors des sessions parlementaires, demander une seconde délibération à l’Assemblée nationale, rendre exécutoire une loi revêtue de caractère d’urgence sur laquelle le Parlement n’aurait pas statué dans les 40 jours prévus par la loi, disposait seul des forces armées. L’article 52 lui permettait de négocier et ratifier certains traités, seul, sans même en informer le Parlement, selon " l’intérêt et la sûreté de l’État". Se basant sur l’article 55, le président avait par ailleurs pu dissoudre la Chambre trois fois en 1947, 1953 et 1964.
Mais, selon l’avocat Hassane Rifaï contacté par Ici Beyrouth, "le président de la République dans le régime parlementaire étant irresponsable, tous ses actes doivent être cosignés par le Premier ministre et le/les ministre(s) concerné(s), qui deva(ien)t répondre de ses/leurs actes en permanence devant la Chambre des députés". " Ceci existait avant Taëf et continue de l’être aujourd’hui", précise-t-il, "et prétendre le contraire c’est dire que le président était un prince qui gérait l’État selon son bon vouloir et en toute impunité".
Pacte et coutumes
Le Pacte national (1943) et les coutumes communautaires ont poussé cependant les présidents à ne pas prendre de décisions importantes sans l’accord du gouvernement ou du Premier ministre sunnite. En 1957, le président Camille Chamoun, dérogeant à cette règle coutumière, avait rallié le Liban à la doctrine Eisenhower, provoquant un clivage profond entre les Libanais. Celui-ci ne s’est réglé qu’après la guerre civile de 1958. À l’opposé, en 1969, le président Charles Hélou avait demandé au Conseil des ministres d’approuver l’accord du Caire, à la demande de la rue sunnite.
De même, le droit de révocation des ministres a été rarement utilisé par le président de la République. Seul Sleiman Frangié l’a appliqué deux fois: tout d’abord en 1972 avec le ministre de l’Éducation Henri Eddé, démis de ses fonctions deux mois après sa nomination. Une décision contresignée par le Premier ministre de l’époque, Saëb Salam. Ensuite, en 1976, alors que les combats faisaient rage au Liban, le ministre Philippe Takla est démis unilatéralement de ses fonctions par le chef de l’État, quelques mois avant la fin de son mandat. Un décret que le Premier ministre de l’époque, Rachid Karamé, avait cependant refusé de signer.
Or, la Constitution, fortement inspirée d’une France laïque et républicaine qui venait de se débarrasser d’un monarque, ne prenait pas en compte le communautarisme régissant le Liban, institutionnalisé depuis 1861 au Mont-Liban. Et c’est là où le bât blesse. Dans un système démocratique sain, la séparation des pouvoirs permet au Législatif de contrôler l’Exécutif, à travers des lois, la confiance accordée au gouvernement, des motions de censure, le vote du Budget… ce qui devrait normalement éviter qu’un président de la République n’ait carte blanche. Au Liban, la composition des Chambres élue avant Taëf était majoritairement chrétienne: les 8 assemblées de 1943 à 1972 étaient réparties selon un ratio de 6 députés chrétiens pour 5 musulmans. Il y a donc eu distorsion du texte, selon certains juristes qui considèrent que contrairement à la France dont le régime était stable, avec une meilleure pratique parlementaire, le Liban d’avant Taëf n’était pas aussi rodé et que des dérives de l’Exécutif ont eu lieu.
La Chambre était composée de plus de chrétiens que de musulmans, et comme le président de la République nommait personnellement des fonctionnaires aux postes-clés, et surtout, vu que les consultations parlementaires pour la nomination d’un Premier ministre sunnite n’étaient pas contraignantes, le chef de l’État pouvait souvent obtenir ce qu’il voulait.
Mais la Chambre ne se laissait pas toujours faire et faisait face au président. A titre d’exemple, le Premier ministre Amine el-Hafez, désigné par Sleiman Frangié contre l’avis de la Chambre, a été poussé à la démission au bout de deux mois.
La frustration institutionnelle des musulmans libanais s’aggrave au fil des années, notamment sous Camille Chamoun, puis dans les années 60 et 70 du siècle dernier, autour de la question palestinienne et des inégalités de développement qui affectent surtout les régions musulmanes. Des modifications constitutionnelles sont demandées et un meilleur partage du pouvoir, tenu d’une main de fer par les maronites. Ce sont finalement les armes qui prennent le dessus et le Liban s’embourbe dans des conflits complexes en partie civils et en partie régionaux.
 Rencontre entre le président libanais Sleiman Frangié (à gauche) et le président syrien Hafez el-Assad (à droite) à Damas
Rencontre entre le président libanais Sleiman Frangié (à gauche) et le président syrien Hafez el-Assad (à droite) à Damas
Des accords de "paix" parrainés par Damas
Le régime syrien intervient rapidement et, dès 1976, essaye de pousser les acteurs politiques à amender le pouvoir. Le 14 février 1976, le président Sleiman Frangié propose à partir de Damas la parité communautaire au Parlement avec une répartition égale des sièges entre députés musulmans et députés chrétiens. Il propose également que les consultations parlementaires soient contraignantes pour le choix du Premier ministre. Enfin, il suggère que tous les décrets et les projets de loi soient contresignés par les présidents de la République et du Conseil des ministres, ensemble, hormis celui de la désignation du Premier ministre et celui de l’acceptation de la démission du gouvernement. Une coutume existante depuis le Pacte national de 1943, même si les pratiques présidentielles permettaient de s’en passer.
En 1985, l’accord tripartite signé, également à Damas, par les chefs des trois plus grandes milices libanaises de l’époque – Élie Hobeika pour les Forces libanaises, Nabih Berry pour le mouvement Amal et Walid Joumblatt pour le Parti socialiste progressiste – propose un transfert du pouvoir exécutif au Conseil des ministres. Il stipule aussi que le président de la République ne présiderait que certaines réunions du Conseil des ministres, sans participer au vote, mais l’autorise à le convoquer dans certains cas d’urgence ou de menace nationale. En résumé, l’accord tripartie, qui consacre surtout le contrôle syrien du Liban, essaie de transférer complètement le pouvoir à une instance collégiale, en limitant considérablement les pouvoirs du chef de l’État. Il ne sera jamais appliqué, d’autant que les combats persistaient et qu’Élie Hobeika a été renversé par le chef actuel des FL, Samir Geagea.
Finalement, à Taëf en 1989, un (juste ?) milieu est trouvé. Le pouvoir exécutif est transféré au Conseil des ministres, mais permet au président de la République de présider toutes les réunions, de faire figurer à l’ordre du jour des points qui en auraient été omis et même de convoquer le Conseil des ministres à une réunion extraordinaire s’il le juge nécessaire. Le président de la République perd ainsi ses pouvoirs quasi-royaux – qui n’étaient pas tous d’ailleurs prévus dans la Constitution – en faveur du gouvernement, une instance collégiale répartie équitablement entre chrétiens et musulmans, tout comme la Chambre des députés.
 Le président de la Chambre, Hussein el-Husseini en discussion avec le roi Fahed à Taëf en octobre 1989.
Le président de la Chambre, Hussein el-Husseini en discussion avec le roi Fahed à Taëf en octobre 1989.
Un arbitre, qui peut bloquer ou être "écarté"
Le Liban devient, dans les textes, un régime parlementaire moniste, à partir de septembre 1990. Selon Joseph Maïla à l’époque, "il est inexact de dire que le document de Taëf réduit les pouvoirs du président de la République ou les limite. En réalité, il les ôte au chef de l’État et les transfère à une instance collégiale: le Conseil des ministres et à son président". Les prérogatives présidentielles sont nettement expliquées et détaillées dans la Constitution amendée en 1990 et toujours en vigueur.
L’accord de Taëf corrige en outre le problème que posait le fait qu’un président avec trop de pouvoir ne soit pas tenu pour responsable de ses actes. "Oui, les textes constitutionnels de la IIIe République française (1875-1940) et de la République libanaise se ressemblaient et ils donnaient apparemment des pouvoirs très larges au président de la République", souligne l’avocat Hassane Rifaï. Et de préciser: "Mais ces textes ont été, dès 1877, complétés par la coutume parlementaire qui a mis fin au président-prince du fait même que ce dernier ne peut presque rien faire seul sans ce fameux contreseing ministériel. C’est donc une question de responsabilité et non pas une question de prérogatives d’un président maronite qui ont été extorquées par la Constitution de Taëf."
Pour former un gouvernement, le président de la République doit donc consulter aujourd’hui les députés et il est obligé de choisir le président du Conseil en fonction des résultats de ces consultations contraignantes et de sa délibération avec le président de la Chambre. Il doit donc, en théorie, "se soumettre ou se démettre" face à l’Assemblée qu’il ne peut plus dissoudre que dans des cas bien précis, en accord avec le gouvernement.
Le président maronite se retrouve contraint par le Législatif, tandis qu’avant Taëf et même s’il se laissait imposer une personnalité sunnite, au moins il choisissait le Premier ministre dans les formes, ou pouvait contrevenir à la décision des parlementaires. Avec les modifications constitutionnelles de Taëf, il faudrait que le chef de l’État ait une forte personnalité pour pouvoir jongler entre les textes et les coutumes. Il est de ce fait plus difficile qu’auparavant pour le président de l’après Taëf de gouverner ou d’arbitrer, mais pas impossible.
Depuis 1990, à moins de bénéficier d’une force para-étatique ou d’occupation en soutien, le président de la République n’a plus que quelques leviers, conformément à l’article 53 de la Constitution pour mettre en place ses politiques publiques et gouverner: former le gouvernement en accord avec le président du Conseil des ministres, soumettre n’importe quel sujet urgent au Conseil des ministres, ou s’adresser à la Chambre des députés. En vertu des articles 56 et 57, il peut également renvoyer une loi au Parlement, un décret au gouvernement, ou saisir le Conseil constitutionnel. Enfin, il peut ajourner la Chambre pour une durée d’un mois comme le dispose l’article 59. Dans l’ensemble, le président de la République obtient, depuis Taëf, un rôle d’arbitre. Il reste normalement au-dessus de la mêlée, pour influer sur les décideurs, la Chambre et le Conseil des ministres. N’étant pas responsable des actes de sa fonction, contrairement au gouvernement, le président doit influencer, négocier pour que tous les Libanais et toutes les forces politiques soient équitablement traités, et non pas bloquer les institutions dans l’intérêt d’un camp, surtout pas le sien. Être arbitre nécessite parfois de bloquer certaines décisions, dans l’objectif d’atteindre un consensus satisfaisant à toutes les forces en présence, à travers un dialogue ou une médiation institutionnels, constructifs et utiles – contrairement aux séances de "dialogues" tenues, dirait-on, avec un pistolet sur la tempe, organisées au Liban ou à l’étranger, où un seul acteur impose son bon vouloir par la menace.
Quoi qu’il en soit, plusieurs obstacles empêchent cette république taëfienne de fonctionner. Tout d’abord, le pouvoir exécutif est aux mains d’un collège libanais multiconfessionnel qui doit être d’accord sur tout et qui ne peut décider qu’avec un quorum des 2/3. Or, l’une des prérogatives présidentielles qui permettait avant 1990 d’éviter tout blocage de la part des ministres, était la possibilité de révoquer le ministre, chose très difficile aujourd’hui pour le Premier ministre et pour le président. Même s’ils le nomment à deux par décret, sa révocation nécessite les voix des 2/3 du gouvernement ou un vote de la majorité à la Chambre. L’affaire du ministre Georges Cordahi qui refusait de démissionner, après avoir été la cause d’une crise diplomatique sans précédent entre le Liban et les pays du Golfe, n’est qu’un exemple. Ce ne sont donc pas les prérogatives limitées du président qui représentent le principal problème, mais l’autonomie que peut avoir un ministre, surtout si l’article 66 de la Constitution n’est pas respecté: "Les ministres sont solidairement responsables devant la Chambre des députés de la politique générale du gouvernement, et individuellement de leurs actes personnels" dispose le texte. Or, ces 32 dernières années, et notamment depuis l’accord de Doha et les gouvernements "d’union nationale" ou gouvernements dotés du tiers de blocage, les ministres n’ont aucun scrupule à se considérer comme des monarques à la tête de leurs ministères et de n’en faire qu’à leurs têtes. Au Liban, nous sommes loin d’un Jean-Pierre Chevènement, ministre français, adepte du "un ministre ça ferme sa gueule ou ça démissionne", et qui démissionnait à chaque fois qu’il n’était pas d’accord avec son président ou son Premier ministre.
Au Liban, ce ne sont pas les textes qui font défaut. Le problème se pose au niveau des pratiques parlementaires, gouvernementales et présidentielles qui ne respectent ni les textes ni l’esprit des lois. Aucune Constitution, écrite ou coutumière, n’est parfaite. Ce sont les femmes et les hommes, représentants de la Nation ou appelés à servir leurs pays, qui ont le devoir et la responsabilité de la Res Publica, la chose publique, qui appartient à tous. L’application et le respect des textes constitutionnels – ou bien leur amendement si besoin, démocratiquement et non pas par le biais de blocages étatique ou milicien, et pour le bien commun, non pas en faveur d’intérêts privés ou d’agendas extérieurs – ne dépend que d’eux, et seuls elles et eux peuvent permettre la construction d’un État respecté par la société.
"À cause de Taëf, le président chrétien n’a plus de prérogatives constitutionnelles". Assénée depuis 1989, date de naissance de l’accord qui constitue la base de la Constitution libanaise et qui qui porte le nom de la ville où il a été conclu en Arabie saoudite, tout Libanais a entendu cette phrase au moins une fois depuis.
Cri de ralliement des chrétiens libanais déçus de la période post-1990 ou de leurs compatriotes lésés durant la période de "reconstruction" du pays par un Premier ministre-homme d’affaires, en l’occurrence Rafic Hariri, les détracteurs du document d’entente nationale sont nostalgiques des années "glorieuses" du Liban. Ils considèrent que c’est cet accord qui est la source des problèmes structurels profonds auxquels le pays est confronté depuis plus de 15 ans.
Les amendements constitutionnels décidés à Taëf en novembre 1989 et votés en septembre 1990 ont transféré certaines prérogatives constitutionnelles de la présidence de la République au Conseil des ministres. L'article de la nouvelle Constitution est clair: "Le pouvoir exécutif est confié au Conseil des ministres". Depuis 1927, il était "confié au président de la République qui l’exerce avec l’assistance des ministres […]".
Mais, contrairement à certaines croyances populaires, le président sunnite du Conseil des ministres n’est pas devenu le nouveau "président", et ne peut pas l’être, comme le camp présidentiel essaie aujourd’hui de le faire croire. Le président sortant Michel Aoun l’a laissé entendre au cours de ses dernières interventions publiques, mais son gendre, le chef du CPL Gebran Bassil, n’arrête pas de le répéter depuis trois jours.
Dans son commentaire au sujet de l’accord, fin 1989, Joseph Maïla, alors rédacteur en chef de la revue "Les Cahiers de l’Orient", soulignait que les "réformes politiques entreprises à Taëf restent fortement inspirés par la logique du système communautaire. En l’occurrence, ce ne sont pas à proprement parler des «réformes» qui ont été adoptées à Taëf mais plutôt de nouveaux accommodements communautaires s’inscrivant dans le cadre inchangé du système politique libanais" (MAILA Joseph, «Le document d’entente nationale, un commentaire», Les Cahiers de l’Orient, 4ᵉ trimestre 1989/1er trimestre 1990, no 16/17, p. 178). Et d’ajouter: "Le document tend à faire du Conseil des ministres l’organe collégial investi du pouvoir exécutif […] Le texte tranche ici un débat où le clivage islamo-chrétien opérait au grand jour."
 À gauche, le président de la République, Michel Aoun, présidant un Conseil des ministres. À sa droite, le Premier ministre Hassan Diab, chef de l'Éxecutif
À gauche, le président de la République, Michel Aoun, présidant un Conseil des ministres. À sa droite, le Premier ministre Hassan Diab, chef de l'ÉxecutifUn président-monarque, tête du maronitisme politique
La Constitution, rédigée et adoptée à l’époque du Mandat, s’est largement inspirée des lois constitutionnelles de la IIIᵉ République française de 1875. Un régime parlementaire est mis en place avec deux assemblées: le Sénat et la Chambre des députés. Le Parlement élit un président de la République. Ce dernier forme un gouvernement pour gérer les affaires publiques exécutives. La responsabilité du chef de l’État, maître de l’Exécutif, ne pouvait être retenue devant aucune institution, il ne pouvait donc pas être démis de ses fonctions, contrairement aux ministres, responsables de leurs actes devant le Législatif qui accorde la confiance au gouvernement ou la lui retire.
Or, des amendements constitutionnels en 1927 et 1929 vont transformer le système en un régime semi-présidentiel, "une préfiguration de la Constitution de la Ve République" française, selon le constitutionnaliste Béchara Menassa, dans son ouvrage de référence "Dictionnaire de la Constitution libanaise". Le constitutionnaliste Edmond Rabbath précise également dans le même ouvrage que les amendements d’octobre 1927 ont rendu "le Parlement tributaire du président de la République". En 1929, c’est l’article 55 qui est amendé et donne au président de la République, "par décret motivé, pris sur l’avis conforme du Conseil des ministres, le droit de dissoudre la Chambre des députés [...]". Le pouvoir est donc entre les mains du chef de l’État, élu pour six ans, inamovible et irresponsable.
D’autres juristes considèrent que le régime parlementaire moniste – donc quand le gouvernement n’est responsable que devant le Législatif – prévu dans les textes, n’a pas été respecté par les présidents entre 1943 et 1990, faisant du Liban un régime parlementaire dualiste.
Après l’indépendance et le départ du tuteur français, le président de la République s'est retrouvé en conséquence doté de pouvoirs importants, sans réel contre-pouvoir. C’est bien une période où la prééminence maronite s’ancre avec l’attribution ou l’octroi à des personnalités de cette communauté de plusieurs postes importants au sein de l’administration, à l’instar du commandement de l’armée, du service de renseignements, du secrétariat général du ministère des Affaires étrangères, du gouvernorat de la Banque du Liban, etc. Ces personnalités sont toutes nommées par le président de la République.
Le maronitisme politique ainsi enraciné comptait bien perdurer. Le président tout seul, selon l’article 53 de la Constitution, "nomme et révoque les ministres parmi lesquels il désigne un président du Conseil des ministres". Il pouvait également rendre le budget exécutoire passé le 31 janvier si le texte n’est pas voté par la Chambre dans les délais, ouvrir des crédits en dehors des sessions parlementaires, demander une seconde délibération à l’Assemblée nationale, rendre exécutoire une loi revêtue de caractère d’urgence sur laquelle le Parlement n’aurait pas statué dans les 40 jours prévus par la loi, disposait seul des forces armées. L’article 52 lui permettait de négocier et ratifier certains traités, seul, sans même en informer le Parlement, selon " l’intérêt et la sûreté de l’État". Se basant sur l’article 55, le président avait par ailleurs pu dissoudre la Chambre trois fois en 1947, 1953 et 1964.
Mais, selon l’avocat Hassane Rifaï contacté par Ici Beyrouth, "le président de la République dans le régime parlementaire étant irresponsable, tous ses actes doivent être cosignés par le Premier ministre et le/les ministre(s) concerné(s), qui deva(ien)t répondre de ses/leurs actes en permanence devant la Chambre des députés". " Ceci existait avant Taëf et continue de l’être aujourd’hui", précise-t-il, "et prétendre le contraire c’est dire que le président était un prince qui gérait l’État selon son bon vouloir et en toute impunité".
Pacte et coutumes
Le Pacte national (1943) et les coutumes communautaires ont poussé cependant les présidents à ne pas prendre de décisions importantes sans l’accord du gouvernement ou du Premier ministre sunnite. En 1957, le président Camille Chamoun, dérogeant à cette règle coutumière, avait rallié le Liban à la doctrine Eisenhower, provoquant un clivage profond entre les Libanais. Celui-ci ne s’est réglé qu’après la guerre civile de 1958. À l’opposé, en 1969, le président Charles Hélou avait demandé au Conseil des ministres d’approuver l’accord du Caire, à la demande de la rue sunnite.
De même, le droit de révocation des ministres a été rarement utilisé par le président de la République. Seul Sleiman Frangié l’a appliqué deux fois: tout d’abord en 1972 avec le ministre de l’Éducation Henri Eddé, démis de ses fonctions deux mois après sa nomination. Une décision contresignée par le Premier ministre de l’époque, Saëb Salam. Ensuite, en 1976, alors que les combats faisaient rage au Liban, le ministre Philippe Takla est démis unilatéralement de ses fonctions par le chef de l’État, quelques mois avant la fin de son mandat. Un décret que le Premier ministre de l’époque, Rachid Karamé, avait cependant refusé de signer.
Or, la Constitution, fortement inspirée d’une France laïque et républicaine qui venait de se débarrasser d’un monarque, ne prenait pas en compte le communautarisme régissant le Liban, institutionnalisé depuis 1861 au Mont-Liban. Et c’est là où le bât blesse. Dans un système démocratique sain, la séparation des pouvoirs permet au Législatif de contrôler l’Exécutif, à travers des lois, la confiance accordée au gouvernement, des motions de censure, le vote du Budget… ce qui devrait normalement éviter qu’un président de la République n’ait carte blanche. Au Liban, la composition des Chambres élue avant Taëf était majoritairement chrétienne: les 8 assemblées de 1943 à 1972 étaient réparties selon un ratio de 6 députés chrétiens pour 5 musulmans. Il y a donc eu distorsion du texte, selon certains juristes qui considèrent que contrairement à la France dont le régime était stable, avec une meilleure pratique parlementaire, le Liban d’avant Taëf n’était pas aussi rodé et que des dérives de l’Exécutif ont eu lieu.
La Chambre était composée de plus de chrétiens que de musulmans, et comme le président de la République nommait personnellement des fonctionnaires aux postes-clés, et surtout, vu que les consultations parlementaires pour la nomination d’un Premier ministre sunnite n’étaient pas contraignantes, le chef de l’État pouvait souvent obtenir ce qu’il voulait.
Mais la Chambre ne se laissait pas toujours faire et faisait face au président. A titre d’exemple, le Premier ministre Amine el-Hafez, désigné par Sleiman Frangié contre l’avis de la Chambre, a été poussé à la démission au bout de deux mois.
La frustration institutionnelle des musulmans libanais s’aggrave au fil des années, notamment sous Camille Chamoun, puis dans les années 60 et 70 du siècle dernier, autour de la question palestinienne et des inégalités de développement qui affectent surtout les régions musulmanes. Des modifications constitutionnelles sont demandées et un meilleur partage du pouvoir, tenu d’une main de fer par les maronites. Ce sont finalement les armes qui prennent le dessus et le Liban s’embourbe dans des conflits complexes en partie civils et en partie régionaux.
 Rencontre entre le président libanais Sleiman Frangié (à gauche) et le président syrien Hafez el-Assad (à droite) à Damas
Rencontre entre le président libanais Sleiman Frangié (à gauche) et le président syrien Hafez el-Assad (à droite) à DamasDes accords de "paix" parrainés par Damas
Le régime syrien intervient rapidement et, dès 1976, essaye de pousser les acteurs politiques à amender le pouvoir. Le 14 février 1976, le président Sleiman Frangié propose à partir de Damas la parité communautaire au Parlement avec une répartition égale des sièges entre députés musulmans et députés chrétiens. Il propose également que les consultations parlementaires soient contraignantes pour le choix du Premier ministre. Enfin, il suggère que tous les décrets et les projets de loi soient contresignés par les présidents de la République et du Conseil des ministres, ensemble, hormis celui de la désignation du Premier ministre et celui de l’acceptation de la démission du gouvernement. Une coutume existante depuis le Pacte national de 1943, même si les pratiques présidentielles permettaient de s’en passer.
En 1985, l’accord tripartite signé, également à Damas, par les chefs des trois plus grandes milices libanaises de l’époque – Élie Hobeika pour les Forces libanaises, Nabih Berry pour le mouvement Amal et Walid Joumblatt pour le Parti socialiste progressiste – propose un transfert du pouvoir exécutif au Conseil des ministres. Il stipule aussi que le président de la République ne présiderait que certaines réunions du Conseil des ministres, sans participer au vote, mais l’autorise à le convoquer dans certains cas d’urgence ou de menace nationale. En résumé, l’accord tripartie, qui consacre surtout le contrôle syrien du Liban, essaie de transférer complètement le pouvoir à une instance collégiale, en limitant considérablement les pouvoirs du chef de l’État. Il ne sera jamais appliqué, d’autant que les combats persistaient et qu’Élie Hobeika a été renversé par le chef actuel des FL, Samir Geagea.
Finalement, à Taëf en 1989, un (juste ?) milieu est trouvé. Le pouvoir exécutif est transféré au Conseil des ministres, mais permet au président de la République de présider toutes les réunions, de faire figurer à l’ordre du jour des points qui en auraient été omis et même de convoquer le Conseil des ministres à une réunion extraordinaire s’il le juge nécessaire. Le président de la République perd ainsi ses pouvoirs quasi-royaux – qui n’étaient pas tous d’ailleurs prévus dans la Constitution – en faveur du gouvernement, une instance collégiale répartie équitablement entre chrétiens et musulmans, tout comme la Chambre des députés.
 Le président de la Chambre, Hussein el-Husseini en discussion avec le roi Fahed à Taëf en octobre 1989.
Le président de la Chambre, Hussein el-Husseini en discussion avec le roi Fahed à Taëf en octobre 1989.Un arbitre, qui peut bloquer ou être "écarté"
Le Liban devient, dans les textes, un régime parlementaire moniste, à partir de septembre 1990. Selon Joseph Maïla à l’époque, "il est inexact de dire que le document de Taëf réduit les pouvoirs du président de la République ou les limite. En réalité, il les ôte au chef de l’État et les transfère à une instance collégiale: le Conseil des ministres et à son président". Les prérogatives présidentielles sont nettement expliquées et détaillées dans la Constitution amendée en 1990 et toujours en vigueur.
L’accord de Taëf corrige en outre le problème que posait le fait qu’un président avec trop de pouvoir ne soit pas tenu pour responsable de ses actes. "Oui, les textes constitutionnels de la IIIe République française (1875-1940) et de la République libanaise se ressemblaient et ils donnaient apparemment des pouvoirs très larges au président de la République", souligne l’avocat Hassane Rifaï. Et de préciser: "Mais ces textes ont été, dès 1877, complétés par la coutume parlementaire qui a mis fin au président-prince du fait même que ce dernier ne peut presque rien faire seul sans ce fameux contreseing ministériel. C’est donc une question de responsabilité et non pas une question de prérogatives d’un président maronite qui ont été extorquées par la Constitution de Taëf."
Pour former un gouvernement, le président de la République doit donc consulter aujourd’hui les députés et il est obligé de choisir le président du Conseil en fonction des résultats de ces consultations contraignantes et de sa délibération avec le président de la Chambre. Il doit donc, en théorie, "se soumettre ou se démettre" face à l’Assemblée qu’il ne peut plus dissoudre que dans des cas bien précis, en accord avec le gouvernement.
Le président maronite se retrouve contraint par le Législatif, tandis qu’avant Taëf et même s’il se laissait imposer une personnalité sunnite, au moins il choisissait le Premier ministre dans les formes, ou pouvait contrevenir à la décision des parlementaires. Avec les modifications constitutionnelles de Taëf, il faudrait que le chef de l’État ait une forte personnalité pour pouvoir jongler entre les textes et les coutumes. Il est de ce fait plus difficile qu’auparavant pour le président de l’après Taëf de gouverner ou d’arbitrer, mais pas impossible.
Depuis 1990, à moins de bénéficier d’une force para-étatique ou d’occupation en soutien, le président de la République n’a plus que quelques leviers, conformément à l’article 53 de la Constitution pour mettre en place ses politiques publiques et gouverner: former le gouvernement en accord avec le président du Conseil des ministres, soumettre n’importe quel sujet urgent au Conseil des ministres, ou s’adresser à la Chambre des députés. En vertu des articles 56 et 57, il peut également renvoyer une loi au Parlement, un décret au gouvernement, ou saisir le Conseil constitutionnel. Enfin, il peut ajourner la Chambre pour une durée d’un mois comme le dispose l’article 59. Dans l’ensemble, le président de la République obtient, depuis Taëf, un rôle d’arbitre. Il reste normalement au-dessus de la mêlée, pour influer sur les décideurs, la Chambre et le Conseil des ministres. N’étant pas responsable des actes de sa fonction, contrairement au gouvernement, le président doit influencer, négocier pour que tous les Libanais et toutes les forces politiques soient équitablement traités, et non pas bloquer les institutions dans l’intérêt d’un camp, surtout pas le sien. Être arbitre nécessite parfois de bloquer certaines décisions, dans l’objectif d’atteindre un consensus satisfaisant à toutes les forces en présence, à travers un dialogue ou une médiation institutionnels, constructifs et utiles – contrairement aux séances de "dialogues" tenues, dirait-on, avec un pistolet sur la tempe, organisées au Liban ou à l’étranger, où un seul acteur impose son bon vouloir par la menace.
Quoi qu’il en soit, plusieurs obstacles empêchent cette république taëfienne de fonctionner. Tout d’abord, le pouvoir exécutif est aux mains d’un collège libanais multiconfessionnel qui doit être d’accord sur tout et qui ne peut décider qu’avec un quorum des 2/3. Or, l’une des prérogatives présidentielles qui permettait avant 1990 d’éviter tout blocage de la part des ministres, était la possibilité de révoquer le ministre, chose très difficile aujourd’hui pour le Premier ministre et pour le président. Même s’ils le nomment à deux par décret, sa révocation nécessite les voix des 2/3 du gouvernement ou un vote de la majorité à la Chambre. L’affaire du ministre Georges Cordahi qui refusait de démissionner, après avoir été la cause d’une crise diplomatique sans précédent entre le Liban et les pays du Golfe, n’est qu’un exemple. Ce ne sont donc pas les prérogatives limitées du président qui représentent le principal problème, mais l’autonomie que peut avoir un ministre, surtout si l’article 66 de la Constitution n’est pas respecté: "Les ministres sont solidairement responsables devant la Chambre des députés de la politique générale du gouvernement, et individuellement de leurs actes personnels" dispose le texte. Or, ces 32 dernières années, et notamment depuis l’accord de Doha et les gouvernements "d’union nationale" ou gouvernements dotés du tiers de blocage, les ministres n’ont aucun scrupule à se considérer comme des monarques à la tête de leurs ministères et de n’en faire qu’à leurs têtes. Au Liban, nous sommes loin d’un Jean-Pierre Chevènement, ministre français, adepte du "un ministre ça ferme sa gueule ou ça démissionne", et qui démissionnait à chaque fois qu’il n’était pas d’accord avec son président ou son Premier ministre.
Au Liban, ce ne sont pas les textes qui font défaut. Le problème se pose au niveau des pratiques parlementaires, gouvernementales et présidentielles qui ne respectent ni les textes ni l’esprit des lois. Aucune Constitution, écrite ou coutumière, n’est parfaite. Ce sont les femmes et les hommes, représentants de la Nation ou appelés à servir leurs pays, qui ont le devoir et la responsabilité de la Res Publica, la chose publique, qui appartient à tous. L’application et le respect des textes constitutionnels – ou bien leur amendement si besoin, démocratiquement et non pas par le biais de blocages étatique ou milicien, et pour le bien commun, non pas en faveur d’intérêts privés ou d’agendas extérieurs – ne dépend que d’eux, et seuls elles et eux peuvent permettre la construction d’un État respecté par la société.
Lire aussi




Commentaires