
Quand le virus de la grippe pénètre dans le corps humain, il s'infiltre dans les cellules et utilise leur machinerie pour se multiplier. Cependant, ce processus n'est pas parfait et des erreurs surviennent régulièrement dans la réplication de son matériel génétique. C’est ce qu’on appelle les mutations. Celles-ci permettent au virus d'échapper, partiellement ou totalement, à la réponse immunitaire, rendant nécessaire la mise à jour annuelle du vaccin pour maintenir son efficacité et limiter la propagation du virus. Décryptage.
Toux sèche, éternuements fréquents, fièvre élevée, douleurs musculaires, céphalées et fatigue intense: ces symptômes caractéristiques apparaissent chaque hiver, signalant la recrudescence des infections respiratoires saisonnières. Parmi celles-ci, la grippe est l'une des plus courantes. En effet, avec la baisse des températures, les conditions deviennent propices à la propagation accrue de plusieurs virus, dont ceux de l’influenza, affectant aussi bien les jeunes et les adultes que les personnes âgées, avec des conséquences potentiellement graves pour les individus vulnérables.
En France, l'épidémie de grippe est particulièrement intense cette saison, bien qu'elle semble avoir franchi son pic. Malgré une diminution des indicateurs liés à l'activité grippale, la maladie continue d'affecter toutes les régions métropolitaines ainsi que certaines zones d'outre-mer. De plus, le vaccin antigrippal s'est avéré peu protecteur cette année dans l’Hexagone, en particulier pour les personnes de plus de 65 ans, chez qui son efficacité a été estimée à seulement 26%. La circulation simultanée de trois souches du virus a indéniablement contribué à la gravité de la situation. Bien que celle-ci se stabilise depuis début février, les hospitalisations restent “très élevées” chez les enfants, selon un bilan hebdomadaire de Santé publique France.
Pic épidémique
Quant au Liban, bien que l'hiver se soit fait attendre cette année, il est désormais bien installé, marquant le début de la phase aiguë des infections respiratoires. Le retard dans l'apparition des températures hivernales aurait repoussé le pic épidémique. D'après plusieurs médecins interrogés par Ici Beyrouth, les formes de grippe observées jusqu’à présent ne sont pas plus sévères que celles des années précédentes. L'adoption des gestes barrières reste, toutefois, cruciale pour limiter la propagation des virus.
Durant cette phase, la vaccination reste une stratégie clé pour prévenir ou du moins protéger contre les formes graves de la maladie. Quoique le nombre de contaminations augmente progressivement, la vaccination demeure efficace et préconisée, en particulier pour les populations les plus vulnérables telles que les personnes âgées, les femmes enceintes et les individus souffrant de pathologies chroniques ou d’immunodéficiences. Plus susceptibles de développer des complications sévères, ces groupes sont également ceux pour qui la vaccination peut prévenir des hospitalisations prolongées, voire des décès. Comme chaque année, la même question resurgit: ce vaccin est-il véritablement efficace et pourquoi observe-t-on des variations dans le taux de réponse d’une année à l’autre?
Mise à jour vaccinale
Lorsque le virus infecte les cellules de l'hôte, telles que celles de l'Homme, il se sert de la machinerie cellulaire pour se multiplier. Durant ce processus, des erreurs dans la réplication du matériel génétique viral peuvent survenir, entraînant ainsi des mutations. Ces changements permettent au virus de contourner, souvent partiellement, la réponse immunitaire, même chez les individus déjà immunisés par une infection antérieure ou une vaccination. La diminution de l'efficacité de l’immunité dite acquise favorise la réapparition de l'infection sous forme d'épidémies saisonnières chaque hiver. En raison de ces mutations continues, le vaccin antigrippal doit donc être réactualisé chaque année pour cibler les souches les plus susceptibles de circuler. Ainsi, même les individus ayant été vaccinés l'année précédente doivent se faire revacciner pour se protéger contre les souches émergentes.
Nouvelles variantes
Le vaccin contre la grippe cible principalement deux protéines de surface du virus: l’hémagglutinine (HA) et la neuraminidase (NA). Depuis les pandémies de 1968 et 1977, les sous-types de virus les plus répandus chez l’humain sont H1 et H3 pour les hémagglutinines, ainsi que N1 et N2 pour les neuraminidases. Les combinaisons les plus courantes en circulation sont H1N1 et H3N2. Les vaccins actuels contiennent généralement deux souches du virus de type A (H1N1 et H3N2, qui subissent des mutations spécifiques chaque année), ainsi qu'une seule souche de type B pour les vaccins trivalents, ou deux souches de type B pour les vaccins quadrivalents.
Chaque année, l'Organisation mondiale de la santé (OMS) publie des recommandations sur la composition des vaccins pour les hémisphères nord et sud. Celles-ci sont établies en fonction des souches en circulation dans l’hémisphère opposé pendant la saison en cours. Elles sont donc publiées à la fin de l’été pour l’hémisphère nord et au début de l'année pour l'hémisphère sud. Ce mécanisme permet de détecter l’émergence de nouvelles souches et variantes susceptibles de se propager largement en raison de la circulation du virus à travers les deux hémisphères, l’un servant de réservoir infectieux pour l’autre durant l'été considéré comme une période de faible circulation virale.
Efficacité du vaccin
Le principe de la vaccination contre la grippe repose sur la stimulation du système immunitaire. En introduisant une version inactivée ou atténuée du virus, le vaccin incite le système immunitaire à produire des anticorps spécifiques contre les protéines de surface du virus. Cela permet à l'organisme de “mémoriser” ces structures pour répondre rapidement et efficacement en cas de contamination réelle par le virus. Les études cliniques et épidémiologiques portant sur l’efficacité des vaccins antigrippaux montrent des résultats généralement positifs, avec certaines variations d’une saison à l’autre. Il réduirait le risque de contracter la grippe de 40 à 60% en fonction des années, des groupes d'âge et de la correspondance entre les souches incluses dans la composition du vaccin et le virus en circulation. Cependant, il ne protège pas toujours contre toutes les souches en circulation, notamment celles qui ont muté de manière imprévue.
Publiée en 2018, une étude soutenue par les centres pour le contrôle et la prévention des maladies aux États-Unis a montré qu’entre 2012 et 2015, la vaccination antigrippale a réduit de 82% le risque d'admission en unité de soins intensifs en raison de la grippe chez les adultes. En outre, une étude publiée en 2023 dans JAMA Pediatrics révèle que les nourrissons de moins de 6 mois nés de mères ayant été vaccinées pendant leur grossesse étaient protégés contre les visites aux urgences et les hospitalisations liées à l’infection virale. Finalement, les patients immunodéprimés présentent un risque élevé de morbidité et de mortalité associées à la grippe. Il est donc recommandé que ces derniers reçoivent chaque année le vaccin contre la grippe.
Il serait opportun de souligner que la réponse immunitaire diffère selon les individus en fonction de plusieurs facteurs tels que l'âge, les antécédents médicaux et la capacité du système immunitaire à réagir au vaccin. À titre d’exemple, les personnes âgées peuvent présenter une réponse moins efficace après la vaccination, en raison du déclin des fonctions immunitaires lié au vieillissement, phénomène désigné sous le nom d'immunosénescence.
Malgré certaines limitations, la vaccination reste l'outil le plus puissant pour contrôler la propagation de la grippe. Elle est particulièrement importante dans la prévention des formes graves de la maladie et dans la réduction de la charge hospitalière durant les périodes de pics épidémiques.

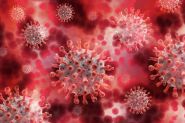


Commentaires