
Le musée du Quai Branly - Jacques Chirac inaugure une exposition inédite sur la mission Dakar-Djibouti (1931-1933) et les conditions d’acquisition d’objets africains pendant la colonisation. Ce travail collaboratif franco-africain met en lumière les zones d’ombre d’un pan majeur de l’ethnologie française.
Le musée du Quai Branly - Jacques Chirac à Paris, qui dénombre 72 000 objets d’Afrique subsaharienne dans ses collections, inaugure lundi une exposition inédite sur leurs conditions d’acquisition, souvent par la force, le vol ou la ruse, pendant la colonisation.
Intitulée Mission Dakar-Djibouti (1931-1933), contre-enquêtes, elle revient, par le biais d’un travail commun de chercheurs français et africains, sur l’un des moments les plus emblématiques de l’ethnologie française, au cœur des collections Afrique du musée de l’Homme puis du musée du Quai Branly.
Très médiatisée à l’époque, cette mission a été documentée par la publication en 1934 de L’Afrique fantôme (Gallimard), journal personnel de l’écrivain ethnologue Michel Leiris, qui en a fait partie, très critique sur son déroulement.
Conduite par Marcel Griaule, elle a traversé d’ouest en est quinze pays africains sous domination coloniale européenne, à l’exception de l’Éthiopie indépendante, et collecté 3 600 objets, ainsi que d’innombrables manuscrits, spécimens naturalistes et ossements humains.
Demande de restitution
"Près de la moitié provient du Mali, qui a demandé 81 de ces objets répondant aux critères de restitution (acquis par la force ou la coercition, ndlr) et 30 autres qui sont à l’étude", selon Gaëlle Beaujean, commissaire générale de l’exposition et responsable des collections Afrique du musée.
Contrairement à ses homologues, Daouda Keita, directeur du musée national du Mali et co-commissaire, n’a pas souhaité répondre aux questions de l’AFP.
Outre le Mali (ancien Soudan français colonial), l’exposition, thématique, présente environ 350 objets collectés au Sénégal, Burkina Faso (Haute-Volta), Bénin (Dahomey), Niger, Nigeria, Tchad, Cameroun, République centrafricaine (Oubangui-Chari), République démocratique du Congo (Congo belge), Soudan du Sud et Soudan (Soudan anglo-égyptien), Éthiopie, Érythrée et Djibouti (Côte française des Somalis).
Beaucoup sont liés à des cultes ou rites initiatiques. Des spécimens naturalistes, manuscrits et nombre d’archives sont également exposés.
Pour environ la moitié, leurs modalités d’acquisition demeurent inconnues, indique Mme Beaujean. Les autres (achats, dons, commandes, échanges, fouilles ainsi que vols et réquisitions) sont abordées.
"Invisibilisés"
Parallèlement, des "contre-enquêtes" ont été menées au cours des quatre dernières années par les commissaires français et africains, une douzaine au total, dans une trentaine de localités traversées par la mission Dakar-Djibouti, partiellement retracées dans l’exposition à travers des documents audiovisuels.
Elles "ne sont en aucun cas des procès mais des recherches qui ont conduit à un partage de nouvelles connaissances et données sur des situations très spécifiques", souligne Éric Jolly, co-commissaire.
Elles ont permis, "grâce à des photos montrées aux populations, de croiser les informations disponibles et de restituer l’identité d’acteurs africains totalement invisibilisés" lors de la mission, souligne Marianne Lemaire, co-commissaire elle aussi.
Parmi eux, des traducteurs, informateurs, artistes, guides, rois ou chefs de cantons, et des femmes, artisanes, cheffes des esprits ou exciseuses, ainsi qu’une ethnologue, Deborah Lifchitz.
Pour l’un des commissaires africains, Didier Houénoudé, professeur à l’université d’Abomey-Calavi au Bénin et directeur par intérim des collections ethnographiques de l’État de Saxe en Allemagne, "cette exposition fera date".
"C’est un travail qui aurait dû être fait depuis longtemps et le point de départ d’un travail collaboratif indispensable et beaucoup plus équitable", dit-il à l’AFP, en remerciant le musée français d’avoir eu "le courage" de l’initier, même s’il concède que "les points de vue n’ont pas toujours fait l’unanimité".
Ce projet "a le mérite de nous avoir rassemblés dans l’intérêt de la recherche", commente Mame Magatte Sène Thiaw, son homologue au musée des Civilisations noires de Dakar.
Cette historienne se réjouit d’avoir pu mener sa "contre-enquête dans la région de Tambacounda (sud-est de Dakar) sur une mystérieuse poupée de fertilité" auprès "de populations détentrices de savoir-faire ancestraux".
Pour son homologue éthiopien Sisay Sahile Beyene, professeur d’université à Gondar, il s’agit d’une "première étape inédite dans la compréhension de notre héritage en exil".
Il salue "un résultat supérieur à ce qu’il espérait", même si, comme dans d’autres pays, "le conflit armé (dans le nord-ouest de l’Éthiopie, ndlr) a rendu difficiles les contre-enquêtes".
Une quarantaine de peintures murales chrétiennes ramenées d’une église de Gondar lors de la mission des années 1930 font partie des collections du musée du Quai Branly.
Avec AFP

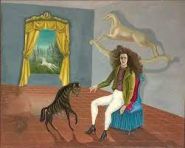

Commentaires