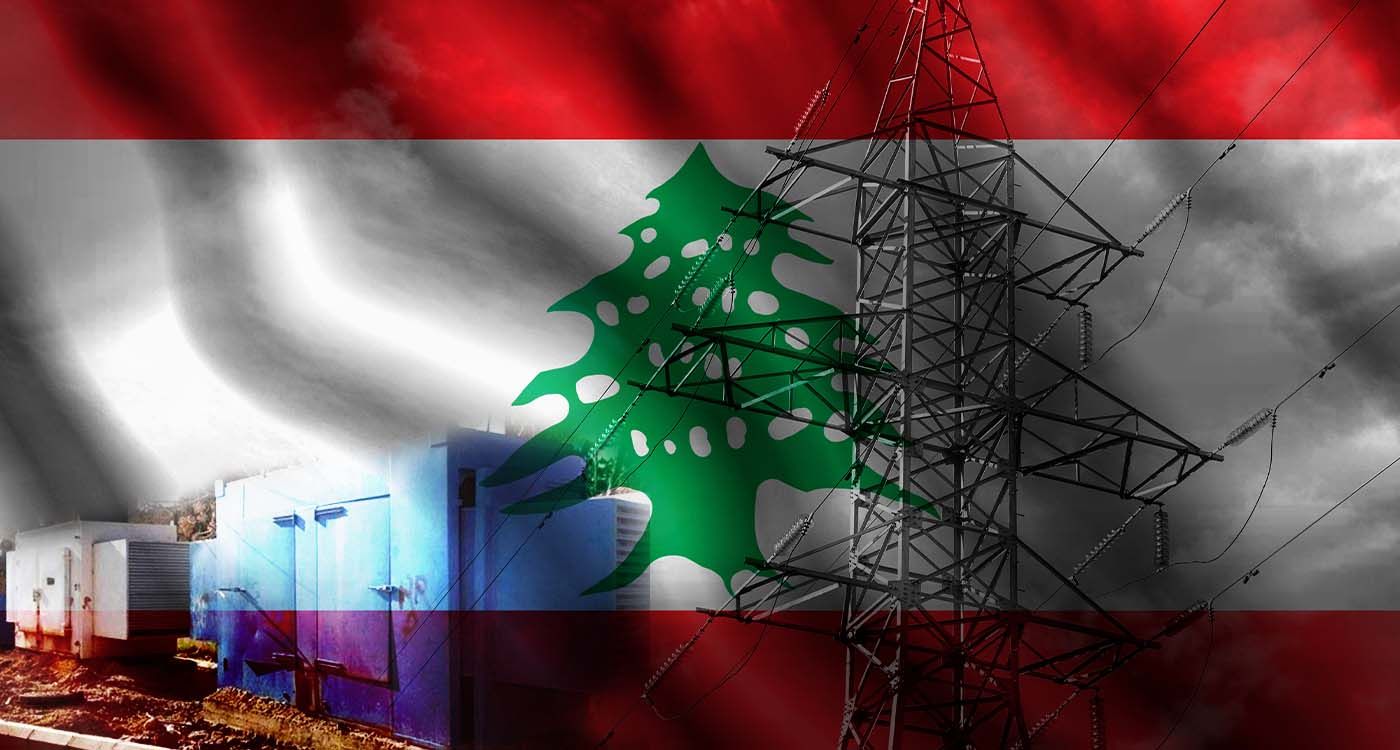
C’est un système opaque et tentaculaire qui maintient le Liban enfermé dans un modèle énergétique désuet. Importations massives de fuel, recours systématique aux générateurs privés, souveraineté nationale fragilisée, voire inexistante, et transition vers les énergies renouvelables sans cesse reportée… autant d’éléments qui alimentent les engrenages d’une dépendance chronique et qui empêchent toute réforme réelle.
Cet article se propose de décrypter les causes profondes de cette impasse: comment le secteur énergétique est resté captif de cartels et d’intérêts politiques, pourquoi le Liban ne parvient jamais à sortir du cycle du fuel et des générateurs et quels leviers permettraient enfin de libérer son potentiel solaire et éolien.
Pour le ministre de l’Énergie, Joe Saddi, interrogé par Ici Beyrouth, le problème repose sur trois piliers. D’abord, un déficit flagrant en infrastructures, qui se traduit par une capacité de production largement insuffisante.
Ensuite, le non-paiement généralisé des factures d’électricité par une partie importante des consommateurs, privant l’État de ressources essentielles.
Enfin, l’absence d’accès au gaz naturel, qui empêche toute transition vers une énergie plus propre, moins coûteuse et moins sujette aux soupçons liés à l’importation.
Autant de maillons d’une chaîne de blocages qui, ensemble, condamnent le Liban à rester dans le noir.
Des infrastructures vétustes et une production insuffisante
Le constat est sans appel: aucune grande centrale électrique n’a été construite depuis plus de vingt ans. Les centrales existantes, vieillissantes et mal entretenues, plafonnent aujourd’hui à 1.000 et 1.100 MW de capacité, soit trois fois moins que la demande nationale, comme le précise le ministre.
«Au mieux, l'Électricité du Liban (EDL) peut fournir huit à neuf heures d’électricité par jour - et encore, à condition que tout fonctionne parfaitement et que chacun paye ses factures», reconnaît Joe Saddi. Il signale, à cet égard, que le taux de recouvrement des factures ne dépasse pas 60 %, que les pertes techniques atteignent 10 % et que 30 % de l’électricité produite sont volés.
Une équation implacable qui prive l’État de ses recettes, affaiblit sa légitimité et accentue son effondrement institutionnel.
Le piège des générateurs privés
Privée ainsi d’une production publique suffisante, une grande partie de la population dépend désormais des générateurs privés pour combler le déficit. Ce secteur, à la fois lucratif et informel, fonctionne dans une logique quasi mafieuse: les importateurs de fuel, les opérateurs de générateurs et les réseaux politiques y sont étroitement imbriqués.
Les abonnements coûtent jusqu’à 44 % du revenu mensuel moyen des ménages, et jusqu’à 88 % pour les 20 % les plus pauvres ayant accès à un générateur. Et pourtant, ce marché échappe presque totalement au contrôle de l’État.
«La supervision des générateurs relève du ministère de l’Économie», explique Joe Saddi. Le ministère de l’Énergie ne fait que définir la tarification, tandis que le contrôle des compteurs, des installations et des prix dépend de l’Économie.
Une fragmentation institutionnelle qui illustre l’absence de coordination entre administrations et l’incapacité de l’État à réguler ses propres secteurs vitaux.
Une dépendance absolue à l’importation de fuel
Le Liban importe 100 % de son énergie primaire, un fait qui le rend extrêmement vulnérable aux fluctuations mondiales et aux jeux d’influence privés. Une douzaine d’entreprises se partagent le marché, dont la part cumulée est passée de 27 % en 2010 à 75 % en 2019.
Des affaires de fuel sanctionné russe, introduit via des circuits opaques et facturé jusqu’à 70 % au-dessus de sa valeur réelle, ont même été documentées.
«Toutes nos usines fonctionnent au fuel importé. Nous ne produisons rien sur place», rappelle le ministre Saddi. Ce verrou énergétique, combiné à une gouvernance fragmentée et à une crise économique sans précédent, bloque ainsi toute réforme d’envergure.
Le retard du Liban face à la transition énergétique
Malgré son potentiel solaire et éolien considérable, le Liban reste à la traîne. Selon plusieurs études, le pays pourrait couvrir jusqu’à 100 % de ses besoins d’ici 2035 grâce aux énergies renouvelables.
Mais corruption, monopoles, blocages politiques et manque d’investissements empêchent toute avancée. M. Saddi reconnaît: «Les grands projets solaires n’étaient possibles qu’après la création de l’autorité de régulation. C’est désormais chose faite. Néanmoins, l’État n’a pas les moyens d’investir seul. Raison pour laquelle nous nous attelons aujourd’hui à attirer des investisseurs privés via des partenariats public-privé».
Et de révéler que des discussions sont en cours avec des pays partenaires et avec la Société financière internationale de la Banque mondiale pour lancer des appels d’offres internationaux.
Pendant ce temps, la région avance: la Jordanie a diversifié ses sources grâce au solaire et au gaz, l’Égypte convertit ses centrales et investit massivement dans les renouvelables, Chypre mise sur l’éolien. Le Liban, lui, reste figé dans un modèle carboné et corrompu.
Trois leviers pour sortir du noir
Pour Joe Saddi, la voie du redressement repose sur trois priorités claires. Primo, augmenter la capacité de production en construisant deux grandes centrales, au nord et au sud, de 800 MW chacune. Secundo, convertir le secteur au gaz naturel, plus économique, plus propre et dont les voies d’importation sont plus transparentes que le fuel. Tertio, investir massivement dans les énergies renouvelables, notamment le solaire et, pourquoi pas, l’éolien dans certaines régions.
Les solutions ne manquent donc pas. Toutefois, tant que les réseaux de rente ne seront pas démantelés, que les lois resteront inappliquées et que la capture économique perdurera, la sortie du cycle du fuel et des générateurs restera un mirage.




Commentaires