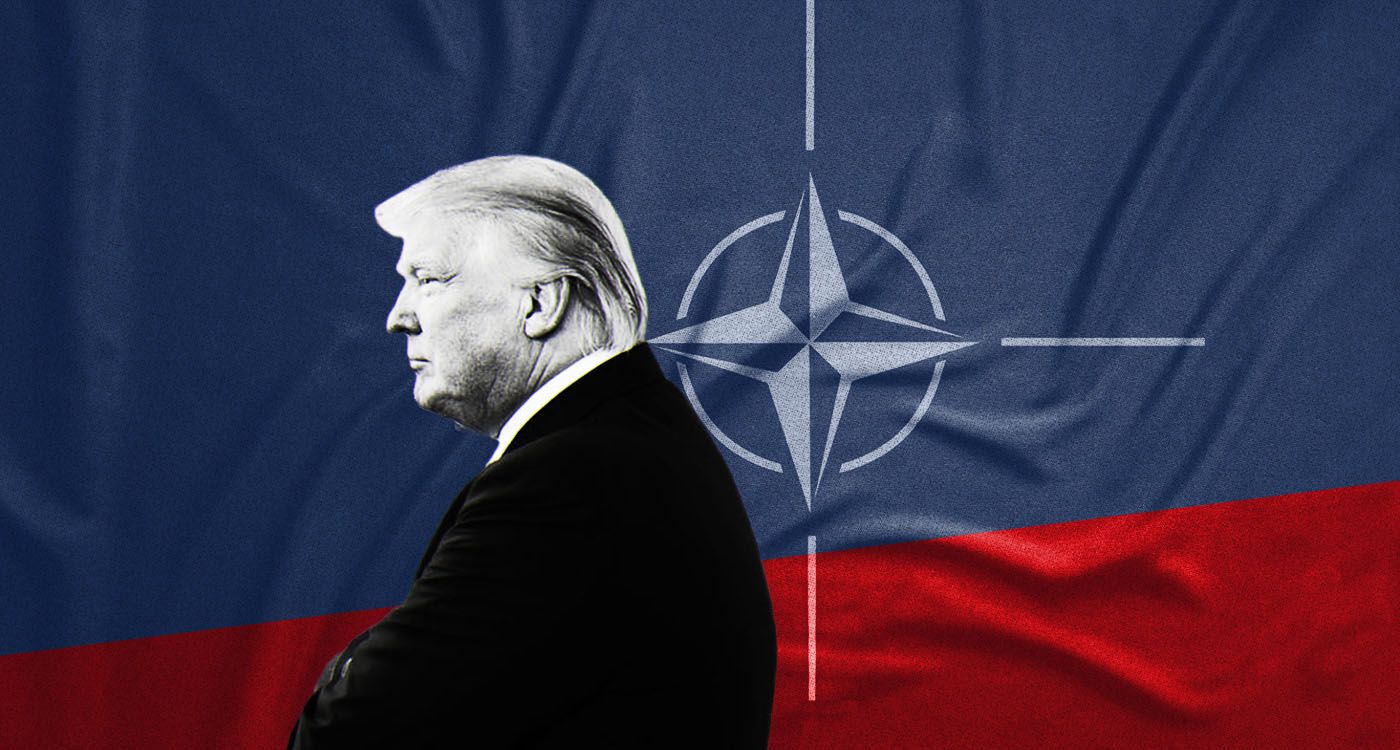
Une partie des médias et de la classe politique, de part et d’autre de l’Atlantique, s’emploie à exagérer l’idée selon laquelle la volonté du président Trump d’affirmer une souveraineté américaine sur le Groenland aurait infligé des dommages sans précédent, et irréversibles, à l’Alliance transatlantique, forte de plus de soixante-quinze ans d’existence. Cette lecture alarmiste se nourrit de plusieurs réflexes bien connus.
Aux États-Unis comme en Europe, certains se saisissent de la moindre entorse aux usages diplomatiques de Donald Trump pour y voir le signe annonciateur de la fin du monde tel que nous le connaissons. Côté européen, s’y ajoute une réaction très humaine, mais peu reluisante, celle d’États faibles et dépendants, prompts à se rebeller contre leur unique allié véritable dès lors que celui-ci refuse de suivre le scénario qu’ils avaient écrit. Dans une large part de la presse américaine, cette critique se résume à une idée simple: les autres alliés de l’OTAN ne pourraient désormais plus «faire confiance» aux États-Unis.
Cette indignation repose pourtant sur une amnésie collective. Depuis sa création, l’OTAN n’a cessé de traverser crises, dissensions et fractures internes. Une liste américaine des comportements «peu fiables» de certains alliés pourrait commencer dès 1956, à peine sept ans après la fondation de l’Alliance. Cette année-là, sans en avertir Washington, la France et le Royaume-Uni s’entendirent avec Israël pour envahir l’Égypte, reprendre le contrôle du canal de Suez et renverser le président Nasser. Cet ultime sursaut d’illusion impériale se solda par une humiliation: le président Eisenhower suspendit son soutien financier et pétrolier, contraignant Paris et Londres à se retirer.
Il y eut ensuite la décision du général de Gaulle, en 1966, de retirer la France du commandement militaire intégré de l’OTAN, sans doute la plus longue bouderie gaullienne de l’histoire, puisque la France ne réintégra pleinement la structure militaire qu’en 2009. Des années 1960 aux années 1980, les débats furent incessants, souvent violents, autour de la présence militaire et nucléaire américaine en Europe: manifestations, crises politiques, désaccords doctrinaux et divergences stratégiques rythmaient une relation pourtant essentielle pour dissuader l’URSS.
À la fin de la guerre froide, la réunification de l’Allemagne, après la chute du mur de Berlin en 1989, constitua un nouveau test. Ce qui semblait aller de soi à Washington ne fut possible que grâce à la diplomatie américaine, à la lucidité allemande et à l’assentiment de Moscou — en contournant une Margaret Thatcher hostile et un François Mitterrand pour le moins réservé.
Plus tard, lors de la seconde guerre d’Irak, la France prit la tête de l’opposition européenne à l’intervention américaine, tandis que les nouveaux membres d’Europe de l’Est se rangeaient aux côtés de Washington. La Turquie, pour sa part, refusa même un accès logistique aux forces américaines. Peu nombreux sont ceux qui défendraient aujourd’hui la campagne de 2003, mais à l’époque, le comportement ambigu de plusieurs alliés provoqua une véritable crise de confiance.
Plus récemment encore, en 2019, Emmanuel Macron déclara l’OTAN en «état de mort cérébrale», appelant à réduire la dépendance européenne vis-à-vis des États-Unis en matière de sécurité. Son appel resta largement sans écho. À la lumière de l’état actuel de la gouvernance française, on peut même se demander où se situe aujourd’hui la véritable paralysie cérébrale.
L’Alliance a survécu à toutes ces crises, et à bien d’autres encore. Elle survivra également à l’agitation actuelle, pour peu que les dirigeants se souviennent des intérêts fondamentaux qui les lient: des menaces communes, des intérêts stratégiques compatibles, des valeurs partagées et une interdépendance économique qui profite aux deux rives de l’Atlantique. Comme l’ont montré les Balkans dans les années 1990 et l’Ukraine aujourd’hui, l’Europe n’est tout simplement pas en mesure d’assumer seule ses défis sécuritaires. Il est toujours ardu pour des nations fières, héritières de traditions anciennes, d’accepter cette réalité. Mais le sens de l’État exige d’être lucide sur les limites de sa propre puissance. Une rhétorique européenne qui alimente, aux États-Unis, un désintérêt croissant pour l’OTAN ne sert en rien les intérêts de l’Europe.
Il est parfaitement légitime que chaque génération réévalue les choix de politique étrangère et de défense qu’elle hérite. Nous vivons une époque où le débat calme et rationnel semble appartenir à un autre âge. Pourtant, il n’a jamais été aussi nécessaire. Les Européens peuvent ne pas apprécier le style ni les méthodes de Donald Trump, mais le traitement qu’il a imposé pourrait bien renforcer l’Alliance plutôt que l’affaiblir. Les hausses significatives des budgets de défense en Europe résultent autant de la pression américaine que de la prise de conscience tardive de l’agression russe à ses frontières.
L’intérêt soudain de Trump pour le Groenland a, au moins, contraint l’OTAN à reconnaître une évidence: le changement climatique dans l’Arctique impose de repenser la protection d’intérêts communs dans une nouvelle zone de rivalités Est-Ouest.
Les leçons passent mal, et plus encore lorsqu’elles disent vrai. Mais si l’Europe ne réexamine pas ses politiques réglementaires, technologiques et fiscales qui étouffent la croissance, elle affaiblira non seulement l’économie mondiale, mais aussi sa propre crédibilité comme partenaire stratégique, incapable de financer sa sécurité. Avec un rééquilibrage du fardeau entre alliés, une révision stratégique lucide et une tolérance assumée pour nos différences nationales et politiques, l’OTAN demeurera un atout essentiel pour ses membres pendant de longues décennies.



Commentaires