
Il est désolant de commémorer la guerre civile libanaise avec un sentiment d’inachèvement qui nous renvoie aux réalités d’un conflit qui n’a jamais pris fin. On vit depuis aux rythmes séquencés de conflits mutants qui s’articulent à l’intersection de l’intérieur et de l’extérieur. Les crises conjuguées de légitimité nationale, de souveraineté, de culture politique et de gouvernance ont fourni une assise permanente à leur déploiement depuis plus de six décennies. La grammaire formelle des conflits n’a point changé, tout en sachant qu’elle s’est enrichie des crises qui ont scandé l’histoire contemporaine du Liban.
Les acteurs et les enjeux ont changé alors que les mécanismes de déclenchement se sont reproduits à l’identique. La souveraineté bafouée, la criminalisation de l’État, la prolifération des extraterritorialités politiques et juridiques, les politiques de subversion cautionnées par des choix idéologiques et géostratégiques ont détruit l’État libanais au profit des politiques de domination et de leurs doubles sur le plan régional. Les délires idéologiques adroitement manipulés par les acteurs alternés (syrien, iranien, turc, saoudien, qatari, islamiste) ont fini par créer une crise de légitimité endémique et par susciter les politiques d’instrumentalisation qui font désormais partie des dynamiques politiques internes.
Pour être objectif, force est de reconnaître que les Libanais ont appris à leurs propres dépens et se sont révoltés contre les politiques de séquestration sans pour autant pouvoir mettre fin aux enchaînements conflictuels. Les équivoques politiques et stratégiques de la culture politique dans l’aire arabo-musulmane n’ont jamais aidé à la stabilisation des États territoriaux, pas plus qu’à résoudre les problèmes du pluralisme et ses incidences sur la paix civile et la légitimation des États. Les conflits, pour s'enclencher, ont besoin d'un terreau de ressourcement.
La guerre de 2023 a remis en relief la gravité des conflits de normativité politique et constitutionnelle et ses effets délétères sur la vie politique, qui évolue dans un vide abyssal, où les rapports de force se substituent aux règles de droit et à la civilité démocratique. Les héritages composites du projet national libanais ont été effacés de manière systématique au profit des schémas idéologiques de l’«oummah» et des politiques de puissance. La politique du Hezbollah n’est que la nouvelle version d’un schéma de domination dont les prédicats ont structuré les politiques conflictuelles tout au long du centenaire qui a succédé à la fin de l’État impérial musulman (les califats). Les conflits ethno-nationaux n’ont jamais été reconnus à leur juste valeur afin de donner lieu à des scénarios de règlement négocié des conflits et d’ingénierie constitutionnelle, normativité islamique oblige.
Le Liban fait face, une nouvelle fois, aux dilemmes de la souveraineté territoriale, aux extraterritorialités de fait, aux guerres par procuration, aux surdéterminations conflictuelles et aux crises endémiques de légitimité. Les mécanismes d’arbitrage constitutionnels et les normes de civilité démocratiques ont été délibérément subvertis au bénéfice des politiques successives de domination et des supercheries idéologiques qui leur servent de caution. La défaite militaire du Hezbollah n’a pu, jusque-là, venir à bout des délires idéologiques du projet de domination. Ce qui, en d’autres termes, veut dire que la fin de cette illusion dépend de la fin du mythe et de la destruction du projet impérial du régime islamique iranien.
Le récit du régime iranien est désormais caduc; reste la question de l'avenir de la dictature islamique iranienne et de ses prolongements stratégiques au niveau régional. La fin de l’écheveau des mandataires patiemment tissé au niveau régional, la destruction des plateformes militaires conventionnelles et non conventionnelles, finiront par entériner un récit de «fin de l’histoire et par sceller la mort du projet impérial. Cela dit, faudrait-il miser sur la restructuration des rapports de force afin de faire émerger des narratifs concurrents et d'opérer des mutations dans le champ politique? Rien n’est moins sûr en l’absence d’un environnement géopolitique pacifié où les choix démocratiques auraient leur place.
Pour notre infortune, le déblocage politique actuel n’a pas, jusqu'à présent, donné lieu aux mutations institutionnelles et politiques escomptées. La défaite militaire et la trêve ne sont pas venues à bout des revendications d’extraterritorialité, de la politique de subversion ainsi que des pratiques de la criminalité organisée dont le Hezbollah et ses associés se recommandent. L’ambiguïté de la démarche politique du nouveau pouvoir ne fait que répercuter des scotomes idéologiques dirimants qui empêchent d’aborder les questions stratégiques en lice et d’envisager des politiques alternatives qui mettent fin aux cycles de violence. Le déni de réalité et ses doubles idéologiques et stratégiques ne peuvent être cassés que moyennant des changements qui s’articulent au croisement des nouveaux rapports de force et d’une prise de conscience critique, qui remettent en question des habitus et des schémas qui perpétuent les conflits.
Les négociations entre les États-Unis et l’Iran sont déterminantes afin de scruter les évolutions à venir et de décider de l’ensemble des enjeux politiques et stratégiques qui s’y rattachent. Les manœuvres dilatoires et les promesses vagues du régime iranien ont d’ores et déjà été exclues du script de négociations et ont été remplacées par des requêtes formelles en termes de dénucléarisation militaire, de désengagement politique sur le plan régional et de mise à terme de la politique de subversion énoncée sous le prédicat des «théâtres opérationnels intégrés», et du respect des droits humanitaires en Iran.
La marge de manœuvre du régime iranien se rétrécit ostensiblement pour des raisons multiples, dont sa vulnérabilité militaire, ses défaillances sécuritaires et sa crise de légitimité diffuse. Le démantèlement systématique de ses réseaux, la destruction de ses plateformes opérationnelles et son infiltration attestent de sa fragilité et de l’inanité des tentatives de redressement du Hezbollah. Le Hezbollah n’est plus que l’ombre d’un projet entièrement failli et dont les chances de reconstruction relèvent désormais de la fiction politique.
L’ennui est que le nouveau pouvoir au Liban n’a pas pris la mesure des mutations qui s’opèrent et n’arrive pas à définir les contours d’une politique réaliste à l’aune des nouvelles données stratégiques. Autrement, les travers idéologiques et l’immaturité politique se travestissent en alibis afin de fuir les défis réels que posent la pacification des frontières libanaises et la fin des extraterritorialités politiques et militaires. La politique de scotomisation n’a d’autre équivalent que l’absence de courage moral et la capacité d’initier des retournements politiques majeurs. Le fait de refuser la négociation avec l’État israélien, de s’abriter derrière des faux fuyants et de s’interdire des démarches de paix en dit long sur l’échec présomptif d’une politique de fuite en avant. En réalité, les conflits sont reportés et le Liban demeure un terrain de guerre par procuration. Faisons gaffe, Israël sera loin de s’accommoder d’un tel état de fait.



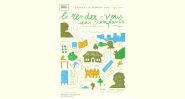
Commentaires