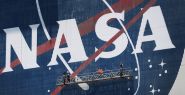Trump appelle à un changement de régime en Iran
- 28/02/2026
- 0 commentaire(s)
Les États-Unis ont lancé tôt samedi une opération militaire multijournalière contre l’Iran, baptisée «Opération Fureur Épique». L’assaut a débuté avec des missiles de croisière Tomahawk tirés depuis des navires et des frappes aériennes. En réponse, l’Iran a rapidement riposté, ciblant plusieurs bases américaines, y compris ...
Lire plus