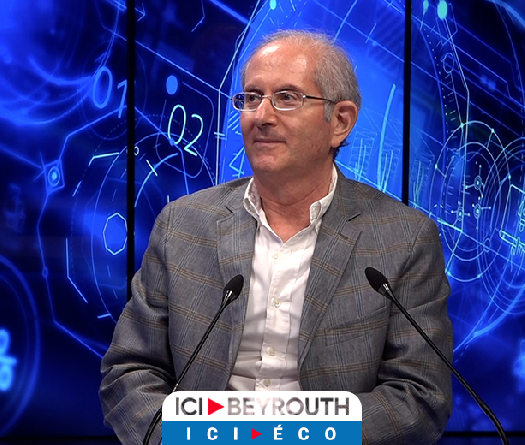Le testament d’Armani: vers un partenariat avec un géant du luxe
- 12/09/2025
- 0 commentaire(s)
Giorgio Armani a demandé à ses héritiers de céder à moyen terme son empire à un géant du luxe comme LVMH ou L'Oréal, selon le testament du styliste qui était pourtant resté hautement indépendant toute sa vie. Le couturier italien, décédé le 4 septembre à 91 ans, a chargé la fondation qui hérite de sa société «de céder une ...
Lire plus