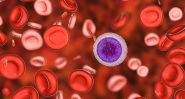La Turquie déploie un radar avancé à l’aéroport de Damas
- 21/01/2026
- 0 commentaire(s)
La Turquie aurait déployé un système radar avancé à l’aéroport international de Damas, en Syrie, selon le média israélien i24NEWS. Le radar, dont la portée serait comprise entre 150 et 200 kilomètres, aurait été installé dans une zone centrale ...
Lire plus